Entre 1840 et 1842, plusieurs centaines de petits volumes in-32°, comptant 132 pages, illustrés d’une cinquantaine de vignettes et vendus un franc, inondent le marché parisien. Ces petites plaquettes, que l’on voit partout, portent le nom de physiologies. La mode de ces physiologies a été un phénomène aussi bref qu’intense, mais néanmoins marquant tant il est représentatif des évolutions que connait l’édition française au milieu du XIXème siècle.
La numérisation récente d’un corpus d’une centaine titres par le département des Estampes et de la photographie de la BnF, nous invite à (re)découvrir tout un pan de la littérature populaire du XIXème siècle.
Physionomie des physiologies
Le terme de physiologies désigne donc une production au caractère assez homogène, que ce soit par son aspect matériel (petites plaquettes in-32°, d’une centaine de pages, ornées de 30 à 60 vignettes, à la couverture jaune ou bleue, imprimées sur du mauvais papier entre 1000 et 6000 exemplaires et vendues au prix dérisoire d’un franc) ou par son sujet, une caricature des mœurs contemporaines dans laquelle l’auteur et l’illustrateur s’attachent à décrire sur un ton humoristique les caractéristiques et le comportement de différents types sociaux ou corps professionnels. La lorette, la portière, le tailleur et le cocu sont parmi les « types » les plus prisés de cette littérature populaire.
« Physiologie, ce mot se compose de deux mots grecs dont la signification est désormais celle-ci : Volume in-18°, composé de 124 pages et d’un nombre limité de vignettes, culs-de-lampe, de sottises et de bavardage (logos) à l’usage des gens niais de leur nature (phusis) »
Physiologie des physiologies, 1841
« Les Physiologies sont comme les moutons de Panurge, elles courent les unes après les autres. Paris se les arrache, et on vous y donne pour vingt sous plus d’esprit qu’en a dans son mois un homme d’esprit. Et comment en serait-il autrement ? Ces petits livres sont écrits par les gens les plus spirutels de notre époque. Aussi les Physiologies se trouvent-elles sur toutes les tables de salon avec les œuvres de ceux qui ont le monopole de la plaisanterie écrite à coups de crayon »
Balzac, monographie de la presse parisienne
Une histoire des physiologies
Le mot « physiologie » a connu un glissement sémantique au cours du XIXème siècle. Dans la première moitié du siècle, la vulgarisation des sciences médicales (et notamment de la physionomie et de la phrénologie) influence fortement la littérature populaire. Alors que la physiologie désigne dans son sens premier l’étude scientifique du fonctionnement des organes et des tissus des êtres vivants, progressivement le terme se voit également appliqué à une littérature plus ou moins (mais surtout moins) sérieuse, qui consiste en une étude des mœurs de la société contemporaine.

Si le phénomène nait timidement autour de 1830, avec la Physiologie du goût de Brillat-Savrin (1826) et la Physiologie du mariage de Balzac (1830), il est véritablement lancé avec la Physiologie de la poire, de Peytel (1832). Reprenant une idée originale de Philipon, Peytel applique les formules littéraires de l’étude de mœurs et les théories médicales de la physionomie pour créer un virulent pamphlet contre Louis-Philippe. Cependant, la grande vogue des physiologies intervient une dizaine d’années plus tard, entre 1840 et 1842. On estime à 500 000 le nombre de tirages des 130 titres des physiologies parus dans ce court laps de temps. Plusieurs éditeurs se partagent le marché : Desloges, Bocquet, Aubert.

Ce sont cependant celles de ce dernier, associé à son beau-frère Charles Philippon qui demeurent les plus prisées, en raison de la qualité des textes et des images qu’elles contiennent. Il faut rappeler que les deux hommes éditaient déjà ensemble quelques journaux humoristiques à succès, dont le plus connu est sans conteste le Charivari. C’est donc sans difficulté qu’ils commandaient aux illustrateurs et journalistes à succès de quoi alimenter la publication soutenue de physiologies. Les noms les plus illustres des Physiologies sont Paul de Kock, Charles Marchal, Daumier, Gavarni…
Forte de son succès, la mode des physiologies ne s’est pas uniquement cantonnée à ces petites plaquettes in-32°. Voguant sur la même vague d’une littérature de type, certains éditeurs se lancent dans des entreprises plus ambitieuses. Ainsi, Léon Crumer publie en livraison les Français peints par eux-mêmes, accompagnés de 1300 vignettes. Grandville et Hetzel détournent le concept en offrant les Scènes de la vie privée et publique des animaux, accompagné de 320 vignettes de l’illustrateur.
Tout un pan de la culture populaire du XIXème siècle résumé en 132 pages et 50 vignettes.
Le phénomène des physiologies est exemplaire de ce qu’on peut qualifier de « boom » de l’édition au XIXème siècle. Il témoigne tout d’abord du développement d’une littérature populaire et bon marché, dite « industrielle » dans un contexte d’augmentation du taux d’alphabétisation et de l’émergence d’une culture de masse. Il témoigne également de la multiplication des illustrations dans les publications bon marché. Cette surenchère de l’image est rendue possible par la généralisation d’innovations techniques introduites quelques années auparavant dans le monde de l’édition française, telles que le bois de bout. Enfin, le contenu des textes illustre la vogue et le goût du XIXème pour les « types » et la caricature de mœurs.
Pour le lectorat d’aujourd’hui, les types décrits, les situations, les traits de caractère parlent, car ils font échos à certains passages des romans de Flaubert, Zola ou Balzac…

Le meilleur des physiologies
Digne de la meilleure grisette, le public le plus assidu de cette littérature populaire, j’ai lu pour votre plus grand plaisir une bonne partie des physiologies disponibles sur Gallica. Voici ma petite sélection personnelle du meilleur des physiologies.
La femme fait l’objet de plusieurs physiologies. Ainsi, on trouve sur Gallica une Physiologie de la femme, une Physiologie de la femme honnête, une Physiologie de la femme entretenue, une Physiologie du boudoir et des femmes de Paris et même une Physiologie de la femme la plus malheureuse du monde. Parmi les passages les plus amusant de la première plaquette, retenons surtout le chapitre intitulé « les femmes entre elles » : trois phrases seulement: « Deux femmes: rivalité. Trois femmes: complots. Quatre femmes: bataille rangée » et le chapitre « Manèges de femme« :
« Qui dit femme dit amour. La femme a été créée et mise au monde pour aimer et pour plaire. (…). Les femmes excellent à vous montrer mille choses qu’elles ont l’air de vous cacher avec un soin extrême. Les femmes qui ont la jambe bien faite, et celles qui ne l’ont pas, ne sautent pas les ruisseaux de la même façon. (…) Cette femme a un joli profil: vous ne la verrez jamais de face. A-t-elle de beaux cheveux? ils se dénouerons vingt fois le jour. A-t-elle de jolis pieds? Ils se croiseront et décroiseront sans cesse. A-t-elle de jolies mains? Sa coiffure ne sera jamais tranquille? A-t-elle de belles dents? elle rira toujours. Une femme ne perd pas un de ses avantages. »
L’amour, son commerce et ses ficelles sont au coeur des préoccupations des auteurs et des lecteurs des physiologies: on trouve des Physiologie des amoureux, du cocu (par une bête sans corne), du protecteur, de l’amant de coeur…
Tout d’abord, retenez que « la parisienne ne se donne pas, elle vous prend » En effet, rien de plus difficile pour le provincial qui arrive à Paris que de séduire une vraie parisienne. Les mémoires posthumes de Théophile Jourdan sont en ce sens très instructives et regorgent de détails croustillants.
 Le journaliste auteur de physiologies se réjouit des quiproquos. Ainsi, dans la Physiologie de l’amant de coeur, Marc Constantin relate la mésaventure bien embarrassante d’un homme marié ayant voulu tromper sa femme. Dans une Physiologie du célibataire et de la vieille fille, on lit les aventures d’un dandy ayant voulu séduire une marchande de porcelaine en gros.
Le journaliste auteur de physiologies se réjouit des quiproquos. Ainsi, dans la Physiologie de l’amant de coeur, Marc Constantin relate la mésaventure bien embarrassante d’un homme marié ayant voulu tromper sa femme. Dans une Physiologie du célibataire et de la vieille fille, on lit les aventures d’un dandy ayant voulu séduire une marchande de porcelaine en gros.
Par de savants calculs, certains auteurs vous persuadent des avantages du mariage par rapport à l’entretien d’une maîtresse : l’argument suprême: avec une légitime, vous pourrez être pingre!
Et comme « les histoires d’amour finissent mal en général », vous trouverez même un chapitre consacré à la question suivante : « Comment se rompent les liaisons de coeur« . C’est ici que vous découvrirez un des poncifs des physiologies, à savoir l’idée reçue que les grisettes voire même les femmes en général ont une orthographe déplorable:
Du parisien et du provincial.
A la lecture des physiologies, il apparaît que certaines choses n’ont pas beaucoup changé en 170 ans! Ainsi, c’est sans surprise que l’on découvre que le mépris réciproque du provincial et du parisien ne date pas d’hier. A lire dans la Physiologie du provincial à Paris:
« Parfois le provincial s’étonne d’être reconnu et de s’entendre dire:
-Monsieur arrive de son département?
-On voit bien que monsieur est nouveau à Paris!
(…) L’industriel du trottoir ou de la boutique flaire le provincial à cinquante pas; le plus médiocre observateur le reconnaît du premier coup d’oeil et à des signes certains.
S’il parle, son accent le trahit; s’il n’a pas d’accent, ce sont ses paroles qui le révèlent: s’il ne dit rien, mille façons particulières, mille petits détails qui lui sont propres, le dénonceront suffisamment.
Au restaurant, un individu frappe de son couteau sur la table pour appeler le garçon : – provincial.
Il mange du jambon à son dîner et demande des olives au dessert: – provincial.
Il marchande les objets de consommation, et veux obtenir un rabais sur le prix de la carte: – provincial.
Au café, il met dans sa poche le sucre qu’il économise sur sa demi-tasse: – provincial.
Il tutoie le garçon: – provincial.
Un quidam se promène au bois de Boulogne en cabriolet de place: – fashionable provincial.
(…) Au concert Musard, son menton bat la mesure sur sa cravate: – dilletante provincial. etc, etc, etc [lire la suite sur Gallica]
Mais rassurez vous, il existe aussi une Physiologie du Parisien en province. L’auteur, Charles Marchal y explique:
» On a beaucoup parlé de la niaiserie du provincial à Paris, – mais on n’a rien dit, – et c’est un tort, – de la sotte ignorance que déploie, là-bas, la Parisien qui n’a jamais dépassé les barrières. (…) Le parisien dont nous parlons se montre parfaitement ignorant des plus simples choses (…). Le malheureux! il ne sait pas ce que c’est que de l’herbe! Il ignore absolument ce que c’est qu’une fleur, qu’un arbre! (…) Car j’ose espérer qu’on ne donnera pas le doux nom de fleur et d’arbre aux mourantes imitations qu’on a planté dans nos jardins publics. »
Et pour finir, un conseil si vous voulez quitter votre logement sans le payer!
 Pour accéder au corpus des physiologies numérisées par le département des Estampes et de la photographie sur Gallica
Pour accéder au corpus des physiologies numérisées par le département des Estampes et de la photographie sur Gallica
Pour en savoir plus, l’article consacré aux physiologies sur le blog de Gallica







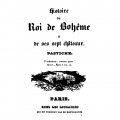




Ping : Gallica | Pearltrees
J’ai du lire cet article au moins 10 fois, je m’en lasse pas!
Ca tombe bien, j’ai de grands projets avec ce billet… Je voudrais mettre à profit mes cours d’info pour créer une carte interactive autour des physiologies!
Super, j’ai hâte de voir le résultat 🙂