Alors que le Musée national Marc Chagall célèbre ses quarante ans, le public parisien va pouvoir admirer à Paris, au musée du Luxembourg, 105 œuvres du peintre d’origine russe. Compte-rendu d’une visite en avant-première.

L’exposition du Musée du Luxembourg n’est pas une rétrospective. Intitulée « Chagall, entre guerre et paix », elle propose une approche thématique de l’œuvre du peintre entre 1914 et 1960.

« Entre guerre et paix » : les commissaires ont imaginé un parcours en quatre temps, illustrant les exils successifs de Chagall dans une Europe en proie à deux guerres mondiales et une révolution. Avec, en fil rouge, l’idée que dans l’œuvre de Chagall peut « se lire son expérience intime de l’histoire ». En effet, si Chagall traite rarement directement des évènements qui lui sont contemporains, ceux-ci pénètrent toute son œuvre, extrêmement autobiographique.
On pourra reprocher à cette exposition dont le succès est assuré d’avance, un parcours peu audacieux, voire même franchement déjà vu. En effet, les thèmes de la guerre et de la paix mais plus encore celui de l’exil et du voyage ont déjà exploité à de multiples reprises dans les expositions consacrées à l’artiste (et notamment en 2003 au Grand Palais avec Chagall connu et inconnu). Si elle est peu audacieuse, cette approche thématique à l’avantage d’inclure une grande partie des créations de Chagall de la période 1914-1950.
Le parcours s’ouvre avec un auto-portrait. Nous sommes en 1914, Chagall vient de séjourner trois ans à Paris, au cœur du Montparnasse, fréquentant la fine fleur des avants-gardes. Il rejoint la Russie pour épouser l’élue de son cœur, Bella, restée à Vitebsk, leur ville natale. Parti seulement pour quelques mois, mais surpris par la guerre, le séjour en Russie durera huit ans. Huit ans pendant lesquels Chagall occupe cet exil forcé sur sa terre natale en peignant des tableaux empreints de la vie quotidienne de cette petite ville de garnison et de culture judaïque… Il y crée également une école d’art, dont il perdra la direction suite à un « putsch » des suprématistes, un temps appuyé par le tout jeune pouvoir communiste.

La tension avec Malevitch et les menaces croissantes que la révolution soviétique fait peser sur le peuple juif l’amènent à regagner Paris avec femme et enfant. Un départ non sans douleur car teinté du sentiment d’être rejeté en son propre pays.
Les années d’entre-deux-guerres à Paris sont marquée par le développement de sa pratique de l’estampe, encouragé par le marchand d’art et éditeur Vollard. Ce dernier lui confie l’illustration de plusieurs ouvrages : Les âmes mortes de Gogol, les Fables de la Fontaine et la Bible. Ce sont des gouaches et des estampes de cette dernière entreprise, déjà connue du public parisien (Chagall et la bible, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 2011), qui illustrent cette section de l’exposition, où l’on admirera en outre le très célèbre tableau « Le rêve ».

Paris, Centre Georges Pompidou
Mais à nouveau, les menaces envers les juifs le rattrapent. En 1937, en Allemagne, les nazis saisissent dans les collections publiques ses œuvres et trois d’entre elles figurent à l’exposition « l’Art dégénéré » de Munich. Fin 1940, c’est de justesse et avec la complicité de l’ambassadeur des Etats-Unis que Chagall embarque pour New-York. Un exil qu’il n’a pas choisi. Il subit cette société de consommation à laquelle il n’adhère pas. Sa peinture, revient aux thèmes de l’enfance et Vitebsk réapparait encore et toujours dans ses œuvres. Mais dans les toiles de cette période, sa ville natale est en proie au feu et à la violence en écho à la situation des juifs en Europe, que Chagall n’ignore pas. Sa douleur est immense de savoir Vitebsk intégralement rasée après avoir été le théâtre de l’un des plus importants massacres perpétré par les escadrons de la mort. Dans les œuvres de Chagall transparait sa souffrance de voir ainsi son peuple persécuté. La crucifixion « juive » devient un motif récurrent dans ses compositions, symbole non pas, comme dans la tradition chrétienne de l’espoir de la résurrection, mais de la souffrance humaine.

Paris, Centre Pompidou
En 1944, alors que l’issue de la guerre se profile, un nouveau malheur frappe Chagall : la perte de sa femme et muse Bella, qui succombe d’une maladie bénigne, mal traitée en raison de la pénurie de médicaments. Chagall, peintre pourtant jusqu’alors prolifique, cesse de créer pendant neuf mois. Quand il se remet à la peinture, la silhouette de Bella est toujours présente : elle ne le quittera jamais plus. Cinq ans plus tard, alors que Chagall regagne enfin la France, sa peinture renoue définitivement avec la paix, envahie de couleurs… C’est sur cette note joyeuse que s’achève le parcours de « Chagall, entre guerre et paix ».
Cent cinq œuvres ont été sélectionnées pour illustrer cinquante années cruciales de la carrière d’un artiste mort presque centenaire. On admirera au Luxembourg de très belles peintures, dont beaucoup sont issues des collections publiques françaises (1/3 des œuvres sont des prêts du Centre Pompidou).
Voulant traduire physiquement l’idée d’errance, l’agence N.C., qui signe la scénographie de l’exposition, propose un itinéraire en lacets. Le parcours, étroit et tortueux, fait de courbes et de recoins, semble ignorer la réalité des flux de visiteurs : quelle mauvaise idée pour une exposition qui promet d’attirer les foules ! Il y a fort à parier que la visite sera insupportable : ne parlons même pas de la circulation des groupes, tout bonnement impossible ! En revanche, on peut souligner le sage choix des coloris des cimaises : une palette de gris et un éclairage maîtrisé qui mettent parfaitement en valeur les œuvres.
 Un grand merci à la RMN et à Carpewebem grâce à qui j’ai pu visiter cette exposition dans d’excellentes conditions lors d’une soirée spéciale web.
Un grand merci à la RMN et à Carpewebem grâce à qui j’ai pu visiter cette exposition dans d’excellentes conditions lors d’une soirée spéciale web.
Toutes les infos pratiques sur Chagall entre guerre et paix sur le site du musée du Luxembourg.
A voir également : Marc Chagall, d’une guerre l’autre, au musée national Marc Chagall à Nice, jusqu’au 20 mai 2013.

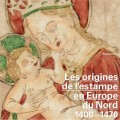


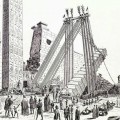
Ping : Au fil des expositions | Pearltrees