Sous le titre « vues d’optique » est désigné un type spécifique de la production gravée du XVIIIe siècle : des images en perspective, souvent coloriées à la main et destinées à être regardées à travers une boîte d’optique qui en accentue l’effet de profondeur. Près d’un millier de ces estampes a été numérisé sur Gallica: Orion en aéroplane vous propose de les découvrir, pour un périple de papier à travers le monde et le temps!
![Vue d'optique représentant le Pont de St Michel à Paris, vers 1750, sans nom d'éditeur, Gallica/BnF [détail]](http://peccadille.net/wp-content/uploads/2013/07/vue-doptique-reprc3a9sentant-le-pont-saint-michel-1024x580.jpg)
On reconnaît assez aisément une vue d’optique aux caractéristiques spécifiques de cette production. Gravées à l’eau-forte, ces estampes présentent toujours un format horizontal aux dimensions homogènes (20 à 27 cm de hauteur pour 35 à 45 cm de longueur). Imprimées en noir, elles sont coloriées à la main ou au pochoir de façon assez sommaire, l’effet d’ensemble primant sur le détail. La gamme chromatique, assez restreinte, associe le plus souvent le vert, l’ocre, le bleu, le rouge et le brun. Le résultat, suivant le soin du coloriste est plus ou moins réussi… Principale caractéristique de l’image, sa construction en perspective, souvent très exagérée afin de rendre l’effet optique encore plus saisissant. Les images sont accompagnées d’une légende souvent reproduite deux fois : le titre est ainsi inscrit à l’endroit et à l’envers de façon à être lisible même quand l’estampe est placée dans la boîte d’optique, où un miroir inverse l’image.

La production des vues d’optique débute en Angleterre durant la première moitié du XVIIIe siècle. Le succès naissant, ces estampes sont bientôt imitées dans d’autres pays. Au moment de l’apogée de la mode des vues d’optiques, entre 1740 et 1790, quatre grands centres inondent l’Europe de leur production : Londres, Bassano, Augsbourg et Paris.

Les vues d’optique sont prisées dans des milieux sociaux très différents : loisirs agréable des salons aristocratiques, les vues sont admirées dans de belles boîtes ornées qui sont de véritables objets d’art. Le spectacle s’apprécie comme une expérimentation scientifique. Mais la vue d’optique divertie aussi les foules populaires qui se pressent lorsqu’un colporteur installe sur un marché sa boîte et commence à narrer les extraordinaires événements survenus dans un ailleurs plus ou moins lointain et inaccessible. Il est assez difficile de trouver sur internet des photographies des boîtes d’optique et zogaroscopes qui servaient à regarder ces images.
On distingue dans la production de vues d’optique trois catégories. La première, la plus abondante, regroupe les vues topographiques : châteaux, villes, ports, contrées lointaines, reproduits avec plus ou moins d’exactitude, en fonction des documents à disposition du graveur. Si la lettre de certaines de ces estampes nous garantit une représentation « au naturel », il est évident que les auteurs de ces images n’ont pas parcouru les contrées lointaines qu’ils étaient parfois appelé à représenter. Ils recomposaient donc les paysages à figurer en compilant diverses gravures et dessins, ce qui explique certaines fantaisies.

La seconde catégorie regroupe les scènes d’actualité : sacres, batailles, dramatiques incendies ou catastrophes naturelles en tout genre forment des sujets dont le peuple est friand. Sur ce point la vue d’optique partage avec le Canard les mêmes « niches » éditoriales.

Enfin, un ensemble de vues à thématique religieuse ou moralisatrice forme la dernière catégorie. A valeur éducatives, ces estampes ont surtout été produites par les éditeurs parisiens de la rue Saint-Jacques.

Il est fréquent qu’une même image paraisse successivement chez plusieurs éditeurs soit que la matrice ait changé de main suite à une vente ou à une succession, soit qu’un éditeur ait contrefait une vue produite par un concurrent. En témoigne une vue de l’extérieur de la chapelle de Versailles, dont on trouve 4 exemplaires sur Gallica. La matrice originale a successivement été en possession de Jacques Chereau, de Basset et enfin de Huquier, soit trois des principaux éditeurs de vues d’optique de la rue Saint-Jacques. A chaque changement de propriété, l’adresse mentionnée dans la lettre évolue. Le coloriage, effectué à la main, diffère bien entendu toujours. Très rapidement après la publication de l’estampe, un éditeur d’Augsbourg contrefait la composition. Son graveur reproduit sur cuivre un des exemplaires parisiens: du fait de l’inversion de l’image à l’impression, l’exemplaire augsbourgeois est dans le sens inverse des exemplaires français.

La mode de la vue d’optique s’éteint progressivement au cours de la première moitié du XIXe siècle, alors qu’elle est concurrencée par d’autres modes de production d’images « spectaculaires » : le panorama puis, après 1839, la photographie et notamment la photographie stéréoscopique.
Les vues d’optiques sont assez nombreuses dans les collections publiques et sur le marché de l’art. Le corpus numérisé par la BnF et ses partenaires est de ce fait assez conséquent. Près de mille vues d’optique sont actuellement disponibles sur Gallica – un chiffre qui devrait encore augmenter car tous les fonds n’ont pas encore fait l’objet d’une campagne de numérisation. 900 vues sont accessibles sous la requête « vue d’optique ». Une autre requête permet d’isoler les 600 estampes rassemblées dans les 9 recueils factices intitulés « Choix de vues d’optique des XVIIIe et XIXe siècles » provenant de la collection de Léon Vivarez.

Si les vues d’optiques sont conservées en nombre relativement important, toutes ne sont pas en bon état : souvent manipulées pour les besoins du « spectacle », leurs bordures sont usées. D’autre part, un certain nombre de ces vues ont été découpées pour créer des effets d’éclairage et des jeux de lumières sur lesquels je reviendrai dans un prochain billet.


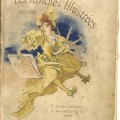


Un article très intéressant (comme toujours) !
Ces vues d’optique sont assez rares pour le midi… quelques-unes ont pour sujet Marseille.
J’ai sur le mur à gauche de mon bureau une « vue du cours de Marseille » qui diffère de celles qui sont présentées sur gallica.fr. Elle semble être du XVIIIème, mais, malheureusement, elle a été coupée en bas, donc pas d’informations sur l’auteur et la publication… Au plaisir de lire la suite !
Merci beaucoup!
Oui, certaines villes/régions sont plus représentées que d’autres….
Il est rare que les noms des graveurs soient connus: seuls ceux des éditeurs figurent sur les cuivres des vues d’optique. Pour ce qui est des datations, j’indique celles du catalogue de la BnF, qui ne sont pas toujours exactes… La vue d’optique est un domaine où il reste beaucoup de recherche à effectuer, notamment du point de vue de l’établissement d’un catalogue raisonné!
Ping : Parenthèse - Rêver d'Italie - Pour une image
superbe !
Ping : [Journal de Thèse] Une nouvelle aventure qui commence… Trois ans l’oeil dans la boîte d’optique ! – Isidore & Ganesh