Elle est l’une des icônes de la décennie 1890, une beauté au visage éternellement juvénile et virginal… Cléo de Mérode est certainement aujourd’hui encore la plus célèbre des modèles de la maison Reutlinger. Ce sont d’ailleurs les clichés réalisés par Léopold Reutlinger qui ont le plus efficacement véhiculé l’image de cette mystérieuse courtisane.

Le cas de Cléo de Mérode est passionnant à double titre. D’une part, elle fut l’une des plus singulières « cocottes » de la fin de siècle, dont la vie privée, jalousement préservée, suscite encore d’intenses interrogations. D’autre part, son rapport très particulier à la photographie en fait l’une des premières icônes modernes. Contrairement à la plupart des autres femmes du monde de son temps, elle ne se prête pas passivement au jeu de la photographie mais habite avec force un personnage qu’elle a patiemment construit et mis en scène.
Note: toutes les illustrations de cet article (sauf les cartes postales) sont tirées des albums Reutlinger. Les liens disséminés dans le billet renvoient à d’autres images, tirées du dossier iconographique conservé au département des arts du spectacle et également numérisé sur Gallica.
Si Cléo de Mérode fait figure d’être à part parmi les courtisanes de la fin du XIXe siècle, c’est donc d’abord par son histoire personnelle, si singulière. Elle n’est pas d’extraction populaire, au contraire de la plupart des femmes de spectacle qui percent au crépuscule du XIXe siècle. De son vrai nom Cléopâtre Diane de Mérode, elle est née d’une union illégitime dans la haute société autrichienne. Sa mère, Vincentia de Mérode, noble désargentée et bohème l’élève à Paris. Orgueilleuse de la grande beauté de sa fille, Vincentia va constamment la mettre en scène, l’exhiber, contribuant ainsi dès son plus jeune âge à forger l’icône qu’elle deviendra.

A sept ans, Cléo débute comme petit rat à l’Opéra. Une telle activité peu surprendre quand on sait ce qui se passait au foyer entre les petites danseuses et les vieux abonnés ! Mais Cléo, qui ne se départit pas de sa bonne éducation, ne se mélange pas aux autres adolescentes, .
En 1894, sa figure se détache parmi le corps de ballet. Cléo de Mérode a 19 ans : sa beauté attire de plus en plus les regards tandis que les premières photographies où elle figure seule commencent à circuler.

En 1896, deux scandales braquent les projecteurs sur elle. Le premier éclate au Salon de Printemps. Peu de temps auparavant, le sculpteur Falguière l’avait priée de prêter les traits de son visage à une statue de danseuse qu’il préparait. A l’inauguration du Salon, l’œuvre est dévoilée, et contrairement à ce que l’artiste avait assuré à la jeune femme, la statue n’est pas couverte d’un pudique voile mais s’élance, dénudée et « indécente ». Il se dit alors que Cléo a posé nue…
Au même moment, circulent des rumeurs sur une supposée liaison entre la jeune Cléo et le roi des Belges, Léopold II, déjà âgé et ventripotent. Les journaux s’en amusent et se couvrent de caricatures peu flatteuses, bien éloignées de l’image virginale et angélique que la photographie diffuse parrallèlement.
La vérité sur ces deux affaires n’a jamais été connue : Cléo de Mérode, jusque dans ses mémoires, s’est toujours défendue de d’avoir jamais posé nue ou d’avoir entretenu des liaisons… Il est vrai qu’on ne lui connaît que deux longues fiançailles et aucune aventure. Sa vie privée a toujours été gardée secrète et les rares fois où elle a dévoilé un pan de son intimité, ce fut dans une stricte mise en scène bourgeoise et respectable. Toute sa personnalité est dissimulée derrière le masque d’un personnage parfaitement réglé jusque dans ses moindres détails. La photographie a été l’outil indispensable de la construction de cette image, élevée au rang d’icône.
Les plus anciennes photographies de Cléo datent de son enfance : une belle petite fille puis une adolescente au sein du ballet de l’Opéra. Tout bascule en 1894, alors qu’elle a dix-neuf ans. Cette année-là, Cléo de Mérode réalise une première séance de pose en solo dans l’atelier de Nadar. Dès cette série inaugurale, les grandes lignes de son image canonique sont posées : bouche close, regard mélancolique ou perçant, long cheveux soigneusement brossés et maintenus par un délicat bandeau qui accentue ses traits fins.

Si cette séance inaugurale est réalisée chez Nadar, Cléo fréquente dès l’année suivante le studio Reutlinger, spécialisé dans la photographie des femmes de spectacles. La cinquantaine de photographies que nous admirons dans les tomes des « albums Reutlinger » témoignent d’une collaboration régulière et entendue, une des plus fructueuses de la carrière de Léopold Reutlinger, peut-être scellée par un officieux contrat d’exclusivité.
Il semble que Cléo ou sa mère dictaient en grande partie le choix des postures et des costumes, ce qui n’est apparemment pas le cas pour les autres « mondaines » qui passaient devant l’objectif des Reutlinger.

Cléo de Mérode apparaît toujours droite, finement campée, jamais souriante mais toujours avec un regard intense, qu’il fixe l’objectif ou qu’il soit plongé dans une mélancolique réflexion.
Les premières poses reprennent celles imaginées chez Nadar quelques mois plus tôt : longs cheveux maintenus par un bandeau, dans une référence évidente à la Belle Ferronnière. Ailleurs, elle apparaît dans son tutu de danseuse, toujours dans une attitude passive. Beauté désincarnée, presque sans présence corporelle, Cléo joue de la délicatesse de son corps si menu et quasi androgyne : c’est ainsi qu’elle se travestit à plusieurs reprises en petit page. Aux yeux de ses contemporains, la référence artistique est parfaitement lisible: Cléo évoque une oeuvre qu’elle affectionnait tout particulièrement, le Chanteur florentin du sculpteur Paul Dubois.
Si une partie des clichés de Reutlinger sont réalisés dans des costumes qui évoquent ses rôles sur scène, sans pour autant transcrire ses pas, Cléo apparaît également en costume de ville. Habillée par Jacques Doucet, elle se pare de robes sculpturales qui magnifient sa silhouette.

Certains des clichés les plus célèbres de Cléo par Reutlinger sont réalisés en 1900 : elle y apparaît dans son costume de danseuse cambodgienne qui a tant séduit durant l’exposition Universelle. Cette image, qui annonce déjà les frasques de Mata Hari, vont grandement contribuer à forger sa légende et à lui donner, par cette touche d’exotisme, un pouvoir fantasmagorique plus grand encore.

Après 1900, l’image de Cléo de Mérode s’épuise, du double fait de son extrême codification et de sa diffusion massive. Ne posant jamais plus les cheveux dénoués, Cléo de Mérode s’évertuera à reprendre inlassablement les mêmes poses, à la poursuite d’une éternelle jeunesse et cherchant par tous les moyens à se conformer à sa propre image que la photographie a fixée.
Les séances se font de plus en plus rares après 1914 : Cléo, inexorablement, vieillit. Ce ralentissement de l’activité photographique correspond également à la cessation d’activité de Léopold Reutlinger, trop affecté par la perte de son fils au front.

En 1964, quelques temps avant sa mort, Cléo de Mérode confie une dernière fois son visage à l’objectif d’un photographe pour un reportage dans Vogue. La série de photographies qui en résulte est à mon sens la plus émouvante. On y découvre une vieille dame de 94 ans, belle et digne, faisant un dernier écho à ses clichés les plus célèbres.
Quand on feuille les albums Reutlinger, les clichés de Cléo de Mérode, plus que tous autres, nous semblent d’une étrange familiarité… Et pour cause : la beauté immaculée de cette éternelle jeune fille marque encore notre culture visuelle tant elle a été diffusée et ce sous de multiples formes. Car Cléo de Mérode est l’une des premières icônes populaires. Entre 1896 et 1914, son image a été démultipliée à l’infini, sur les supports les plus divers. Non seulement son visage circule sous forme de cartes album mais figure également sur des cartes postales, dans des montages plus ou moins réussis. La belle Cléo sert à vendre de tout : cigarettes, chocolats, parfums, chapeaux… et ce à une échelle internationale !

Une utilisation que Cléo a monétisée. Non seulement la jeune femme a su parfaitement codifier son image mais également la commercialiser avec brio. De ce fait, elle est l’une des rares grandes courtisanes à avoir fini sa vie dans le confort matériel sans l’aide de personne !

Pour aller plus loin
En ligne
- Mes autres billets sur le corpus Reutlinger
- Les albums Reutlinger sur Gallica
- Boîte de documentation iconographique sur Cléo de Mérode sur Gallica
Bibliographie
- Agrati F., Léopold Reutlinger: la représentation photographique de la femme du spectacle à Paris, 1875-1917, Mémoire de Master I, Université Paris IV La Sorbonne, 2006.
- Bourgeron J.-P., Les Reutlinger: photographes à Paris, 1850-1937, Paris, J.-P. Bourgeron, 1979.
- Corvisier C., Cléo de Mérode et la photographie: la première icône moderne, Paris, Éd. du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2007.




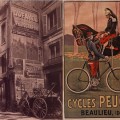
Merci pour cet article passionnant.
Ping : Colette (presque) toute nue | Orion en aéroplane
Ping : La cocotte et le couturier : la demi-mondaine comme lanceuse de mode | Orion en aéroplane
L’analyse est excellente !
Ping : Anatomie d’une collection | De Fil en Archive
Très bel article , très éclairant , qui met en évidence sa place d’ icone plus que de courtisane .