Toujours à la recherche de pratiques d’écriture innovantes (!), Marine – qui tient le merveilleux blog « Raconte moi l’histoire – et moi-même avons décidé d’expérimenter un nouvel exercice, celui des billets croisés sur un même thème. La première expérience est odorante car nous traitons des excréments (sans commentaire) : Marine vous entretient ainsi de l’évacuation des excréments à travers l’histoire tandis que je vous parle de la difficulté de se soulager dans les rues de Paris au XVIIIe!
Quand on s’intéresse à la vie de nos ancêtres, on ne se pose pas toujours les questions les plus triviales, et pourtant… Que se passait-il, quand, au XVIIIe ou au XIXe siècle, un homme du peuple avait une rage de dent ou quand une dame était prise d’une subite diarrhée? Pour répondre à cette dernière et odorante question, Louis-Sébastien Mercier nous offre quelques pistes.
Paris au XVIIIe siècle est cruellement dépourvue de latrines publiques… Si une envie pressante vient au passant, il n’a que peu de solutions: soit frapper aux portes pour obtenir d’accéder aux cabinets d’un particulier, soit d’improviser dans un coin de rue. Dans son Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier, fin observateur du quotidien de la capitale liste quelques lieux d’aisance sauvages les plus prisés.
 Ainsi, Louis-Sébastien Mercier nous apprend que le jardin des Tuileries a longtemps été « le rendez-vous des chieurs » qui profitait des haies d’ifs pour « soulager leurs besoins », si bien qu’une odeur infecte se dégageait des Tuileries. Une situation intolérable pour le comte d’Angiviller qui fit arracher les ifs et installa dans le jardin les premières latrines publiques. Cependant, il fallait débourser deux sols pour se soulager!
Ainsi, Louis-Sébastien Mercier nous apprend que le jardin des Tuileries a longtemps été « le rendez-vous des chieurs » qui profitait des haies d’ifs pour « soulager leurs besoins », si bien qu’une odeur infecte se dégageait des Tuileries. Une situation intolérable pour le comte d’Angiviller qui fit arracher les ifs et installa dans le jardin les premières latrines publiques. Cependant, il fallait débourser deux sols pour se soulager!

Dans le reste de la ville, de tels accommodements n’étaient pas proposés, et bien souvent, il fallait improviser: une ruelle sombre ou un recoin faisaient parfaitement l’affaire pour « lâcher les eaux ». Diverses ordonnances contre les gens « qui font leurs ordures » ont été prises, sans succès. Mercier observe mêmes que les « endroits où l’on a mis pour inscription: Défense, sous peine de punition corporelle de faire ici ses ordures » sont justement les plus prisés. « Il ne faut qu’un exemple isolé pour amener trente compagnons ».
« Les excréments du peuple avec leurs diverses configurations sont incessamment sous les yeux des duchesses, des marquises et des princesses », déplore Mercier. Chier en public offense l’odorat, la vue et la pudeur publique. Car l’on peut vous surprendre les fesses à l’air.

Au coin de la place des Victoires, une femme converse avec un homme, dissimulant de sa robe sa compagne qui se soulage contre une borne. L’estampe, publiée par Bonnet, est grivoise : « Les femmes sur ce point sont plus patientes que les hommes; elles savent si bien prendre leurs mesures que la plus dévergondée ne donne jamais le spectacle qu’offre en pleine rue l’homme réputé chaste » nous rappelle Mercier. Et en effet, le propos de l’estampe est plutôt licencieux : un voyeur se penche à la fenêtre pour contempler la dame faire ses affaires!

Les quais de Seine font également office de latrines en plein air, si bien que Mercier avance, non sans humour, que le Journal de Paris, en plus de consigner les fluctuations de la météo et du fleuve, pourrait tenir une chronique de l’état des épidémies en cours rien qu’en observant les défections qui ornent les bords de l’eau. « Ce serait pour lui un véritable thermomètre des maladies régnantes; ils saurait dans quelle saison de l’année les estomacs manquent de ton; et la malpropreté publique tournerait au moins au profit du génie observateur ».
Il n’y a pas que les « chieurs » en plein air qui salissent les rues parisiennes. Bien des latrines privées sont vidées au coin des rues, bien que des règlements imposent la présence de fosses sous les maisons. Pour dégager les voies de ces déchets nauséabonds, Paris compte une armée de boueurs, payés à déblayer. En 1780, ils évacuent quotidiennement 750 mètres cubes de boue et d’ordure vers la banlieue. Il convient au passant de se méfier de ces boueurs: il arrive qu’ils aient la pelleté trop large, et que le contenu qu’ils déblayent tombe sur l’honnête homme plutôt que dans le tombereau.
Pour terminer le tableau, précisons que le marcheur doit également se méfier de ce qui tombe du ciel, car il arrive qu’il s’agisse d’excréments. En effet, les habitants des mansardes et des greniers ne s’embêtent pas toujours à descendre leur pot de chambre jusqu’au coin de la rue: il est plus efficace de tout balancer depuis le toit! Pourtant, une loi interdit de « jeter la liqueur immonde par la fenêtre », mais aucune plainte n’est acceptée si le contenu passe par la gouttière!
A lire aussi :
- « les latrines publiques », dans Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, tome VIII, p. 205.
- « Les ingénieurs du caca » sur le blog Raconte moi l’histoire, par Marine
- « La femme qui pisse de Rembrandt » sur ce blog
- « Un trésor scatologique sur Gallica » à propos de la Physiologie inodore également sur ce blog



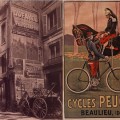

Source: gallicaca
Article très sympa sinon!
Assez instructif. Une autre image de Paris…
Merci de redonner la parole à L.S. Mercier et à ses humeurs de la fin du XVIIIè siècle.
J’espère encore souvent donner la parole à Mercier, je l’ai découvert (avec bonheur) il y a peu.
Malheureusement, je n’arrive pas à dégoter d’édition numérisée potable hors Google books.
Finalement si on y réfléchit bien cela n’a pas tellement changé . Paris est toujours une des villes européennes où il est le plus difficile de trouver des toilettes publiques ….
Dans les voyages en France d’Arthur Young, on trouve de nombreuses mentions des « lieux d’aisances » ou des « commodités » qui sont alors presque toujours « le même temple d’abomination »… A mon avis, les touristes qui fréquentent les aires d’autoroute françaises d’aujourd’hui pourraient en dire autant. C’est à mon avis une spécificité française qui s’inscrit dans la longue durée dont les ressorts profonds n’ont pas encore été analysé à suffisamment de soin…
Nous n’avons pas fréquenté les mêmes aires d’autoroute semble t il,quoiqu’il y est à redire sur d’autres points..Monsieur ne doit points avoir voyager souvent à l’étranger pour tenir là,pareil propos.
Qu’importe,la vrais spécifité française,est l’auto-flagellation,plutot que la recherche de vrais solutions,ou même juste constater ce qui est efficient.
Et bien je suis toujours surprise de la propreté des aires d’autoroute. Qu’il s’agisse des grandes aires avec cafétérias, stations services et autre ou des petites aires où seule la pause pipi est de mise.
A mon avis il y a très très très longtemps que vous n’avez pas fréquenté les toilettes des aires d’autoroute !
Restif de la Bretonne, grand amis de Louis-Sébastien Mercier, y consacre pas mal de pages de ses Nuits de Paris.
Ping : Faire caca à Paris au XVIIIe sièc...
J’adore les gravures. Jusqu’au XIXème avec la culotte fendue les dames font volontiers pipi debout. Cela avait une autre allure. Il y a des adeptes encore aujourd’hui. Cela demande un peu d’entrainement. On trouve des conseils sur Internet.
Ping : Faire caca à Paris au XVIIIe sièc...
Il y a toujours autant de caca sur les trottoirs de Paris
Quelques pistes de lectures:
Dominique Laporte, Histoire de la merde, 1978 (2003)
Alain Corbin, Le miasme et la jonquille : L’odorat et l’imaginaire social aux XVIIIe et XIXe siècles, 1982 (2008)
Georges Vigarello, Le Propre et le Sale : L’hygiène du corps depuis le Moyen-Age, 1987 (2014)
André Guillerme, Les Temps de l’eau : la Cité, l’eau et les techniques, 1993.
Jean-Pierre Goubert, Une histoire de l’hygiène: Eau et salubrité dans la France contemporaine, 2008 (2011)
Et aussi :
La Fabuleuse Histoire des excréments : documentaire de Quincy Russell, durée 3×43 minutes, 2007 ; diffusé en France par Arte [présentation en ligne].
Merci beaucoup, car je comptais justement poursuivre sur la même thématique, notamment sur la Seine et les déchets.
Vigarello et Corbin sont déjà présents dans ma bibliothèque, j’irai consulter les autres avec curiosité!
Sur Gallica certains volumes sont en ligne. En revanche si le sujet vous intéresse et si vous voulez respirer les humeurs des corps d’une époque révolue, les conseils bibliographiques donnés ici sont très bons, vous pouvez aussi allez faire un tour du côté d’Arlette Farge notamment « Effusion et tourment, le récit des corps » au XVIII siècle. Bonne lecture et au plaisir de vous lire.
Ping : Faire caca à Paris au XVIIIe sièc...
A reblogué ceci sur runglaz.
Ping : Faire caca à Paris au XVIIIe sièc...
Passionnant.
Et je peux vous répondre pour la rage de dent au 18ème si cela vous interesse.
Avec plaisir, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur l’hygiène dentaire au XVIIIe et XIXe mais sans trouver de sources suffisantes….
Pour continuer sur la thématique (!!) :
– Roger-Henri Guerrand. _Les Lieux_. Paris : La Découverte, 2009. http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_lieux-9782707157881.html
– Sabine Barles. _La Ville délétère : Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain. XVIIIe-XIXe siècles_. Paris : Champ-Vallon, 1999.
– Sabine Barles. _L’invention des déchets urbains. France : 1790-1970_. Paris : Champs-Vallon, 2005.
– Sa page web : http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article4693
En 1949, Bonnieux (84) les toilettes de notre deux pièces étaient…sur le balcon, au-dessus du vide et du ruisseau qui coulait 20 m plus bas. Notre voisine nous voyaient opérer de sa cuisine !
Dans le wagon SNCF du retour, les toilettes donnaient directement sur la voie. Je me suis toujours interrogé sur la triste situation des cheminots qui travaillaient à remblayer les traverses.
En 1964 à Cordemais(44).Nous avions le luxe d’une cabane « à deux places » au fond du jardin.
Ceci pour les jeunes générations qui n’ont pas connu cette merveilleuse époque où le « progrès », si l’on peut dire, n’existait pas encore!
Il y avait chez mon arrière grand père un « cabinet » au fond du jardin. Enfant, je ne comprenais pas trop pourquoi c’était en dehors de la maison mais je m’amusais toujours de l’histoire d’un vieil oncle qui avait confondu son chapeau claque et le couvercle du trou.
A Veneux les sablons (77), mes grands parents ont loué de 1920 à leur mort en 1974 un logement sans WC ni salle d’eau ni chauffage central. Les « commodités » étaient dans une cabane au fond de la cour, avec un broc et du papier journal. Pour la nuit, le seau hygiénique ou le pot de chambre vidés tous les matins. La vidange se faisait tous les ans par une entreprise extérieure. N’ayant jamais rien connu d’autres, ils ne m’ont jamais semblé en souffrir. Moi, gamin, je faisais avec, sans m’en étonner vraiment.
Enfin un article à chier, franchement bien torché! 🙂
A quand le papier hygiénique numérique ? Une pub récente affirme que le papier aura toujours au moins cette utilité là de nous permettre de nous torcher. Voilà qui console quant à l’avenir du livre papier.
Voilà une remarque qui m’amuse beaucoup!
… notamment avec la presse de gauche !
Ping : Avant la Concorde et l’Obélisque, la place Louis XV | Orion en aéroplane
Apparemment, la défécation fait défection…
Très instructif !
Ping : Mais quelle odeur avait Paris au XVIIIe siècle ? - Louvr'Boîte
Mon père (enfin! je ne sais pas trop s’il l’était vraiment), passé l’an 2000, donc au 21e siècle, natif du hame ou home de Faleize en Örmandie (Calvados), chiait & pissait encore dans un seau, ou pot de chambre. Il exigeait expressément d’un avoir un pour la nuit.
Lors d’une courte visite chez moi, je ne lui ai trouvé qu’un vieux seau un plastique, sans couvercle. Forcément, étant incontinent à 70 ans & certainement bien avant, grincheux & acariâtre de naissance, mes deux parents gardaient toujours un gros pot de plastique jaune assez épais, avec couvercle, dans leur chambre, pour leurs besoins urgents. Les vécés n’étant qu’à 2m70 en dessous de l’étage du coucher. Mais quelle différence entre un bosc ou buck, brau à pisse & undit « wc chimique », très en vogue dans les masures, cabines, caravanes, campings, & autres hars, cars, & lieux ou places de débauches à touristas (voir staphylocoquilles, coques, conches, & coqs, des poules & des cocus, pas « oizau ni oison, oisel » mais sisi, quine, zizi, job & jobart, voir « pipe, pipo », un polyteknoschien, politechnique, idem apollon, destructuin refus, manures; des con, pluriel de ci [ki] saillir ,saisir, attraper, mordre; un chien, gentil kiki). Le Français est un attardé rompu & corrompu comme Calottin, il aime la pouacritude ou romanité. Le paultr lui sied si bien kil en fect son sis (siège, schièse, chasse, chauce, chaise), son trône de France.