Après l’immense succès du premier billet croisé sur Paris et les excréments, Marine et moi réitérons l’exercice autour du thème de la Révolution. Sur le blog « Raconte-moi l’histoire », Marine parle des portraits des Capitouls tandis que je vous dévoile quelques détails surprenants sur la démolition de la Bastille.
Tout le monde sait que la Bastille a été prise le 14 juillet 1789 et que cet événement marque le début de la Révolution française… Mais saviez-vous que la Bastille aurait quand même disparu, même sans la Révolution ? Louis XVI avait en effet prévu de la raser…

On va raser la bastille, ce truc vieux qui coute cher
Révolution ou pas, la célèbre prison de la Bastille n’avait, en 1789 plus que peu d’années à vivre. Construite entre 1370 et 1383 pour défendre l’est de Paris, la Bastille appartenait à l’enceinte fortifiée de Charles V. Sise à proximité immédiate de la Porte Saint-Antoine, la forteresse de la « Bastille Saint-Antoine » avait la double fonction de sécuriser la route entre Paris et le château de Vincennes – dont le donjon a été élevé dans les mêmes années – et de protéger le roi en cas de révolte du peuple. Très rapidement cependant, la forteresse s’est révélée être une défense militaire assez médiocre. Le pouvoir l’utilisa dès lors à d’autres fonctions : entrepôt d’armes sous François Ier, coffre fort sous Henri IV et prison d’Etat sous Louis XI.
Du XVIe au XVIIIe siècle, c’est surtout à cette dernière fonction de prison que la Bastille a été employée. Si l’histoire à surtout retenu les prisonniers renommés (Prince de Condé, Marquis de Sade, Montaigne, Voltaire… qui y étaient d’ailleurs plutôt bien traités), on y trouvait également, à partir du règne de Louis XIV des prisonniers issus du peuple, coupables de crimes de lèse-majesté ou de « faits de lettres » (auteurs, imprimeurs…).

A la fin du XVIIIe siècle, la prison n’est plus très fréquentée : 306 prisonniers y ont séjournés durant les quinze premières années du règne de Louis XVI (une broutille par rapport aux 1459 prisonniers des huit années de la Régence). En juillet 1789, seuls sept prisonniers demeurent dans les murs de la forteresse : quatre faussaires en attente d’un jugement, deux fous et un noble placé là par sa famille.
Quasi vide, la Bastille est donc promise à la démolition. Louis XVI, dans un souci d’économie (la France en avait bien besoin !) avait en effet décidé de se débarrasser de quelques vieux bâtiments inutiles et dont l’entretien coûtait très cher. A savoir : la Bastille, le château de Vincennes et… la Sainte Chapelle. La Révolution va s’en charger – et gratos qui plus est (mais qu’à moitié, et heureusement pour Vincennes et la Sainte Chapelle).
La prise de la Bastille, entre réalité et mythe
La prison de Bastille, symbole de l’oppression royale, est prise par le peuple parisien le 14 juillet 1789. Ca c’est ce que l’on apprend dans les bouquins. La vérité est un peu plus complexe !
Le 14 juillet 1789, la Bastille ne retient que sept prisonniers et une garnison d’une petite centaine d’hommes. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Pourquoi donc s’être donné tant de mal pour s’en emparer ? Car le vrai enjeu de la Bastille, ce n’était pas les prisonniers… Mais la poudre!

A l’été 1789, la situation politique est très tendue en France : les Etats-Généraux sont en plein débats, des troupes étrangères menacent Paris, le pain n’a jamais été aussi cher et la famine menace. Le 14 juillet, des émeutiers s’emparent des 35000 fusils entreposés aux Invalides. Armés, ils ne disposent cependant pas de munitions : ils se dirigent alors vers la Bastille où sont entreposés depuis peu de grandes quantités de poudre. La forteresse est assiégée par le peuple de Paris. Il n’est, au début, absolument pas question de la prendre par la violence : plusieurs délégations se rendent auprès du gouverneur de la Bastille, De Lannoy, pour négocier. Ils exigent qu’on leur remette les réserves de poudres mais également que le gouverneur fasse retirer les canons, pointés depuis plusieurs heures vers le populaire faubourg Saint-Antoine. Les négociations échouent, la situation s’envenime et à dix-sept heures, la garnison de la bastille rend les armes. Quelques heures plus tard, le gouverneur de la Bastille est exécuté par la foule, alors qu’on le conduisait dans Paris.
Si la Bastille est aujourd’hui l’un des mythes fondateurs de la Révolution, elle le doit beaucoup aux historiens du XIXe siècle – au premier rang desquels Michelet – et à l’imagerie pré et post révolutionnaire, qui ont véhiculé et amplifié la légende noire de la Bastille, symbole honni de l’arbitraire royal.
La machine à souvenirs : Palloy, la démolition et les produits dérivés
Quant à la démolition de la Bastille, elle intervient très vite après la chute de la forteresse: en novembre 1789, il n’en reste déjà plus que les fondations. Dès le 15 juillet, un entrepreneur prend l’initiative de démanteler la Bastille : il s’appelle Pierre-François Palloy et est plutôt doué en affaires. Il emploie près de 800 ouvriers pour démonter pierre par pierre les murs de la Bastille. Si une grande partie de ces pierres a servi à la construction du pont de la Concorde, Palloy a eu une autre bonne et lucrative idée : proposer des « objets dérivés » commémoratif de l’événement.

Il fait sculpter, dans les pierres même de la forteresse, des miniatures de la Bastille, qu’il commercialise. Il envoie également dans les grandes villes de province des maquettes du bâtiment pour porter la bonne parole révolutionnaire. Avec les chaines de la prison, il fait faire des bijoux, des tabatières et des médailles, dont plusieurs exemplaires sont conservés dans les collections publiques. Comme quoi on n’a rien inventé avec le commerce des vestiges du mur de Berlin !
Certains de ces « produits commémoratifs » de Palloy sont à découvrir dans les salles du Musée Carnavalet. Quant aux touristes qui cherchent désespérément la forteresse à l’emplacement de la colonne de Juillet (véridique!), ils peuvent apercevoir quelques vestiges archéologiques dans les souterrains de la station de métro Bastille.
Merci au C.M. du Musée Carnavalet dont l’aide m’a été précieuse dans la rédaction de ce billet. N’hésitez pas à suivre le fil twitter et la page facebook du musée pour des surprises quotidiennes!








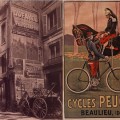


Les circonvolutions des pavés de la place de la Bastille rappellent l’emplacement de celle-ci.
Vous auriez pu citer Sade, en passant !
Je réserve ça pour un hypothétique billet sur la légende noire de la Bastille!
Nous aimons beaucoup les “symboles » quand nous nous intéressons à l’histoire, or curieusement nous n’imaginons pas une seule seconde que le symbolique puisse jouer un rôle dans le futur.
Nota
à destination du commentateur précédent: Sade est cité… en passant… relisez.
Ping : L’art et la Révolution, portraits des condamnés | Raconte moi l'Histoire
Ping : La machine à produits dériv&eacut...
Ping : La machine à produits dériv&eacut...
Décidément, j’adore l’impertinence (j’aime l’écrire parce que c’est désuet) de vos articles. Bravo d’aller fouiller du côte du musée Carnavalet! Bien à vous
C’est là qu’on se rend compte que l’exploitation du patrimoine culturel à des fins commerciales ne date pas d’hier, mais Palloy avait plus d’ingéniosité pour concevoir ses objets dérivés, que n’ont les boutiques de monuments aujourd’hui.
Merci pour ce billet !
Ping : Avant la Concorde et l’Obélisque, la place Louis XV | Orion en aéroplane
Ping : Révolution | Pearltrees