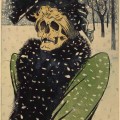Si l’oeuvre peint et dessiné de Claude Gellée, dit Lorrain (1600-1682) est très exposé, commenté et admiré, ses estampes demeurent confidentielles. Elles sont certes peu nombreuses (44 à 51 selon les catalogues) mais figurent parmi les chefs-d’oeuvre de l’eau-forte libre : Le Lorrain y démontre une inventivité technique et esthétique exceptionnelle.
Jusqu’au 7 juin 2015, un accrochage du Petit Palais permet de découvrir une vingtaine d’estampes du Lorrain.

L’essentiel de l’œuvre gravé de Claude Gellée date des années 1630-1636. Le peintre est alors au début de sa carrière : il vient de s’installer définitivement à Rome, où il a passé une grande partie de son adolescence avant de rentrer brièvement dans sa Lorraine natale. S’il ne peint pas encore les grands paysages lumineux qui feront son succès, la campagne romaine est déjà son motif de prédilection. Elle sera le sujet principal de ses estampes, parfois réalisées d’après ses peintures. L’eau-forte lui apparaît probablement comme un moyen de diffuser ses compositions et de se faire connaître. Moins onéreuse que la peinture, l’estampe touche une clientèle plus large et offre des revenus réguliers.
Néanmoins, même si il lui arrive d’interpréter par la gravure ses propres peintures, Claude Gellée ne relègue pas l’estampe au rang de substitut du tableau, d’image de l’image. Au contraire, il la considère comme un moyen de création autonome à part entière.
Mais comment rendre les effets du soleil, le délicat jeu chromatique de la lumière, avec les seules ressources du noir et du blanc ?

Un virtuose de l’eau-forte
L’eau-forte bénéficie alors d’une innovation technique : autour de 1615, le graveur Jacques Callot a eu l’idée de substituer au vernis mou, habituellement employé par les graveurs, celui des luthiers, plus dur, et qui, par conséquent, offre des morsures plus régulières et plus précises. Les artistes graveurs adoptent très vite cette astuce. Peut-être Claude Gellée connaissait-il personnellement Jacques Callot, un Lorrain installé en Italie, comme lui. En tout cas, il a copié quelques-unes de ses estampes et sa manière de travailler par plans successifs de plus en plus légèrement mordus pour rendre l’effet de profondeur en jouant sur les contrastes lumineux, se rapproche de celle de Callot.
Chose rare, divers tirages d’essai sont connus : ils témoignent des progrès rapides de l’artiste dans la maîtrise de la pointe. Dès 1630, Claude Gellée développe une écriture libre et audacieuse.

Dans sa quête pour traduire les effets atmosphériques, il n’hésite pas à expérimenter des pratiques peu orthodoxes. Ainsi, pour donner un effet de ton au ciel de la Danse villageoise, il mord directement la plaque à l’aide d’un pinceau chargé d’acide. Le résultat ne donnant pas satisfaction, il joue par la suite avec l’encrage des matrices : dans Le Naufrage, une estampe postérieure, un essuyage incomplet de l’encre renforce le caractère dramatique du sujet.


Ses recherches le conduisent parfois à multiplier les états d’une même planche jusqu’à la demi-douzaine, avec des variations importantes dans la composition ou le rendu.
C’est autour de 1636 que l’œuvre gravé du Lorrain atteint son apogée. Cette année là, il grave une scène pastorale baignée d’une belle lumière estivale de fin d’après-midi. Cette estampe, intitulée Le Bouvier, est considérée comme l’une de ses plus belles pièces et sera très diffusée de son vivant. Les premiers tirages témoignent du raffinement de sa technique : selon les spécialistes, Le Lorrain aurait préparé son cuivre à la pierre ponce pour rendre la surface plus rugueuse, puis aurait accentué les effets lumineux au grattoir.

Aux limites de la technique
Pourquoi, alors que ses estampes étaient bien accueillies, cesser de graver ? Au milieu de la décennie 1630, ses tableaux rencontrent un succès croissant et Le Lorrain est accaparé par les commandes, ce qui lui aurait laissé peu de temps pour s’adonner à l’eau-forte, malgré son intérêt pour ce médium (il possédait une presse chez lui ! ). Il y revient cependant brièvement en 1650 et réalise quelques pièces avant de tomber gravement malade. Il vivra encore 20 ans, mais ne reprendra jamais la pointe, sa santé devenue fragile l’empêchant de supporter les acides.
Une autre explication peut également éclairer cet arrêt brutal dans son œuvre gravé : probablement l’artiste avait-il le sentiment d’avoir atteint les limites du médium ; les morsures légères et l’abrasion directe qu’il employait pour rendre ses délicats effets d’atmosphère étaient trop fragiles et s’usaient trop rapidement. En effet, l’observation des tirages conservés montre que les tailles les plus légères se bouchaient après quelques impressions, donnant un résultat peu satisfaisant.

De tels défauts n’ont cependant pas empêché l’exploitation de ses planches : au XVIIIe siècle, elles furent acquises par la chalcographie romaine, qui en exécuta des tirages posthumes jusqu’en 1816, à vrai dire assez médiocres.
À propos de l’exposition
L’accrochage temporaire du Petit Palais comprend une vingtaine d’estampes et quelques dessins du Lorrain. Les cartels consacrent une part importante à l’analyse iconographique. En revanche, ils explorent peu les aspects purement esthétiques et formels des planches. Les tirages qui illustrent cet article sont principalement ceux du Metropolitan Museum puisque ni la BnF ni le Petit Palais n’ont numérisés leurs estampes du Lorrain.