Il y a un mois, je vous emmenais sur le chantier d’accrochage de l’exposition « Fantastique ! L’estampe visionnaire de Goya à Redon » au Petit Palais. Il est temps maintenant de vous parler de son contenu.
Monstres, chimères, fantômes, squelettes… inquiétantes et étranges silhouettes qui se tapissent dans l’ombre des recueils d’estampes de la Bibliothèque nationale de France. Un peuple bizarre et trouble que Valérie Sueur Hermel, conservatrice en charge des collections XIXe siècle au département des estampes et de la photo de la BnF a voulu dévoiler au grand jour : tremblez, ils envahissent les cimaises du Petit Palais !

d’après Horace Vernet, Lenore. Ballade allemande de Bürger, Aquatinte, 1840, BnF
Le Fantastique imprime sa marque à travers tout le XIXe siècle. On sait l’engouement des hommes du temps pour le surnaturel et l’inconscient. Victor Hugo, comme bien d’autres intellectuels, s’adonnait au spiritisme de salon ; tables tournantes, apparitions et projections de l’inconscient ont inspiré multitude d’œuvres artistiques : textes littéraires, photographies, estampes…
L’estampe se prête bien à de tels sujets : imprimée en noir et blanc, elle exprime par sa nature technique même d’une tension entre l’ombre et la lumière. Par ses dimensions réduites, elle forme un médium privilégié à travers lequel l’artiste peut plus naturellement manifester son univers intérieur et projeter ses visions. Multiple et légère comme le papier qui la porte, l’estampe se prête enfin au caprice et à la fantaisie.
« l’eau-forte originale, c’est le caprice, la fantaisie, le moyen le plus prompt de rendre sa pensée » écrivait Alfred Cadart.
Estampe et littérature, le dialogue fécond du fantastique
En littérature, le début du siècle du XIXe siècle voit la naissance de la nouvelle fantastique autour d’Hoffmann et de Goethe. En France, Charles Nodier, Gérard de Nerval, Balzac et Théophile Gautier s’emparent de cette liberté nouvelle d’écrire. Tout au long du siècle, Edgar Allan Poe, Jules Barbey d’Aurevilly et Maupassant prolongent et renouvellent ce courant qui persiste.
Artistes et graveurs vont être très perméables à ces textes qu’ils illustrent ou dont ils s’inspirent : Victor Hugo est un sujet d’admiration majeur pour la région romantique. Louis Boulanger et Célestin Nanteuil, quand ils n’illustrent pas directement ses textes, y puisent leur motif et leur esthétique.

Chez Redon, la filiation et le dialogue sont revendiqués jusque dans le titre lorsqu’il compose son recueil qu’il intitule « Hommage à Edgar Poe ». Mais la littérature contemporaine est loin d’être la seule à irriguer l’esthétique fantastique : Shakespeare est une référence majeure pour la génération romantique. Delacroix n’a-t-il pas donné ses plus belles lithographies en illustrant le Macbeth ?

En terme de livres illustrés, le maître du siècle demeure Gustave Doré, qui poursuit des décennies durant le projet d’une vie : la constitution d’une bibliothèque idéale, sa bibliothèque idéale, où le conte et la fantaisie sont omniprésents. Tous sont prétextes à exprimer une imagination débordante. Le frontispice du Don Quichotte est à l’image de l’artiste qui l’a dessiné : « et son esprit s’emplit de tout ce qu’il avait lu » …

Les images, à leur tour, nourrissent la création littéraire. En 1814, Hoffmann intitule un de ses recueils Fantasie à la manière de Callot, faisant allusion aux célèbres Caprices gravés par l’artiste dans la première moitié du XVIIe siècle et très recherchés au cours du XIXe siècle.

Certains artistes sont très admirés par les écrivains, comme Charles Meryon, dont les estampes semblent l’équivalent plastique aux travaux de Baudelaire. Mais malgré les sollicitations répétées du poète et de quelques amis, jamais le livre qui aurait dû allier leurs talents ne paraîtra jamais.
Alors que l’image connaît une explosion sans précédent dans l’édition, facilitée par le progrès technique et l’invention de nouveaux procédés, l’illustration, désormais omniprésente, s’autonomise et supplante parfois l’écrit. Publiés en 1843 et 1844, Voyage où il vous plaira de Tony Johannot et Un autre monde de Grandville forment parmi les ouvrages les plus novateurs de cette liberté nouvelle accordée aux illustrateurs. Dans le premier cas, le texte d’Hetzel dialogue d’égal à égal avec les gravures de Johannot. Dans le second, Grandville revendique la paternité de l’histoire, Taxile Delord ayant rédigé son texte d’après les illustrations et non le contraire. De ces deux livres, qui furent des échecs commerciaux, la postérité a oublié les textes. En revanche, les images gravées figurent parmi les plus admirées de l’histoire de l’édition française du XIXe siècle.
Des motifs sans cesse réinventés.
Motifs et topoï fantastiques circulent d’une œuvre à l’autre et l’on observe une continuité forte dans la production à travers le siècle : sans cesse les mêmes sujets sont revisités, avec une inventivité extraordinaire. Si le parcours de l’exposition « Fantastique » suit une progression chronologique, l’accrochage n’est que jeux d’échos, de miroirs, où se dessine cette réinvention perpétuelle du fantastique à partir d’une culture partagée par tous. Les racines de ces motifs plongent loin dans l’histoire de l’art : Dürer, Callot, Piranèse, Goya sont des figures tutélaires de la veine fantastique dans l’estampe. La première salle de l’exposition nous offre une courte mais fabuleuse sélection de ces œuvres incontournables qui ont fécondé l’imaginaire : La Mélancolie, La tentation de Saint-Antoine, Les prisons, Le sommeil de la raison…
Si ces estampes marquent profondément la culture visuelle du XIXe siècle, rares sont les artistes qui ont pu admirer les tirages originaux. Au début du siècle, les œuvres de Goya, qui vont être si fondatrices pour les romantiques sont connues presque exclusivement par des reproductions. A Paris, les éditions des Caprices en possession d’amateurs et d’érudits se comptent alors sur les doigts d’une main et demeurent confinées à l’intimité des cabinets. Ce sont les interprétations populaires qu’en donnent quelques éditeurs qui vont assurer leur renommée : en 1825, Charles Motte fait paraître une série de lithographies copiant les Caprices de Goya ; neuf ans plus tard, le Magasin Pittoresque consacre un article à Goya, illustré de quelques reproductions sur bois dues à Grandville. Copiés avec plus ou moins de bonheur, ces motifs, perçus comme des caricatures, s’enracinent dans la culture visuelle du temps : Meissonnier fait référence au Sommeil de la raison dans la composition de la caricature qui paraît le 6 février 1834 dans Le Charivari et qui figure Louis-Philippe en proie à des « cauchemars ».
Si au début du siècle, Goya n’est connu que par de faibles reproductions, ses estampes circulent plus largement au fil des décennies : les estampes du maître espagnol ne sont plus considérées comme de simples « caricatures » mais pleinement reconnues pour leur inventivité plastique et leur maîtrise technique.
De cimaise en cadre, l’œil attentif démêle avec bonheur les fils de ces citations, hommages et réinventions. La femme endormie de Fusseli surgit au détour des caricatures d’un journal. Que doivent aux prisons de Piranèse les villes inquiétantes et grouillantes dont Gustave Doré fait le décor des aventures de Gargantua ? Bresdin a-t-il en tête le Saint-Eustache de Dürer lorsqu’il cisèle mille et un détail de ses planches ?
La question de la circulation des motifs à travers les publications populaires est très bien présentée dans l’exposition, ce qui est un de ses points forts.
La culture populaire est une autre influence méconnue et incontournable du romantisme noir. Ainsi, spectacles de bonimenteurs, projections lumineuses et baraquements de foire, livrets à deux sous et superstitions de campagne ont marqué de leur pittoresque la création artistique dite « intellectuelle ».

Inquiétudes du temps et miroir cruel de l’âme
Pour l’artiste, l’estampe et le fantastique sont moyens d’expression d’une individualité propre, une échappatoire face à un siècle de progrès qui se montre parfois inquiétant et cruel. Le Second Empire marque l’apogée du positivisme. Les élites partagent une croyance absolue en la marche du progrès et des sciences, mais la société demeure parcourue de spasmes inquiétants : la misère touche une partie importante de la population, les révoltes grondent cycliquement. Le genre fantastique est alors un subterfuge pour exprimer une inquiétude latente face aux inégalités et injustices de la société.
Chimères et projections de l’esprit entrent en dialogue avec le réel : chez Charles Meryon, les figures qui peuplent le ciel de leur ombre menaçante sont-elles des allégories à la symbolique complexe ou l’expression des tourments qui hantent l’artiste, en proie à de graves troubles psychologiques?


Même chez des artistes réputés réalistes, le fantastique surgit parfois : le chef-d’œuvre absolu de l’aquafortiste Braquemond, Le Haut d’un battant de porte apparaît comme une énigme inquiétante autant qu’une étude animalière confondante de précision.
Si le fantastique s’invite chez les artistes les plus réalistes, on peut aussi être surpris de découvrir que les chantres du romantisme noir se sont inspiré des progrès de la science dans leur recherche plastique, à l’image de Redon, qui se montre attentif aux théories évolutionnistes et au monde microscopique, que les nouveaux instruments optiques permettent enfin de toucher. L’imagerie scientifique, qui connaît alors un développement sans précédent nourrira ses recherches graphiques.
Chez les symbolistes, notamment belges, le fantastique est une voie pour formuler une critique acerbe de la société fin de siècle et de ses décadences : la mort et la maladie se cachent sous le masque de la femme fatale, que l’on retrouve dans de nombreuses estampes, notamment chez Félicien Rops. Les maladies vénériennes planent sur les fêtes endiablées d’une époque qui s’éteint.
Pourquoi les graveurs du XIXe siècle ont-ils été si nombreux à chérir la veine fantastique ? Peut-être parce qu’elle offrait un champ d’expérimentation esthétique inédit : toutes les estampes présentées dans l’exposition sont de petites merveilles de raffinement technique et d’inventivité plastique. Probablement aussi parce qu’elle était un lieu de dialogue et d’hommage, où l’artiste pouvait marquer des filiations fortes avec les graveurs qui l’avaient précédé. Enfin, il est indéniable que le médium de la gravure, combiné au sujet fantastique, offrait aux artistes le support d’une réflexion intime où pouvait presque librement s’exprimer leur nature intérieure, sous le couvert de la fantaisie et de l’imagination.

Présentée au Petit Palais jusqu’à janvier 2016, cette exposition est une occasion délicieuse et malheureusement trop rare de s’approcher de quelques unes des plus belles pièces du XIXe siècle, habituellement conservées dans les magasins de la BnF, dérobées aux regards et protégées des vicissitudes du temps. Il est cependant dommage qu’une place plus grande n’ait pas été laissée à la médiation écrite : l’absence de cartels détaillés rend difficile pour le public néophyte de saisir toutes les références, notamment littéraires. Aussi ne faut-il pas hésiter à profiter des visites avec conférenciers ou des activités, heureusement très nombreuses.




![Deveria_Sommeil_Goya Achille Devéria d'après Goya, "Le sommeil de la raison produit des monstres", lithographie parue dans Carricatures espagnoles [sic], 1825, BnF](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2015/11/Deveria_Sommeil_Goya.jpeg?w=370&h=522&ssl=1)










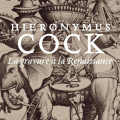



Ping : Exposition « Fantastique ! Kuniyoshi du 1er octobre 2015 au 17 janvier 2016 au Petit Palais | «Mes Madeleines
Ping : Odilon Redon, prince du fantastique - Le Bordographe
Ping : Supernova juice 19/11/2015 • Inspiration • La Lune Mauve