Elle fut l’une des plus belles femmes de son temps. L’une des plus haïes également. Courtisée, adulée, jalousée, la Comtesse de Castiglione a défrayé les chroniques mondaines du Second Empire, notamment à cause de sa courte liaison avec Napoléon III.
Sans doute la Comtesse de Castiglione aurait-elle été oubliée de tous si elle n’avait pas laissé derrière elle quatre cents clichés la mettant en scène. Des images atypiques, par leur nature et leur destination, mais qui ne dévoilent presque rien de l’intimité de cette femme mystérieuse, et pour cause : toute sa vie, elle s’est employée à construire un personnage fictionnel. C’est ce qui explique que la « Dame de cœur » intrigue encore autant aujourd’hui…

De sa beauté, la Comtesse de Castiglione a toujours tiré fierté, sinon orgueil. Dès l’enfance, la jeune Virginia Oldoni Verasis (1837-1899) a été courtisée. Issue d’une noble famille florentine, elle est mariée à dix-sept ans avec un comte, Castiglione. Le mariage ne sera qu’éphémère, mais le nom restera : il était taillé pour le mythe.
De Florence à Paris, la Comtesse de Castiglione en intrigante
En décembre 1855, le jeune couple est envoyé en France, officiellement pour une visite de courtoisie à une cousine, Marie-Anne Walewska. En réalité, il s’agit d’une véritable intrigue diplomatique : la comtesse est commanditée pour obtenir le soutien de l’empereur des Français à la cause italienne face à la menace autrichienne. On sait Napoléon III friand de belles femmes et le minois de la jeune Italienne a plus de force de persuasion que tout diplomate.
Le 9 janvier 1856, la Comtesse est présentée à Napoléon III lors d’un bal. Un mois plus tard, ils entament une liaison, qui défraie la chronique, tant l’Empereur ne s’en cache pas, à quoi s’ajoutent les frasques de la jeune femme. Lors d’une fête champêtre, il s’isole pendant plusieurs heures avec elle, sous les yeux de l’impératrice, qui s’en trouve fort humiliée.

Liaison, certes, mais de courte durée : le 6 avril 1857, en pleine nuit, alors que Napoléon III quitte le domicile de la comtesse, il est victime d’une tentative d’attentat avenue Montaigne. On accuse l’Italienne d’avoir conspiré, et la Comtesse est bannie de la cour impériale. Il est aujourd’hui assez clair qu’elle n’avait rien à voir avec le complot et que ce dernier a servi de prétexte grossier pour éconduire cette amante devenue encombrante.
Le comte de Castiglione, qui jusqu’alors avait fermé les yeux sur la conduite de son épouse, demande le divorce, qu’il obtient. Presque ruiné, il rentre en Italie, et laisse à la Comtesse son titre et son nom. Elle quitte à son tour la France pour quelques années, avant de revenir s’installer à Passy en 1861 : elle demeurera à Paris jusqu’à sa mort, à l’exception des années 1870-1872, où, fuyant la chute de l’Empire et la Commune, elle se réfugie dans son pays natal.
Une figure atypique de l’histoire de la photographie
Il est probable que la Comtesse de Castiglione n’aurait laissé qu’une maigre trace dans les chroniques du Second Empire si elle n’avait pas elle-même écrit une part de sa légende au moyen de la photographie. Pendant quarante ans, elle s’est fait photographier dans des costumes et mises en scène singulières, cherchant à fixer sur le papier la trace éphémère de son existence, à magnifier sa beauté et sa présence. Une démarche originale, d’une modernité étonnante, qui aujourd’hui encore laisse les historiens perplexes. Atypique, « l’œuvre » photographique de la Comtesse demeure unique et inclassable. Et fascinant.
Tout commence en juillet 1856, date à laquelle la jeune Italienne, fraîchement débarquée à Paris, rend visite au studio photographique d’Heribert Mayer et de Louis Pierson, réputé dans les milieux mondains. Elle réalise une première série de photographies, très conventionnelle. Mais très vite, les séances prennent une tournure inédite, qui brise les cadres normés du portrait photographique.

Désormais, elle ne s’adressera plus à l’atelier : Pierson est devenu son photographe attitré. Il ne joue cependant qu’un rôle d’opérateur : c’est véritablement la Comtesse qui orchestre les séances de pose. Elle choisit les mises en scène, les attitudes, les retouches à réaliser sur les négatifs et les épreuves : elle est l’âme de la photographie.
Un certain art de la mise en scène
Ces images fixées sur le papier, comme ses apparitions dans le monde, n’ont rien de conventionnelles : elles ne sont que mises en scène, spectacle d’elle même. Dans les bals et dîners mondains où elle est invitée, Castiglione arrive toujours en retard, se fait contempler dans des parures surprenantes et parfois très osées. C’est dans les bals costumés qu’elle révèle le meilleur de son art. Son imagination n’a pas de limite : Dame de Coeur, Reine de la Nuit, Amazone, Beatrix… Toujours plus fou, toujours plus ostentatoire !
Son costume resté le plus célèbre est celui de « Dame de cœur » qu’elle porte pour un bal au ministère des Affaires étrangères en février 1857. Sa robe en organdi transparente laisse deviner ses formes : un cœur, placé à un endroit équivoque, souligne son sexe. L’impératrice, devant ce spectacle, lâchera, sèchement : « il est un peu bas, Comtesse ».
Mais la comtesse se fiche des mauvaises langues : c’est le scandale qui fait parler d’elle ; la jalousie qu’elle suscite est une consécration. Et elle fait tout pour se faire détester.
Au lendemain de chacun de ses coups d’éclat, la Comtesse se rend chez son photographe pour immortaliser son costume. Mais il ne s’agit pas de sagement poser comme un mannequin pour faire ressortir l’éclat de sa toilette : non il s’agit de véritablement raconter une séquence narrative, de se mettre en scène, d’irradier de sa présence.
Bien qu’appartenant au monde de la cour, la Comtesse ne dédaigne pas de s’inspirer des demi-mondaines, des femmes de spectacle, qui s’emparent elles aussi de la photographie à la même époque. Il arrive à Castiglione de s’inspirer de leurs excentricités, de leurs costumes ou encore de leur jeu d’actrices. Elle pousse jusqu’à la suggestion érotique, voire pornographique. Elle n’hésite pas à se montrer en déshabillé, voir à dévoiler ses jambes nues, ce qui ne se fait évidemment pas à l’époque.
D’ailleurs, depuis son divorce, Castiglione partage avec les demi-mondaines la nécessité d’avoir des amants pour maintenir son train de vie. En cela, tout cela, elle bouscule les règles établies et les hiérarchies figées de la société du Second Empire.

Images de soi, image pour soi, écrire un mythe
Quatre cents clichés… Le chiffre donne le vertige. Mais pour qui, à qui s’adressent ces images ? À elle-même d’abord : elle écrit une biographie personnelle, fictionnelle, une version romancée de sa vie. Contrairement aux femmes du demi-monde, pour qui la photographie est un support de diffusion de leur image et de succès populaire, la Comtesse ne commercialise pas ses clichés, qui restent dans le cercle intime. Tout au plus envoie-t-elle quelques images à ses amants ou admirateurs. En 1867, néanmoins, certaines photographies sont présentées à l’exposition universelle, où elles sont remarquées.
Aujourd’hui, nous connaissons surtout les photographies en noir et blanc montrant la Comtesse de Castiglione dans le studio du photographe, qui nous apparaissent d’une modernité surprenante. Mais ces clichés admirés ne sont pas le produit fini que la Comtesse souhaitait laisser à la postérité : ils ne sont qu’une étape, un état transitoire, un document de travail. Ces images, la Comtesse les faisait retoucher, enluminer, coloriser. Le résultat apparaît à notre goût du XXIe siècle un peu douteux, sinon carrément kitch. Au XIXe siècle, en revanche, la pratique était des plus courantes : la bonne société appréciait les photographies peintes, sur lesquelles les défauts étaient retouchés, les couleurs restituées. Carnation, chatoyance des tissus : le pinceau fin et appliqué de l’aquarelliste venait animer la photographie, qui rivalisait alors avec le portrait peint, nécessairement plus onéreux.

Mais si les retouches consistaient habituellement en de ponctuelles corrections du négatif et en des mises en couleurs assez conventionnelles, la pratique de la retouche devient, avec la Comtesse de Castiglione, complètement originale, extraordinaire.
Après la séance de pose, la Comtesse se fait livrer les tirages, sur lesquels elle indique les retouches à effectuer, les couleurs à adopter. Il faut parfois modifier, amplifier sa tenue, masquer les murs de l’atelier derrière un décor fantaisie. Si la pose était déjà narrative, la retouche et les titres donnés aux photographies renforcent le caractère narratif de ces images. Ainsi, lorsqu’elle pose pour La Frayeur, elle a déjà en tête l’image de l’incendie d’une salle de bal qu’elle fera peindre sur le cliché. De même, la pose mélancolique de Beatrix ne se révèle qu’une fois dégagée du décor banal du studio du photographe.
Le spectre de la mort
Mais le temps, inexorablement, rattrape cette femme dont tout Paris envie la beauté. Tombée en disgrâce, elle s’en relève bien mal. Son existence a été marquée de coups rudes : en 1857, suite à l’attentat raté contre Napoléon III, elle injustement bannie de la cour. Revenue en grâce en 1863, elle apparaît à nouveau aux Tuileries, mais ne concentre plus l’intérêt comme autrefois. La chute du Second Empire et de son univers est un drame personnel.

La vieillesse est un drame pour la Comtesse, qui, face à ce corps qui décline, sombre dans la dépression. Dans les années 1880-1890, elle vit recluse dans un petit appartement du quartier Vendôme, aux volets toujours clos et aux miroirs cachés de tentures. On colporte qu’elle ne sort plus que la nuit, pour promener ses chiens qui concentrent toute son affection. Seuls quelques amis, dont son médecin, la fréquentent encore et la soutiennent quand elle est dans la gène.
Après vingt ans d’absence (elle a cessé de se faire photographier en 1867), elle revient derrière l’objectif du photographe Pierson, qui lui est resté fidèle. En 1893, nostalgique des fêtes de l’Empire, de sa beauté fanée, elle revêt à nouveau ses costumes d’autrefois, pieusement conservés mais dont l’éclat s’est défraichi.
Photographies poignantes, un peu désolantes, qui trahissent la tragédie : en proie à des troubles psychologiques, la Comtesse fait des crises de démence. Son narcissisme ne l’a pas quittée… En 1894, comme trente ans plus tôt, elle fait photographier ses jambes, nues : mais la pose n’est plus celle d’une jeune femme, la mise en scène évoque plutôt le gisant.

Sentant ses derniers jours venir, elle tente un ultime coup d’éclat en organisant une exposition de ses photographies sous le titre « la plus belle femme du siècle ». Un projet qui n’aboutira pas… Il faudra attendre un siècle pour qu’un tel hommage lui soit rendu.
La Comtesse de Castiglione s’éteint dans le dénuement de son minuscule trois-pièces en 1899. Même l’Italie refuse son corps : elle est donc enterrée sobrement au père Lachaise. Ses dernières volontés ne seront pas respectées : elle avait demandé à être mise en terre vêtue de la chemise de nuit qu’elle portait lors de sa première nuit d’amour avec l’Empereur à Compiègne et accompagné de ses petits chiens empaillés. Tous ses souvenirs, photographies, vêtements seront venus aux enchères, collectionnés par d’anciens admirateurs et de nouveaux fétichistes, parmi lesquels Montesquiou, qui lui vouait un véritable culte.

Sa légende ne fait que grandir, alimentée par des publications régulières, souvent romancées. Mais c’est la recherche en histoire de la photographie, en vogue depuis les années 1970, qui permet de réécrire, sur un ton plus juste, l’histoire de sa vie. La Comtesse de Castiglione peut-elle recevoir le titre de pionnière de la photographie moderne, tant ses images préfigurent les développements de la photo de mode et de la photo autobiographique ? Rien n’est moins sûr : elle n’est qu’une créatrice accidentelle…
Pour aller plus loin : Le Metropolitan Museum de New York conserve la plus importante collection de photographies de la Comtesse de Castiglione : c’est dans cette institution que j’ai pioché les images qui illustrent ce billet. La meilleure publication francophone sur le sujet demeure le catalogue de l’exposition qui s’est tenue en 1999 au Musée d’Orsay. Dernièrement, France Culture a consacré son émission Une vie, une oeuvre à la Comtesse de Castiglione : c’est à réécouter ici.














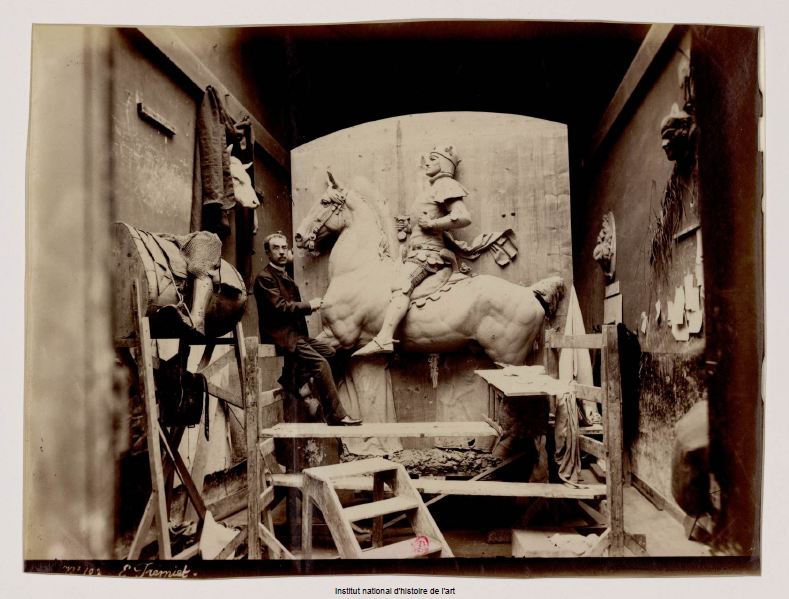




Merci de m’avoir fait découvrir ce personnage fantasque dont je ne connaissais que vaguement le nom !
« Pour aller (encore !) plus loin » on peut également lire le livre que Nicole G. Albert a consacré à la Castiglione : « La Castiglione. Vies et Métamorphoses » (Perrin, 2011). Elle relie notamment sa biographie à ses choix de mises en scène photographiques.
Très bon article, sur cette femme passionnante !
Rake – Townes Van Zandt
https://www.youtube.com/watch?v=sx4PsxUvMqY
Bonjour, Monsieur
Rédigeant une histoire de ma famille (Roanne, autour de 1900), je viens de relire cette page (délicieuse !) qui m’intéresse beaucoup. A priori, Napoléon III était à Roanne le 9 avril 1857 pour un banquet (j’ai le menu en main) mais n’ai pas encore trouvé d’où venait ce renseignement. Puis-je vous demander la source qui vous a permis de détailler cette « affaire » du 6 avril ? Viendrait-elle de cet inventaire des voyages de Napoléon III conservé aux Archives Nationales ? je vous remercie très vivement d’avance pour votre réponse. Cordialement, Ep