Paris est une des destinations les plus prisées des touristes : chaque année, ils sont des millions à fouler le trottoir des Champs-Elysées, les parquets du Louvre et les pavés de Montmartre, irriguant tout un pan de l’économie française. Alors que les récents attentats inquiètent sur la vitalité du secteur, la galerie des bibliothèques de la ville propose un regard sur trois siècles d’histoire du tourisme dans la capitale.

Je ne pouvais pas rater cette exposition qui croise plusieurs de mes centres d’intérêt : l’histoire de Paris, mais aussi l’histoire du tourisme, pratique qui m’interroge continuellement depuis que je voyage moi-même. En 2014, dans le cadre de mon master à l’École des Chartes, j’avais travaillé sur les guides de Paris au XVIIIe siècle ; la rencontre avec Damien Petermann, doctorant qui consacre ses recherches aux représentations des villes à travers le tourisme avait achevé de me passionner pour ce champ d’études.

À l’origine du tourisme (XVIIe-XVIIIe siècle)
Si la pratique touristique telle que nous la connaissons est née progressivement au cours du XIXe et du XXe siècle à mesure d’innovations techniques (l’amélioration des conditions de transport) et d’évolutions sociales (congés payés, augmentation du niveau de vie), il existe dès l’Ancien Régime une forme de proto-tourisme, connue sous le nom de Grand Tour (d’ailleurs à l’origine du mot « touriste »).
La pratique du Grand Tour naît à la fin du XVIIe siècle en Angleterre : il est de bon ton, pour un jeune homme de la haute société d’aller parfaire son éducation en visitant les grandes capitales européennes et les ruines antiques en Italie. Grand Tour mondain et intellectuel, qui se double souvent de la découverte des plaisirs de la chair. Paris est, dans ce circuit, une étape : on vient découvrir les collections fameuses, fréquenter les salons des Lumières, mais aussi les tentations de la nuit, notamment au Palais Royal, connu pour ses lieux de plaisir et de débauche.
Au XVIIIe siècle, difficile de distinguer le tourisme d’agrément d’autres pratiques de voyage : les motivations qui poussent à venir à Paris s’entremêlent souvent : raisons professionnelles, mondaines, culturelles.

Dès le XVIIe siècle, apparaît une nouvelle forme éditoriale, que l’on regroupe aujourd’hui sous l’appellation de « guides de Paris » : dérivé des histoires des Antiquités et des indicateurs des rues, ces livres présentent au lecteur de passage ou au parisien de longue date les principaux points d’intérêts de la capitale : curiosités architecturales, collections remarquables… Certains de ces livres se doublent de renseignements pratiques sur les maisons où loger, l’attitude à adopter dans telle ou telle situation, les lieux à fréquenter et ceux à éviter. Guide de promenade, guide de savoir-vivre, le guide de Paris est polymorphe. Pour le chercheur du XXIe siècle, c’est une source essentielle sur la ville à l’époque moderne. Quelques titres sont exposés dans la première partie de l’exposition, mais ces livres pourraient à eux seuls faire l’objet d’une exposition !
Venir à Paris du XIXe siècle à nos jours
Si l’exposition évoque rapidement le tourisme parisien au XVIIIe siècle, c’est surtout sur la période 1850-1950 qu’elle se concentre. Deux facteurs ont largement contribué à l’augmentation du tourisme au cours de la seconde moitié du XIXe siècle : l’émergence d’une classe bourgeoise, qui aspire aux mêmes pratiques de distinction que les aristocrates et l’amélioration notable des conditions de transport avec l’apparition et le développement rapide du chemin de fer.

Voyager de la province à Paris et des grandes capitales à Paris devient plus rapide et moins dangereux. Après la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre dans les années 1840, on inaugure des liaisons régulières avec Londres, via le train et le ferry. Les voyageurs en provenance du Nouveau Monde arrivent par les grands paquebots transatlantiques, qui font escale au Havre.

Les trains qui transportent les touristes, de Paris aux stations balnéaires et des stations thermales à Paris sont appelés les trains de plaisir. Les belles affiches colorées et les encarts publicitaires, nombreux dans les collections des bibliothèques, nous en transmettent le souvenir quelque peu nostalgique.
Face à l’afflux grandissant des « touristes », un marché se structure. On voit apparaître les premières agences de voyages (Thomas Cook est le premier à imaginer les voyages organisés en 1845 !) De nouveaux emplois naissent. De nouveaux lieux aussi, les palaces, les gares, aussi belles que des palais. Car le tourisme est encore un plaisir réservé à une certaine élite sociale.

Itinéraire d’un touriste à Paris
Que vient chercher le touriste à Paris ? De multiples choses. Les beautés de son patrimoine : le Louvre, les musées, les monuments, le foisonnement intellectuel. Le Luxe : les grandes maisons de couture, les boutiques d’articles de Paris. Les plaisirs de la Ville Lumière : ses cafés, ses restaurants, ses cafés-concerts. Nouveaux publics, nouveaux lieux, qui façonnent une certaine géographie de la ville, concentrée sur les boulevards et dans les quartiers ouest. Des guides et des plans témoignent autant qu’ils structurent cette représentation de la ville, parfois bien éloignée du vécu du petit peuple.
L’expérience du touriste n’a en effet rien à voir avec celle de « l’authentique » Parisien : deux villes qui coexistent, et se percutent parfois. En 1926, deux autocars d’Américains sont attaqués par une foule en colère. La cause ? Les dettes interalliées de la Première Guerre, non honorées, accusées de faire plonger l’économie.
Hier comme aujourd’hui, on accuse le touriste des mêmes maux. Le visiteur a de quoi être surpris devant certaines coupures de presse des années 20, qui renvoient à des questions encore très actuelles. Ainsi, en 1926, le journal L’Œuvre s’indigne de ces touristes qui « profitent » du jour gratuit au Louvre…
Regard sur le touriste, regard sur le Parisien
Les caricatures témoignent de ce regard parfois tendu entre deux mondes qui se côtoient. Très rapidement s’élaborent des « types » caricaturaux et des stéréotypes sur certaines nationalités. On aime se moquer du touriste anglais, mal habillé et un peu niais. Une des ficelles récurrentes des caricatures est l’Anglais face à l’obélisque, obsédé par le désir d’y monter.
L’étranger n’est pas la seule cible de ces moqueries : on aime caricaturer le provincial découvrant la grande ville, notamment dans les physionomies.
Si l’on se moque du touriste, le Parisien en fait aussi les frais : épié, commenté, il devient un type authentique qui participe du pittoresque que l’on vient chercher à la capitale. Voici le Parisien exotisé et observé comme il le fait lui-même aux expositions universelles !

Mais le touriste ne s’intéresse pas qu’à la ville du luxe. En 1870, les touristes anglais viennent « admirer » les ruines de Paris comme on va visiter Pompéi. Des guides, autant à destination des Français que des touristes sont édités, et Cook organise des tours thématiques dédiés.

A la fin du XIXe siècle, se développe une nouvelle forme de tourisme, celle des bas-fonds, qui consiste à aller, incognito, dans les bouges de l’Est parisien, tâter la misère et se donner des frissons au contact des Apaches. Mais comme tout phénomène de mode, ce tourisme-là se professionnalise : des guides spécialisés émergent, de faux cabarets sont créés, où des acteurs imitent sous les yeux ébahis des bastonnades.
Massification touristique et authenticité
Phénomène courant : plus la demande est forte, plus l’offre se structure. L’authenticité s’effrite à mesure que les touristes sont plus nombreux. Le pittoresque laisse place à un décor de théâtre, façonné par des exigences économiques. Questions actuelles, récurrentes, qui traversent l’histoire du tourisme à Paris.

J’ai particulièrement aimé cette exposition pour les perspectives qu’elle offre, reliant notre expérience contemporaine du tourisme à celles du passé. Néanmoins, le propos reste grand public : le sujet mériterait une publication de l’ampleur de « Paris la nuit », le catalogue d’une exposition sur le paysage nocturne qui a eu lieu il y a quelques années au Pavillon de l’Arsenal. Prévoir tout de même une bonne heure et demie pour profiter de tous les documents, parfois très surprenants et amusants. A noter, l’entrée est gratuite le jeudi en nocturne.
Informations pratiques : Bons baisers de Paris, galerie des bibliothèques de Paris, 4e arrondissement, jusqu’au 31 mars 2016.










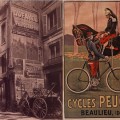



Bonjour! J’ai beaucoup aimé votre article et j’aimerais bien savoir si vous connaissez un livre ou document qui décrit en détail l’histoire du tourisme à Paris. Je vous remercie beaucoup par avance.
Bonjour,
Non malheureusement je n’ai pas de titre en tête. Je connais des ouvrages sur des points très précis, comme les guides de Paris au XVIIe siècle ou le tourisme anglais après la Commune. Le mieux, pour vous, serait-peut-être de vous tourner vers la Bibliothèque des Voyages et du Tourisme (Trocadéro) ou vers la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (Marais) qui pourront vous donner des pistes bibliographiques. Vous pouvez passer par le service ParHistoire, spécialement conçu pour ce type de requête ! https://www.paris.fr/parhistoire
Ping : Écrire le XIXème siècle (2/3) – La nouvelle bibliothèque d'Alphonsine