Une liasse de cartes postales anciennes, quelques souvenirs familiaux… Un siècle après la Grande Guerre, peut-on, à partir de ces quelques traces ténues, tenter de reconstituer le parcours d’un ancêtre poilu ? C’est l’aventure dans laquelle je me suis lancée, à la recherche d’Augustin Garnault.

Visages familiers
On l’appelait Cécile, mais son acte de naissance indique Angèle et sa tombe est marquée du prénom Céline. Nous sommes nées à un siècle d’intervalle et son prénom apparaît dans mon état civil. Aussi loin que je me souvienne, j’ai vu les yeux de ma mère briller en parlant de cette femme douce et aimante. Elle l’a connue au crépuscule de sa vie, ridée et fatiguée de cette histoire qu’elle a traversée : deux guerres mondiales et leur lot de privations et de deuils. De cette dame âgée, je n’ai connu que son regard doux, sa peau lisse et son visage élégant, fixé sur le papier albuminé d’un grand portrait devant lequel je passais chaque jour. Elle me fascinait par sa beauté et son histoire : mariée deux fois, le destin l’avait faite veuve deux fois, après quelques mois de mariage. Elle avait tout sacrifié pour son unique fils et aimé sans limite ses trois de petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.
En miroir de son portrait, celui de son premier époux : Augustin Garnault mon arrière-arrière-grand-père. Un beau militaire, avec la dignité et la fierté qu’impose une photographie en costume. De cet homme-là, point de souvenirs personnels dans la mémoire de ses descendants : aucun ne l’a connu. La guerre l’a enlevé aux siens le 4 octobre 1916. Il avait 27 ans, une jeune épouse et un bébé, son « mignon » Gaëtan, âgé de trois ans. Dans la mémoire familiale, il apparaît en creux : une absence inconsolable. Si pour mes autres aïeuls, je dispose d’une mémoire affective, de souvenirs que l’on m’a racontés, pour lui je n’ai que quelques bribes… et une correspondance : celle qu’il a tenue pendant la guerre. Alors il apparaît au détour des phrases, il se raconte lui-même, son quotidien, son caractère.
Dialogues fragmentaires
Cette correspondance, c’est un dialogue fragmentaire : certaines lettres ont disparu, brûlé, perdu. C’est un dialogue à une seule voix : des échanges épistolaires, il ne reste que ce qu’il a écrit à sa femme, à son enfant, à ses parents. Ce qu’on lui a écrit, ce qu’il a reçu, tout a brûlé sur le front : Verdun, la Marne, la Somme. « je n’avais pas songé à te le dire toute lettre que je reçois dès que je peux avoir un petit moment de libre je fais réponse et je fais brûlé [sic] la lettre, je n’en garde pas une, mon portefeuille est déjà assez plein comme cela. »
Il y a donc ses lettres à lui : elles sont faciles à déchiffrer car sa graphie est le plus souvent soignée, quoique ses phrases soient lapidaires. On y attrape des bribes d’un dialogue, interrompu par les manques, celles des lettres disparues. Un siècle plus tard, comment lire une telle correspondance ? Que raconte-t-elle de la guerre ? Peut-on, à travers les lignes, lire ce qui est tu, reconstituer deux ans de vie sur le front ?

C’est la question que je me suis posée en découvrant cette correspondance. Je me rappelle l’avoir feuilletée, à l’adolescence, j’avais alors 15 ou 16 ans. J’avais regardé la jolie écriture, les images sur les cartes, mais je crois que je n’avais pas réellement lu les mots : à cet âge-là, j’avais une curiosité pour l’histoire, mais pas encore le goût des archives.
Éditer une correspondance
Mon intérêt pour cette correspondance est revenu il y a deux ans, pour une double raison. Les commémorations de la Grande Guerre forment la première de ces raisons. A force d’entendre parler de la guerre, de l’expérience des poilus, j’ai eu le désir de connaître et de comprendre le parcours de mon ancêtre, et comment son histoire personnelle s’inscrivait dans l’Histoire avec un grand H. La seconde raison est scolaire : en 2014, j’étais étudiante à l’École des Chartes, et j’apprenais l’XML/TEI un système d’encodage des textes pour l’édition numérique. Travailler sur des manuscrits médiévaux ne m’enthousiasmait pas particulièrement et je manquais de motivation, c’est pourquoi j’ai voulu me lancer dans l’encodage de cette correspondance familiale, plus proche de moi. Happée par d’autres projets, j’ai abandonné quelque temps mon ouvrage, avant d’y revenir il y a quelques mois.
Pourquoi éditer cette correspondance ? Mes motivations sont diverses. La première est de participer au « devoir de mémoire ». Non pas au sens de la « gloire militaire » et de l’exaltation nationale : les grands faits de la guerre m’intéressent peu. Au contraire c’est de comprendre le vécu du « petit peuple » qui me motive. En cela, rien d’original : la recherche elle aussi a délaissé depuis plusieurs décennies l’histoire des généraux et des grandes batailles pour s’intéresser à l’histoire sociale de la guerre.
Dans ma démarche, il y a l’idée de faire une « expérience intime » de la commémoration de 14-18. En essayant de retracer et de comprendre le parcours individuel d’un poilu, je porte un autre regard sur les connaissances historiques que j’acquiers. Par exemple, bien qu’on l’étudie à l’école, je n’avais jamais compris l’importance symbolique du « soldat inconnu » : ce n’est qu’en lisant des travaux d’historiens, en travaillant sur la mémoire intime et le vécu des familles que j’ai pu comprendre ce que ce corps sans nom représentait pour une nation tout entière : les familles de tous les soldats dont le corps n’avait jamais été retrouvé pouvaient y matérialiser le proche disparu.
L’intérêt de mener une recherche historique est également une de mes motivations : j’ai la chance de posséder des sources inédites, que je peux croiser avec les archives militaires, afin de reconstituer un récit, le recontextualiser, puis le transmettre. Alors que j’ai terminé mes études et renoncé à faire une thèse, je renoue avec ce plaisir qu’est la recherche, tout en entretenant mes réflexes méthodologiques. C’est intellectuellement épanouissant : questionner la source, se saisir « avec des pincettes » des informations, les comparer, les compléter, les accumuler, les organiser ; écrire, raconter ce qu’on a compris, appris, puis le transmettre.

Cette notion de transmission est essentielle pour moi. Augustin Garnault est mort il y a un siècle, quatre générations lui ont succédé, il a aujourd’hui vingt-neuf descendants. Sa correspondance a été pieusement conservée, quoique divisée au gré des successions.
Comment assurer l’intégrité de ces archives tout en offrant à chacun la possibilité de les transmettre à la génération suivante ? La numérisation offre une opportunité nouvelle de conservation et de partage d’une mémoire familiale, et c’est précisément dans ce but que j’ai cherché à reconstituer et éditer la correspondance d’Augustin Garnault.
Comment procéder ?
Mon premier défi est de rassembler les sources : retrouver toutes les lettres d’Augustin, les numériser et les transcrire. Quand j’ai commencé ce projet, j’avais en ma possession un tiers des lettres adressées à son épouse, celles que ma grand-mère possédait. J’ai récemment rendu visite à mon grand-oncle et à ma grand-tante, ce qui m’a permis de numériser un autre tiers de la correspondance. Le troisième tiers de la correspondance m’a été envoyé par un grand-oncle (avec une immense frayeur en découvrant, à posteriori, que la Poste avait perdu puis retrouvé le précieux paquet) : elle est en cours de numérisation. En ouvrant ce paquet, j’ai eu la surprise de découvrir qu’il existait aussi des lettres datant de son service militaire (probablement une centaine) ainsi que la correspondance du front d’un autre soldat de la famille… mais ça sera pour plus tard !

Par ailleurs, il existe sur internet d’autres sources, la plus importante étant les journaux des Marches et opérations, qui retracent, au jour le jour, les événements qui ont marqué les différents régiments. Malheureusement, celui du 33e régiment d’artillerie de campagne, auquel appartenait Augustin s’interrompt au début de l’année 1916. J’ai aussi le fol espoir de croiser, au gré de mes pérégrinations sur internet, la correspondance ou le journal de guerre d’autres soldats appartenant à la même unité ou originaire du même village : comme ce serait assez enrichissant de croiser deux parcours !
A partir des numérisations que j’ai effectuées, je vais transcrire les lettres et exploiter chaque détail pour reconstituer son vécu : parle-t-il des lenteurs du courrier ? Je me demanderai comment se passait l’acheminement de la correspondance pendant la guerre. Se plaint-il de mal de dents ? J’essaierai de comprendre comment on soignait la douleur sur le front.
De rares fois, il évoque précisément les combats : un soldat de son unité blessé ou tué, des journées particulièrement difficiles, avec des bombardements ininterrompus ou bien des secteurs « calmes ». Sur ces moments de la bataille, les Journaux des Marches et Opérations me renseigneront.
En deux ans de guerre, Augustin s’est beaucoup déplacé sur le front. Parfois, il parle de ces marches interminables et des paysages traversés. Mais ce qu’il voit, c’est surtout par les images sur les cartes postales qu’il le transmet : il achète des vues des villes bombardées qu’il traverse et les envoie à son épouse avec ces simples mots « souvenirs de la campagne contre l’Allemagne ». J’aimerai reconstituer son parcours sur une carte géographique et dater chacune de ces vues.

A mesure que j’avancerai dans ce travail, je publierai des billets sur Orion en aéroplane. Parallèlement, j’éditerai un site web dédiée à son histoire, où seront publiées ses lettres, ainsi que le fruit de mes recherches.





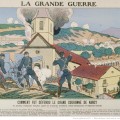


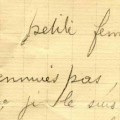
Bonjour
Même triste histoire chez nous : arrière-grand-mère 2 fois veuve et ayant perdu 2 enfants.
La guerre de 14 a été très présente avec les récits, les journaux et les écrits de famille.
J’ai même le cahier de tout ce qui se chantait alors, de la main de mon arrière-grand-père.
Etonnant que cette satané guerre soit restée aussi longtemps dans nos mémoires !
Qu’allons-nous transmettre à notre tour ?
Bonne journée et merci pour tout cet excellent travail.
Ah c’est très intéressant un carnet de chants, j’ai lu quelque chose comme quoi les chants de l’arrière et ceux du front n’étaient pas les mêmes… mais je ne sais plus où !
Espérons qu’on ne laisse pas aussi triste histoire que 14-18 derrière nous. Peut-être celle d’un naufrage écologique?
Bonjour, ton projet est touchant, passionnant et une grande source d’inspiration. Je suis certaines que nous, tes lecteurs, te suivrons avec intérêt. Est-ce que tu as des liens URL, les logiciels ou autre pour commencer un travail de généalogie ? Très belle journée et bon courage et merci pour tout ce travail que tu fais partager.
Merci Solène pour ton commentaire.
Pour débuter un projet de généalogie, je ne peux que conseiller de lire les excellents blogs daieux-et-dailleurs (Maiwenn Bourdic) et Gazette des ancêtres (Sophie Boudarel). Je ferai à l’occasion une petite sélection de blogs généalogiques que je lis.
Pour les logiciels, j’ai testé un temps Ancestris mais j’avais pas mal de bug. Actuellement je suis sur OhmiGene mais il n’est plus distribué. Héridis a beaucoup de succès aussi.
Regarde aussi du côté de Geneanet, et de Geneawiki, ce sont des mines d’information. J’espère publier bientôt mon propre retour d’expérience sur la généalogie… Au plaisir d’échanger sur ce sujet !
Texte très touchant. Et une formidable démarche. Les commémorations avec l’ouverture des archives de la guerre 14-18 ont permis à bon nombre de famille de prendre conscience que dans chaque fratrie, il y a eu des hommes qui sont partis à la guerre pour sauver leur pays. Mon grand-père y était, ses cousins aussi…
C’est vrai que les commémorations y sont pour beaucoup dans la redécouverte… Pour moi, cela a commencé en 4e au collège, en cours d’histoire on avait utilisé la base « Mémoire des Hommes » qui venait d’être créée. J’y ai trouvé sa fiche de mort pour la France. Plus tard, il y a eu « Parole de poilus » le projet de France Inter, Télérama et Librio. On a alors redécouvert sa correspondance. Les commémorations, la mise en ligne massive d’archives numérisées, le projet 1j1p, tout cela m’a fait comprendre qu’il y avait en fait pléthore d’indices à rassembler…
La photo de famille en haut de l’article me fait penser à un tableau du douanier Rousseau.
Pas faux 🙂
cette année le 18 septembre nous allons nous pencher sur qu’était notre village en 1916. village du Lot et Garonne donc loin à l’arrière
Merci pour ce partage, et d’avance pour ceux à venir ! C’est un travail passionnant que tu as entrepris, et en expliciter la démarche ne le rend que plus enrichissant encore ! Il faudra que j’en parle à mes collègues prof d’Histoire, d’ailleurs 🙂
Superbe projet !
Si jamais tu as besoin d’une petite main pour des trucs informatiques rébarbatifs, ne pas hésiter…
Projet très intéressant et fascinant! Je tente moi aussi de retracer la vie non pas d’un poilu mais d’une sculptrice américaine et je trouve que les recherches ont beaucoup de points communs!
Merci encore
Je savais qu’il me restait un marque-page dans un coin à lire 😉
Pour te suivre sur twitter aussi, on a déjà pas mal de bribes d’infos qui permettaient de reconstituer ton travail (sacré investissement temps et énergie) mais j’attendais avec impatience que tu commences à nous le présenter plus officiellement.
De mon côté c’est plutôt un tabou que l’histoire des 2 guerres mondiales alors je suis encore plus curieux que je n’ai quasi aucune comparaison perso.
Je n’ai pas attendu les commémorations pour écrire dans mon blog « la guerre 14 de mon grand-père » paternel, année par année, à partir des cartes postales échangées, de photos de famille et documents d’archives.
J’ai aussi mis dans ce blog les « carnets de guerre d’une jeune fille : Renée MULLER », fille du garde particulier du château de Vrilly, près du fort de La Pompelle. Elle avait 20 ans en 1914 et est décédée à 100 ans. Elle cite 470 soldats et tous les mouvements de troupe. J’ai illustré avec des cartes postales et photos de cette famille.
Un cousin germain a écrit la courte vie de notre grand-père commun mort à 30 ans à Verdun en 1916 avec détails sur sa carrière militaire.
Mon frère a écrit et fait publier « Les 23 de Liomer », hommage aux 23 victimes de cette commune de la Somme.
En ce moment, je m’occupe de la période 1er Empire. J’ai identifié plus de 100 cousins qui ont fait les Campagnes sous Napoléon dans divers régiments, dont 15 ont disparu dans la Retraite de Russie.
Je les ajouterai à l’histoire d’un cousin officier du 2e Régiment de Dragons, dont je raconte l’histoire sur mon blog.
JO 21 Septembre 1919 – Attribution Médaille Militaire : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6369378c/f28.item.zoom
Cordialement
SF Loudun