À deux pas de Paris, juste de l’autre côté du périph’, il y a un monument de sept siècles d’histoire à découvrir : le château de Vincennes. Seule résidence d’un souverain du Moyen Âge subsistant en France, et plus haut donjon d’Europe, il se dresse dans l’horizon parisien, rappelant ce passé lointain… Et juste à côté de la massive silhouette du donjon, s’élève une chapelle, la sainte-chapelle. C’est de ce monument que je vais aujourd’hui vous parler, et de sa restauration.

Une sainte-chapelle à Vincennes ? N’y en a-t-il pas qu’une de Sainte-Chapelle, celle de l’île de la Cité, au cœur de Paris ? Eh bien non ! Le titre de sainte-chapelle est porté par plusieurs édifices religieux : en France, il y eut une dizaine de « sainte-chapelle », dont seules sept subsistent aujourd’hui…
Une sainte-chapelle pour Vincennes
Mais qu’est-ce qu’une sainte-chapelle ? Pour prétendre à ce titre, plusieurs critères doivent être remplis : d’abord, l’édifice doit être la chapelle d’un palais ou d’un château royal ou princier ; ensuite, sa fondation doit être le fait de Saint-Louis ou de l’un de ces descendants ; enfin, cette chapelle doit abriter un morceau de la Vraie Croix ou de la couronne d’épines du Christ. À cela, s’ajoutent deux points supplémentaires communs à toutes les saintes-chapelles : elles sont bâties sur le modèle originel de la Sainte-Chapelle de Paris et un collège de chanoines y est attaché afin d’y célébrer toutes les trois heures l’office, en suivant l’usage de Paris.

C’est donc en partie parce que fondée par Charles V, descendant de Saint-Louis que la sainte-chapelle de Vincennes peut revendiquer ce titre canonique. C’est aussi parce qu’elle a une place particulière dans l’histoire des reliques de la Passion qu’elle a été bâtie.
Revenons en arrière, à l’époque de Saint-Louis. Durant son règne, Louis IX fréquente régulièrement Vincennes, qui n’est encore qu’un manoir royal (le donjon n’existe pas encore). Le roi y séjourne, y fait réunir son Conseil et -assez logiquement – plusieurs événements importants pour l’histoire de France s’y déroulent. Un de ces événements importants est l’arrivée des reliques de la Passion en 1239 (en réalité, elles arriveront en deux temps : la couronne d’épines en 1239 et les autres reliques en 1241).

Tout commence en 1237 : l’empereur latin de Constantinople, Baudoin II de Courtenay, très endetté, est contraint de vendre la couronne d’épine du Christ qu’il détient. Louis IX est intéressé et l’échange est conclu pour 135 000 livres, une somme astronomique pour l’époque. C’est pour le roi de France un geste symbolique très fort : en recueillant les reliques du Christ sur son sol, il affirme que son royaume est le phare de la chrétienté et se place de fait comme un modèle pour tous les autres rois chrétiens.
Lorsque les reliques arrivent en France, Louis IX les reçoit dans la cathédrale de Sens et accompagne ensuite leur progression vers Paris. Avant d’entrer dans la capitale, les précieuses reliques font une étape à Vincennes. Louis IX détache alors quelques épines, auxquelles il ajoutera plus tard un morceau de la Vraie Croix pour qu’elles demeurent dans cette résidence si importante à ses yeux. Le 18 août, Paris les accueille et Saint-Louis construira pour elles la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité, consacrée vingt ans plus tard. À Vincennes, le roi se contente de faire élever une petite chapelle et charge un chapelain de dire quotidiennement la messe.
Un siècle et demi plus tard, en 1379, son descendant Charles V fonde à Vincennes la sainte-chapelle que nous la connaissons. Elle aura pour fonction d’appeler la protection divine sur la résidence royale et la dynastie. Mais lancé dans les dernières décennies du XIVe siècle, le chantier ne sera achevé qu’en 1559.
Sous Charles VI, on édifie le choeur, les oratoires et la sacristie. La façade est entamée mais le chantier reste inachevé : les voûtes ne sont pas lancées au-dessus de la nef et l’édifice reçoit une couverture provisoire. Les difficultés financières et politiques que rencontre la Couronne dans les premières années du XVe siècle sont probablement la cause de cet abandon, ce qui n’empêche pas la chapelle de fonctionner à partir de 1403. Il faut attendre François Ier pour relancer significativement les travaux : si le roi veut achever et embellir la sainte-chapelle de Vincennes, c’est pour remercier Dieu de lui avoir donné un fils. Celui-ci, qui est son successeur Henri II, fait réaliser la voûte de la nef et une partie du décor intérieur, notamment les vitraux.
Un chef-d’oeuvre de l’histoire de l’architecture et de la sculpture
Architecturalement, la sainte-chapelle de Vincennes est un édifice très intéressant, et ce à plusieurs titres. Tout d’abord, il marque la transition entre le gothique rayonnant et le gothique flamboyant.

La sainte-chapelle est bâtie sur le modèle de celle de Paris (une nef unique, d’immenses baies, de puissants contreforts) mais avec une variante importante : elle ne présente qu’un seul niveau et est dépourvue de chapelle basse. Comme la Sainte-Chapelle de Paris, elle était coiffée d’une flèche, malheureusement abattue au XVIIIe siècle.
L’un des points d’orgue de la sainte-chapelle est sa façade à triple élévation, dont les trois pignons galbés soulignent le chef-d’oeuvre de pierre qu’est la rose. Cette façade où triomphe le gothique flamboyant a malheureusement perdu une grande partie de son décor sculpté, notamment la Vierge à l’Enfant qui ornait son trumeau. Mais demeurent les ornements des voussures, considérés comme un des chefs-d’oeuvre de la sculpture du XVe siècle.
À l’intérieur, l’effet est bien différent de celui produit par la Sainte-Chapelle de Paris, mais il faut rappeler que l’un comme l’autre des édifices ont été très modifiés à travers le temps. Autrefois, l’intérieur de la sainte-chapelle de Vincennes était orné d’un riche décor, dont la création avait été orchestrée par Philibert de l’Orme. Fort de son expérience au château de Fontainebleau, il avait fait appel tant à des artistes français qu’italiens. Tout ou presque de ce décor a été emporté par les tourments de 1793. Demeurent encore, dans le chœur, les vitraux créés à partir de 1551 par Nicolas Beaurain : ils nous laissent imaginer la splendeur passée de la nef, qui chatoyait des mêmes couleurs…
Un monument à sauvegarder
Si vous vous rendez aujourd’hui à la sainte-chapelle de Vincennes, vous aurez la surprise de la trouver en travaux. En effet, le CMN procède actuellement à la restauration des superstructures et des toitures du monument, dans le cadre d’un plan global de restauration du domaine de Vincennes. La restauration du château avait été lancée suite à la tempête de 1999, qui avait causé d’importants dommages au donjon. Le chantier s’est poursuivi avec la restauration des intérieurs de la sainte-chapelle, de ses vitraux et de ses sculptures.

Aujourd’hui, une nouvelle phase de travaux concerne les extérieurs du monument religieux. La restauration de la façade s’est achevée en 2015, et c’est à l’occasion de la présentation à la presse du résultat que j’ai pu faire les photographies qui illustrent cet article. Aujourd’hui, la rose et le portail sont libérés de tout échafaudage et n’attendent plus que votre visite ! En revanche, le chantier se poursuit sur le chœur et les toitures, afin d’assurer la bonne conservation et la transmission de ce bâti. Demain, le plan de restauration se poursuivra avec le rempart et le pont-levis, mais c’est une autre histoire !















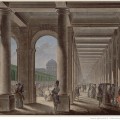




Elle a un côté moins intimiste que celle de l’île de la cité mais ces grands volumes blancs me rappelle agréablement la cathédrale de Nantes avec ses piles qui s’élèvent vers les voûtes d’un coup.
Moi qui parlait de couleurs dans mon dernier article… ironie bonjour.