Le dernier week-end de mars, nous sommes partis en expédition entre le Nord-Pas-de-Calais et la Somme : d’Arras à Amiens, avec un crochet par Péronne, nous avons roulé 170 kilomètres à vélo sur les traces de la Première Guerre mondiale.

Un week-end cyclotouristique en Artois et en Somme
Pour inaugurer ce premier (beau) week-end de printemps, nous avions décidé de partir en expédition cyclotouristique. Après de longues hésitations (Paris-Chartres ? Nevers-Briare ?), nous avons porté notre dévolu sur la véloroute de la mémoire (itinéraire 32) qui relie Arras à Amiens en passant par Albert.
J’y voyais l’occasion de me remettre à mon projet autour de la mémoire de mon arrière-arrière-grand-père poilu, Augustin Garnault, depuis trop longtemps en suspens (pour des raisons sur lesquelles je reviendrai dans un prochain billet), mais aussi d’aller visiter l’Historial de Péronne, musée qui attirait toutes mes curiosités, mais dont, faute de liaison ferroviaire, je repoussais sans cesse la découverte.
Péronne n’étant pas sur la véloroute de la Mémoire, j’ai dû m’arranger un peu avec le parcours pour dessiner un itinéraire qui passe par tous les centres d’intérêt que nous nous étions fixés. Grâce à l’excellent site veloenfrance.fr (qui propose des centaines d’itinéraires cyclables), j’ai pu trouver d’autres circuits à vélo, qui mis bout à bout, m’ont permis de tracer un trajet de 170 kilomètres à travers la campagne.
D’Arras à Péronne, sur les traces de la bataille de la Somme
Samedi matin, donc, nous nous embarquions avec nos vélos dans un TGV de la gare du Nord. Quarante-cinq minutes plus tard, nous débarquions à Arras, ville qui fut très durement touchée pendant la Première Guerre mondiale. Dès octobre 1915, la ligne de front se fixe en pays d’Artois. Plusieurs batailles féroces s’y déroulent, notamment en avril-mai 1917. La ville sortira ruinée du conflit : 80% du bâti ancien a été détruit par les obus…
Face à la gare, le premier monument qui accueille les visiteurs est justement le monument aux morts, très impressionnant. Son décor est assez original, puisqu’il s’inspire des conventions artistiques de l’art égyptien : bas-relief, figures de profil, étagement des scènes…

Pressés de nous lancer sur la véloroute, nous n’avons pas pris le temps de visiter la ville (à regret) et nous nous sommes contentés d’un coup d’oeil au beffroi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et d’un crochet jusqu’à la citadelle Vauban, construite entre 1668 et 1670.
Malheureusement pour nous, le début officiel de la véloroute n’est pas à Arras même, mais dans une bourgade proche, Dainville, que nous peinons à trouver faute de signalisation (ou alors nous ne l’avons pas vue !). Les premiers kilomètres sont agréables, quoique très linéaires : nous roulons sur une ancienne voie de chemin de fer convertie en piste cyclable. Le vent est fort mais heureusement, nous l’avons (pour l’instant) dans le dos. La campagne est belle, les herbes vertes luisent au soleil, ce qui nous change un peu de Paris !

Nous traversons le Pays d’Artois sans trop voir les traces de la guerre : ce n’est qu’après avoir bifurqué vers Bapaume que nous commençons à traverser des villages, au centre desquels trônent immanquablement des monuments aux morts. Je prends en photo celui de Bienvillers-au-Bois, qui me semble original avec son poilu en uniforme bleu, les bras écartés, qui me semble recevoir la balle mortelle. En cherchant des informations sur ce monument, j’apprendrai que la figure s’intitule « on ne passe pas » et illustre l’attitude courageuse des soldats. Le modèle est dû au sculpteur Eugène Piron : la statue fut produite en série par la Fonderie Durenne et on la retrouve dans une bonne vingtaine de villages français.

La route est difficile, non pas qu’elle soit très fréquentée ou trop vallonnée (l’itinéraire est vraiment agréable) mais c’est que le vent est très fort et latéral : plusieurs fois, je manque de finir dans le fossé, faute de résister aux bourrasques. Nous apprendrons plus tard qu’il soufflait à 60 km/h !
Après avoir déjeuné à Burcquoy, nous reprenons la route en direction d’Achiet-le-Petit puis de Miraumont. La campagne est vraiment belle, légèrement vallonnée. Tout est bien paisible sur les rives de l’Ancre. Pourtant, il y a un siècle, s’est déroulée ici l’une des batailles les plus terribles de la Première Guerre mondiale : la bataille de la Somme (juillet-novembre 1916). Pendant quatre mois, de juillet à novembre 1916, une bataille terrible se joue : le front progresse de 5 à 12 kilomètres selon les zones, au prix de 1 200 000 hommes mis hors de combat (blessés, prisonniers ou morts…) J’essaie d’imaginer ce petit bout de pays sous le feu de l’artillerie ; les arbres décharnés ; les routes boueuses. Les lieux sont méconnaissables comparés aux images d’archives que j’ai en tête.
Dans chaque village, un panneau marqué d’un coquelicot nous accueille : c’est le symbole de la mémoire de la guerre pour les anciens pays du Commonwealth. Nous sommes ici sur un territoire qui a été défendu par les soldats de l’Empire britannique : au bord des routes que nous empruntons, nous croisons des cimetières australiens, irlandais, sud-africains, canadiens…
Alors que nous longeons une petite rivière dans un joli vallon, une tour s’élève au sommet d’une colline. Une tour médiévale, seule, au milieu de nulle part. À mesure que nous grimpons vers le monument, nous nous interrogeons : est-ce un pastiche XIXe néo-médiéval ? Comment peut-il être encore debout alors qu’ici les combats ont été terribles ? Quel propriétaire a commis cette folie de reconstruire à l’identique après-guerre ?

Nous aurons l’explication une fois devant le monument : c’est en fait un mémorial commémorant le sacrifice de la 36e division d’Ulster qui a perdu sur ce terrain, le seul 1er juillet 1916, 5000 hommes. Plus largement, il s’agit un lieu de souvenir dédié à tous les bataillons provenant d’Ulster qui ont pris part à la bataille de la Somme. Mais pourquoi un monument néo-médiéval ? C’est qu’il s’agit de la réplique d’une tour qui se trouve dans un parc de Clandeboyne en Irlande, où l’Ulster division s’entrainait. Un peu de chez eux apporté sur le terrain où ils sont tombés…
Le mémorial de Thiepval
Nous arrivons à Thiepval, où se trouve le mémorial franco-britannique. Thiepval est un lieu important de la bataille de la Somme, déclenchée le 1er juillet 1916 par les Britanniques en réponse à la bataille de Verdun (février 1916). Le 1er juillet 1916, à 7h20 du matin, l’offensive est lancée : 100 000 hommes sortent des tranchées. Ce sont pour l’essentiel des soldats britanniques, les fameux « bataillons de copains » enrôlés volontairement. La défense allemande est impitoyable et au soir du premier jour de la bataille, 20 000 des soldats britanniques sont tombés ; 40 000 autres sont blessés ou prisonniers. Il faudra encore 87 jours de combats pour que les troupes s’emparent du village de Thiepval, tenu par les Allemands.

À la fin des années 1920, la colline de Thiepval est choisie pour commémorer les 72 205 hommes des armées britanniques qui sont tombés dans la Somme entre juin 1915 et mars 1918. Sur les murs du monument, élevé entre 1929 et 1932 par l’architecte Edwin Lutyens, sont inscrits les noms des soldats dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Régulièrement, la liste est amendée, parce qu’on avait oublié le nom de l’un d’eux ou parce que le corps d’un autre a été identifié et qu’il dispose désormais d’une tombe.
Nous sommes très impressionnés par la puissance du monument, écrasant, et par l’alignement des noms et des 600 tombes qui lui font face. Seules 20% portent le nom d’un soldat, les autres portent les mentions « connu de Dieu seul » ou « soldat inconnu ».
C’est à Thiepval que nous quittons la véloroute de la mémoire, pour rejoindre Péronne. Sur notre route, deux points d’intérêt attendus : le village de Pozières, inscrit au Brevet des Provinces Françaises et le village de Combles, où mon arrière-arrière-grand-père Augustin Garnault est mort le 4 octobre 1916. Depuis deux ans, je m’attache à reconstituer sa vie, de son départ du village natal jusqu’à son décès sur le front. Jusqu’à il y a peu, je ne ressentais pas le besoin ni l’envie de me rendre sur les lieux où il s’était battu, mais ma lecture de Paysage en bataille, d’Isabelle Masson-Loodts m’a fait changer d’avis.
À Combles, là où Augustin Garnault est tombé…
À Combles, il n’y a pas grand-chose à voir : c’est un bourg assez ordinaire. L’autoroute passe non loin. Durant les minutes que durent notre traversée de cette commune, je m’interroge : Où se tenait-il ? Où est-il tombé ? Où son corps a-t-il reposé avant que sa famille ne décide de le rapatrier pour l’enterrer dans son village? Était-ce parmi les ruines du village, dans ce champ ? Nous traversons un petit bois dont le sol est constellé de petites fleurs blanches, comme un signe qui m’est fait… J’essaie de m’imaginer à quoi ressemblaient ces lieux au plus terrible de la bataille de la Somme de l’automne 1916…
En rentrant chez moi, je découvrirai qu’Augustin est probablement tombé à l’est du village, la partie ouest étant occupée par les lignes britanniques (australiennes puis canadiennes). C’est ce caractère de zone de jonction entre deux armées qui faisait de Combles un point du front particulièrement vulnérable et donc dangereux : les armées britanniques et françaises peinaient parfois à se coordonner et l’on sait aujourd’hui qu’il était fréquent que des obus destinés à l’ennemi tombassent sur les troupes amies. La fiche de mort pour la France d’Augustin indique qu’il a été « tué à l’ennemi » mais la mémoire familiale veut qu’il ait été enseveli vivant sous sa cagna bombardée…

La fatigue se fait sentir : nous ne pousserons pas jusqu’à Rancourt, où est élevée la chapelle du Souvenir français de la bataille de la Somme. Il nous faut rejoindre Péronne, où nous attend une chambre d’hôte. Nous descendons vers le fleuve : la lumière dorée du soleil est magnifique. À Clery-Sur-Somme, puis aux Halles, un bourg dépendant de Péronne, nous admirons des constructions de l’entre-deux-guerres, aux traits art déco.
Nous avons roulé 92 kilomètres en un peu moins de six heures. Je pense que ce qui m’a le plus impressionnée dans cette longue traversée du pays d’Artois et de Somme, c’est que, quelle que soit la direction dans laquelle je portais mon regard, j’apercevais toujours un cimetière ou un monument commémoratif. Ici, cette guerre vieille d’un siècle est une réalité qu’on ne peut pas omettre : elle est ancrée dans le paysage, par ces immenses champs de croix ou de stèles, par les vestiges que le sol rejette chaque jour : douilles, obus, restes humains, petits effets personnels…
De Péronne à Amiens, sur les bords de la Somme
L’Historial de Péronne
Dimanche matin, avant de reprendre la route, nous visitions l’Historial de Péronne, installé dans ce qui reste du château médiéval de la ville. Le musée est consacré à la Première Guerre mondiale dont il offre une approche sociale, culturelle et militaire. La scénographie, aérée et lumineuse, rend la visite agréable, même si les dispositifs de médiation sont assez inégaux (mais en cours de renouvellement). Le parcours s’attache particulièrement à l’histoire sociale de la guerre, avec beaucoup de petits objets personnels, ce qui rend la visite émouvante.
Plutôt que de vous relater dans le détail ma visite, je préfère vous confier trois moments forts qui l’ont ponctuée.
La première salle est consacrée aux racines de la guerre. Pour mettre le visiteur dans le contexte de l’époque, plusieurs conflits importants du début du XXe siècle sont présentés (révolte des Boxers en Chine, guerre du Maroc, guerre des Boers : essentiellement des guerres coloniales, aujourd’hui oubliées). Pour les évoquer, le personnel scientifique a fait un choix fort : celui d’exposer des objets coloniaux très choquants pour nous, publics du XXe siècle, en raison de leurs messages racistes crus. Ces objets sont ordinairement cachés dans les réserves : les montrer permet prendre conscience de la violence de notre passé colonial, et je pense que c’est une bonne chose.

L’autre moment fort de ma visite, qui l’a distingué des autres musées consacrés à la Première Guerre (je commence à en connaître un certain nombre ! ), c’est la salle consacrée aux célèbres estampes d’Otto Dix, rarement présentées dans les collections françaises. Lorsque la guerre éclate, Otto Dix est encore étudiant à l’École des Arts décoratifs de Dresde. Son expérience de la guerre (il était artilleur) va être déterminante dans son parcours artistique. À son retour du front, il puise dans ses dessins et souvenirs pour réaliser peintures et estampes témoignant de la tragédie humaine qu’il a observée et vécue au plus profond de sa chair. Toutes ses œuvres de l’entre-deux-guerres seront marquées par cette expérience de la violence et par ses convictions antimilitaristes. La série de cinquante estampes, publiée sous le titre Der Krieg, est admirable par le témoignage poignant qu’elle porte, à la fois personnel et universel, et pour sa qualité esthétique de la gravure. Otto Dix manie avec une grande maîtrise l’eau-forte, la pointe-sèche et l’aquatinte, faisant de ces cinquante gravures un chef-d’oeuvre de l’histoire de l’estampe.
Le dernier point que je voulais évoquer ici est un dispositif scénographique : pour varier les présentations, les scénographes ont creusé dans le sol des salles des « vitrines-fosses » dans lesquelles sont présentés les uniformes et le barda des soldats. Le visiteur peut comparer l’équipement des différents belligérants. La présentation, qui évoque la tombe, est à la fois pédagogique et émouvante, par la gravité de ce qu’elle évoque, à savoir la souffrance commune des combattants.
Une après-midi sur les bords de la Somme
Après deux heures de visite, il faut reprendre la route en direction d’Amiens où un train nous ramènera à Paris. Initialement, j’avais prévu que l’on remonte vers Albert pour rattraper la véloroute de la Mémoire là où nous l’avions laissée la veille, mais le temps presse et nous préférons couper par les bords de Somme. Bonne option : les paysages sont éblouissants ! La Somme est un fleuve paisible, et fortement domestiqué : un important jeu d’écluses a été aménagé par l’homme pour réguler le débit de l’eau. L’eau chemine doucement à travers une succession d’étangs et de marais, qu’il est si agréable de traverser. Les feuilles n’ont pas encore verdi sur les arbres, mais le soleil est au rendez-vous et nous croisons de nombreux pêcheurs et promeneurs au bord de l’eau.
La charmante propriétaire de notre chambre d’hôte nous a conseillé un crochet par le village de Suzanne, qu’elle considère comme un des plus mignons villages de la région. Nous ne sommes pas déçus par les détours que nous faisons.
Passé Bray-sur-Somme, la route se fait plus monotone : nous longeons le canal qui double la Somme. Le chemin de halage, désormais réservé aux piétons et aux cyclistes, n’est qu’une succession de lignes droites, qui me semblent ne jamais finir. Nous faisons un rapide arrêt à Corbie, où nous prenons notre goûter face à la mairie dont la silhouette atypique évoque un petit château de conte de fées.

Les derniers kilomètres jusqu’à Amiens nous semblent bien longs. Heureusement, à l’approche de la ville, un heureux spectacle, celui des Hortillonnages, vient couronner nos efforts. Les hortillons sont des jardins flottants aménagés par l’homme pour les besoins de la culture maraîchère. Fin mars, le spectacle est superbe : les jonquilles et tulipes sont tout en fleurs et les promeneurs sont nombreux à les admirer.
Avant de reprendre le train pour Paris, nous sirotons un petit verre face à la cathédrale. Nous avons roulé 170 kilomètres en deux jours. Je n’en suis pas peu fière, moi qui n’ai pas fait de longues randonnées depuis cet automne !

Pour aller plus loin
- Itinéraire de la véloroute de la mémoire et lien pour télécharger la brochure touristique
- Le site veloenFrance.fr porté par la FFCT, pour présenter les itinéraires cyclables accessibles.
- Une page de présentation des principaux lieux de mémoire dans la Somme sur le site du Centenaire (avec une brochure à télécharger)
- Somme 14-18, un site consacré à la mémoire de la guerre dans la Somme.
![Dans_la_Somme_village_bombardé_[...]Agence_Rol_btv1b6952323w Agence Rol, Dans la Somme, village bombardé, 1916, photographie, Gallica/BnF](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2017/04/Dans_la_Somme_village_bombard%C3%A9_...Agence_Rol_btv1b6952323w.jpeg?w=509&h=380&ssl=1)
![Les_ruines_d'Hardecourt_(Somme)___[...]Agence_de_btv1b9044860p Agence Meurisse, Les ruines d'Hardecourt, 1916, photographie, Gallica/BnF](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2017/04/Les_ruines_dHardecourt_Somme___...Agence_de_btv1b9044860p.jpeg?w=251&h=188&ssl=1)
![Moulin_de_Beaucourt-sur-Ancre_[Somme_ruines]_[...]Agence_Rol_btv1b6952763s Agence Rol, Moulin de Beaucourt-sur-Ancre, 1916, photographie, Gallica/BnF](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2017/04/Moulin_de_Beaucourt-sur-Ancre_Somme_ruines_...Agence_Rol_btv1b6952763s.jpeg?w=251&h=188&ssl=1)
![Un_camp_de_cavalerie_sur_[...]Agence_de_btv1b9044871g Agence Meurisse, Un camp de cavalerie sur le front de la Somme, 1916, photographie, Gallica/BnF](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2017/04/Un_camp_de_cavalerie_sur_...Agence_de_btv1b9044871g.jpeg?w=764&h=572&ssl=1)
































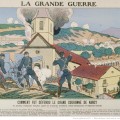



… et bravo pour la mention d’Otto Dix, peintre intraitable des horreurs de la guerre de 14-18.
À Bailleul (Nord), et aux environs, on côtoie aussi tous les cimetières (avec une majorité de tombes anglaises et irlandaises) qui marquent la terre où se cachent sans doute encore des obus ou des restes humains enfouis.
Il nous manquait ici quelques photos des « randonneurs » à vélo ! 🙂
On est pas trop photogénique (la tenue jaune fluo, en plus…), mais on va faire un effort pour le prochain voyage à vélo 🙂
Sacré rythme ! Vous roulez bien dis donc si en plus il y avait du vent…
Tu as trouvé un ton fluide à lire pour raconter tes expériences, c’est de plus en plus agréable je trouve.
Ca va en fait, on fait du 15 km/ heure… on cherche des gens pour nous accompagner dans nos prochaines aventures si tu veux venir ^^
Merci pour le ton, je suis contente si c’est plus agréable à lire 🙂
Avec les pauses photo etc. je pensais plus. Disons que ça va revient un peu cher de vous rejoindre mais sinon ça aurait été possible.
Non, 15km/heure c’est la moyenne pédalage sans les pauses. Pendant les pauses, le compteur s’arrête. Tu sais, je suis pas une sprinteuse 🙂
Qui sait, peut-être un jour on ira faire du vélo dans tes contrés… Quoique ça monte, non, du coté de la frontière ?
Il y a des coins plats (bords de cours d’eau) mais sinon, c’est très valonné. De nombreux parcours nature qui se prête mieux au vtt ou à la marche. 🙂
Le souvenir d’Augustin est resté vif dans l’histoire familiale, notamment à travers l’amour que ses descendants portaient à Cécile, son épouse, mon arrière-grand-mère tant aimée, ton arrière-arrière-grand-mère. Merci pour ton travail, qui nous permet de mieux connaître l’histoire de notre famille et celle de notre pays. J’espère que tu poursuivras tes recherches et que tu les étendras à d’autres arrières-arrières-grands-parents…Pourquoi un voyage vers l’Italie sur les traces d’Henri Bobin ?
Le souvenir d’Augustin est resté vif dans l’histoire familiale, notamment à travers l’amour que ses descendants portaient à Cécile, son épouse, mon arrière-grand-mère tant aimée, ton arrière-arrière-grand-mère. Merci pour ton travail, qui nous permet de mieux connaître l’histoire de notre famille et celle de notre pays. J’espère que tu poursuivras tes recherches et que tu les étendras à d’autres arrières-arrières-grands-parents…Pourquoi pas un voyage vers l’Italie sur les traces d’Henri Bobin ?
Merci pour ce reportage du front ! Pour l’émotion, essayez Ypres un de ces jours !!!! La porte de Menen est l’un des plus beaux compliments à la C…. des hommes ….
Oui, j’ai très envie d’aller voir Ypres, d’autant qu’Augustin y a passé beaucoup de temps en 1915. Mais depuis Paris, compliqué (et cher). Je pense que j’irai depuis Lille, car ce n’est pas très loin en vélo !