Un peu de bibliotourisme, ça vous dit ? Bibliotourisme… quesaco ? Visiter des bibliothèques en vacances, bien un truc de bibliothécaire ça (enfin, fausse bibliothécaire dans mon cas). Aujourd’hui, c’est à la bibliothèque d’études et du patrimoine de Besançon que je vous emmène. J’ai eu la chance d’y être reçue par Bérénice Hartwig qui m’a présenté l’histoire de l’institution et de ses collections, que je ne connaissais jusqu’alors que par le site Mémoire Vive et le compte twitter associé.

Une des plus anciennes bibliothèques publiques de France
La bibliothèque de Besançon est l’une des plus anciennes de France : sa fondation remonte à la fin du XVIIe siècle quand l’abbé Boisot lègue sa collection personnelle à l’abbaye Saint-Vincent à condition qu’elle soit accessible au public grâce à des financements de la ville. En 1696, donc, Besançon, cité nouvellement française, inaugure l’une des premières bibliothèques publiques de France.
Les lecteurs ont alors accès à 2500 volumes dont 246 manuscrits, un fonds prestigieux dont la ville tire aujourd’hui encore grande fierté, d’autant que certains des ouvrages rassemblés par Boisot ont des provenances remarquables : librairie royale, bibliothèque des Granvelle…
Au fil du temps, la collection va s’enrichir de grands legs, comme celui de Pierre-Adrien Pâris (1819), architecte de Louis XVI, ami de bien des artistes, qui possédait une extraordinaire collection de dessins.
Mais c’est surtout la Révolution française qui étoffe le plus la bibliothèque en nombre de volumes : les ouvrages confisqués aux monastères, aux émigrés viennent grossir le fonds primitif.
Pour un tel ensemble, il fallait bien un édifice à la hauteur : en 1808, la mairie se lance dans la construction d’une bibliothèque. C’est, en France, l’un des premiers bâtiments édifiés pour abriter une bibliothèque publique. La salle de lecture ouvre ses portes en 1818, mais le chantier reprend peu de temps après : il faut déjà agrandir le bâtiment !

De la disposition du XIXe siècle, quelques photographies gardent la trace, car les aménagements ont beaucoup évolué au cours du siècle suivant, pour répondre au besoin toujours plus pressant d’espaces où stocker les livres.

La grande salle de lecture, avec ses hauts volumes si difficiles à chauffer en hiver est transformée en magasin. Étrange spectacle que ce vaisseau de métal vert, supportant des rayonnages, encastrés dans les volumes des anciennes coursives de bois : le seul moyen, pourtant, de caser douze kilomètres d’étagères dans un bâtiment si ancien et si étroit.

Seule la salle qui sert aujourd’hui d’espace d’exposition a gardé sa configuration d’origine et son charme suranné, avec ses étagères de bois couvertes de livres qui grimpent jusqu’au plafond.

Quant aux lecteurs, c’est dans l’ancien cabinet d’hiver, de tout petit volume, qu’ils sont aujourd’hui reçus. Au moins, il y fait bon !

Prestigieuses collections de la bibliothèque de Besançon
Comme toutes les grandes bibliothèques régionales, l’institution bisontine conserve un vertigineux fonds local : plus de 20 000 ouvrages sur la Franche-Comté ! Mais elle peut aussi s’enorgueillir d’autres précieux trésors à commencer par sa collection de manuscrits riche de 4000 pièces, dont 300 datent du Moyen-Age (eh oui, les manuscrits ne sont pas tous médiévaux !)
Quand on dit manuscrit, on pense souvent enluminures : il y a des pépites de la peinture médiévale et renaissance dans la collection de Besançon ! J’ai eu la chance d’en admirer quelques-unes, disposées dans les vitrines anciennes de la salle d’exposition, où était présentée une petite sélection de documents autour du livre représenté. Il y avait notamment une superbe enluminure de Jean Colombe, datée du début du XVIe siècle. Le livre d’Heures (MS 148) était ouvert sur une peinture en pleine page, figurant l’Annonciation. Juste à côté, un autre ouvrage déployait ses jolies marges fleuries. Beaucoup plus ancien (IXe siècle !), un manuscrit présentait des illustrations juste esquissées… Quel plaisir de contempler ces petits chefs-d’œuvre miniatures, et leurs détails parfois savoureux.
Manuscrits, mais aussi incunables. Les spécialistes désignent sous ce terme les premiers livres imprimés, ceux parus entre 1454 et 1501. La bibliothèque de Besançon en possède 1100 ! Pas toujours facile pour un oeil non averti de repérer un incunable, car certains ressemblent à s’y méprendre à des manuscrits : enluminures, lettrines et lettres ornées. C’est que certains s’évertuaient à colorier ces nouveaux livres imprimés – et leurs gravures sur bois – pour les faire ressembler le plus possible aux manuscrits enluminés, plus prestigieux. Il s’agissait également d’assurer aux lecteurs une continuité dans leurs habitudes de lecture.
Certains de ces incunables sont d’une grande rareté, comme les Lettres de Gaspain de Bergame, un des premiers livres imprimés à Paris en 1470 et connu seulement par treize exemplaires à travers le monde. Le plus ancien ouvrage imprimé de la bibliothèque, quant à lui, date de 1459.
Prenons une petite pépite du fonds d’imprimés, un fragment du livre de Prières conçu pour Maximilien (mais dont l’empereur ne vit jamais l’achèvement). Huit exemplaires de cet ouvrage sont connus : ils ont été imprimés en 1513 à Augsbourg. Certains sont imprimés sur papier, d’autres sur parchemin. Le texte en noir est imprimé à l’aide de caractères mobiles, tandis que les lettrines sont rehaussées de peintures.
Besançon ne possède pas le livre en entier, mais une cinquantaine de feuillets du plus précieux des huit exemplaires (les autres feuillets de cet exemplaire sont conservés à Munich). Pourquoi le plus précieux des huit exemplaires ? Parce qu’il est orné d’illustrations dessinées à la plume par des mains prestigieuses : Albrecht Dürer, Lucas Cranach l’Ancien, Hans Baldung Grien, Hans Burgkmair l’Ancien, Albrecht Altdorfer… Ces illustrations sont manuscrites : étaient-elles destinées à être ensuite gravées pour orner les autres exemplaires ? S’agit-il là d’un prototype, d’une épreuve de travail, ou bien d’une réalisation spéciale destinée au seul usage de l’empereur ? Inachevé à la mort de Maximilien Ier, l’exemplaire illustré à la plume est démembré et séparé en deux ensembles, jusqu’à parvenir aux bibliothèques de Munich et de Besançon.
De la collection de près de 5000 dessins de la bibliothèque de Besançon, ma préférence va aux contre-épreuves d’Hubert Robert sur lesquelles Sarah Catala a beaucoup travaillé. Une contre-épreuve est l’empreinte d’un dessin obtenu par pression de la feuille inscrite (dit dessin matrice) contre un papier vierge et humide. Hubert Robert utilisait cette technique pour conserver l’image des compositions qu’il vendait. Ces contre-épreuves, soigneusement conservées, lui servaient de répertoire de motifs pour de futures compositions. Passionnants matériaux d’étude pour les historiens de l’art !

Ami d’Hubert Robert, Pierre-Antoine Pâris a recueilli une centaine de contre-épreuves des sanguines du peintre des ruines et plusieurs dizaines de dessins d’autres mains (Fragonard…), qu’il a donnés à sa ville, et que se partagent aujourd’hui le Musée des Beaux-Arts et la bibliothèque patrimoniale.
Il y aurait encore mille et une merveilles à vous décrire de la bibliothèque de Besançon, comme les oiseaux d’Audubon, un des ouvrages illustrés les plus chers au monde, dont l’institution a la chance de posséder un exemplaire (l’un de ceux souscrits par l’état français et qui a été attribué à la ville)… mais je ne vous en parle pas plus, car je compte bien un jour trouver le temps de consacrer à cette entreprise éditoriale et ornithologique un billet complet !
Une bibliothèque qui se vit aussi sur internet
Les multiples trésors de la bibliothèque de Besançon, vous pouvez les découvrir à travers des expositions (la bibliothèque prête ses plus belles pièces aux musées des quatre coins du monde), mais aussi sur internet.

Car Besançon numérise beaucoup et met à disposition ses collections sur le site Mémoire vive, une bibliothèque numérique commune à toutes les institutions patrimoniales de la ville. Une partie des fonds sont ainsi moissonnés et accessibles sur Gallica, mais c’est bien sur le site de Mémoire vive qu’il faut se rendre pour se laisser conter les collections par ceux qui en sont responsables. Depuis plusieurs années, les institutions culturelles de la ville mènent un important effort de médiation qui prend – entre autres – la forme d’une chronique régulière, « à la loupe » qui décortique en détail des pièces patrimoniales remarquables. Un travail de diffusion que l’on peut également retrouver depuis peu sur Twitter à travers le compte @MVBesancon1. Vous followez ?









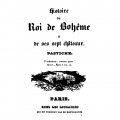



Une magnifique bibliothèque ! Merci miss pour toutes ces infos ! On irait bien faire un petite visite à nos collègues de Besançon !
Oh oui, ce serait une excellente idée ! Le courant passerait bien, je crois 🙂
Astrid, tu vas être contente, mon prochain billet BIBLIOTOURISME, c’est Nancy, promis !
Super chouette que tu sois venue jusque dans nos contrées ! Petite question : As -tu déjà eu l’occasion d’explorer les bibliothèques de Tours ?
Mais je ne savais pas que tu étais (vivais?) à Besançon ? Si j’avais su, je t’aurais fait signe durant mon séjour !
Non, je n’ai jamais mis les pieds à Tours en vrai, sinon pour des correspondances de train… Il faudra que je corrige cela !
Merci pour cette belle découverte qui me donne encore plus envie d’y aller !