En 2015, j’ai fait un bref séjour à Madrid, une ville qui regorge de grands musées. Une des étapes obligées est la visite du Reina Sofia, qui abrite depuis 30 ans l’œuvre la plus célèbre de Picasso, Guernica. Qu’est-ce que ça fait de voir en vrai Guernica ?

Ce billet a été rédigé en 2016 et était depuis resté en brouillon. Je le publie finalement en écho à l’exposition Guernica, au musée Picasso (printemps-été 2018) : une exposition « Guernica sans Guernica » (le tableau ne voyage plus depuis 1981), mais néanmoins passionnante : je vous en recommande vivement la visite.
Pour mon premier voyage à Madrid, je ne tenais pas particulièrement à voir Guernica : je l’ai mille fois aperçu sur des pages de papier glacé, il est dans tous les cours d’histoire et m’a toujours — avouons-le — fait un peu peur.
Ayant un timing serré et étant face à une offre muséale exponentielle, j’ai favorisé les salles du Prado, mais j’ai néanmoins profité de la nocturne du mardi soir pour consacrer quelques heures aux salles du musée d’art moderne, le Reina Sofia.
De la reproduction à l’original, le « vrai » Guernica
Comme au Louvre avec la Joconde, le parcours est fléché pour mener un flux continu de touristes « à la star ». Alors que bien des salles du musée, d’une blancheur apaisante, sont vides et silencieuses, plus on approche de Guernica, plus la foule est dense et bruyante. Et puis, tout à coup, au tournant d’une cimaise, derrière une masse compacte de têtes, il surgit, monumental. Le tableau.

Une histoire de taille
On peut ressentir une impression un peu étrange, car le tableau paraît paradoxalement à la fois gigantesque et pas si grand que cela. Je crois que devant toutes les œuvres célèbres il y a ce sentiment de surprise. La Joconde, le Baiser de Klimt, les montres molles de Dali, le Printemps de Botticelli, nous les avons vu mille fois reproduits : en timbre vignette dans un livre de cours, agrandi à outrance sur une affiche publicitaire… Multiple, infini, dans toutes les formats et de toutes les couleurs, si bien que nous en oublions sa taille réelle, et lorsqu’on se trouve confronté à l’original, l’unique, c’est la surprise : quoi, la Joconde est si petite ? Et les montres molles, plus encore ?
Mais ce n’est pas la taille de l’œuvre qui m’a le plus marqué devant Guernica : c’est ce que j’ai ressenti, cet écrasement soudain.
Je pensais naïvement que cela ne me ferait « ni chaud ni froid », car oui, au risque de me répéter, je la connaissais, je l’avais vu mille fois en copie. On m’avait pourtant prévenue : l’expérience était poignante et l’on ressent très profondément la violence qui se dégage de l’œuvre. Mais j’étais loin de m’imaginer que je ressentirais tout cela, du moins pas avec cette force-là.
Etouffement
Est-ce dû à la foule qui se presse, à l’étroitesse de la pièce qui donne l’impression que l’œuvre va exploser hors de son cadre ? Les conditions muséographiques sont bien différentes de celles du Pavillon de la République espagnole à l’exposition universelle de 1937, au cours de laquelle l’œuvre fut présentée pour la première fois : le bâtiment était largement ouvert sur l’extérieur, Guernica étant d’ailleurs présenté sous un préau.

Ici pas de fenêtre, pas d’échappatoire, pas de respiration. L’espace est confiné, les murs blancs… Tu es là, au pied du tableau, confronté à cette œuvre qui va t’avaler de son cri insoutenable.
Tu es à la fois entourée d’une foule d’anonymes, pressante et bruyante malgré les rappels à l’ordre des gardiens et seule, seule face à cette masse grise de souffrance et de violence.

L’atmosphère est étrange, tendue. Étouffée par mes propres sensations, j’ai dû m’éloigner, sortir de la pièce, reprendre mes esprits avant de revenir me confronter au tableau.
Comprendre Guernica
Cette œuvre-là, ce n’est pas seulement une peinture, c’est un monument commémoratif. Picasso l’a peint au printemps 1937, quelques jours après le massacre de Guernica, survenu le 28 avril. L’Espagne est alors en proie à la guerre civile : républicains et nationalistes s’affrontent pour le pouvoir depuis dix mois. Sur ordre de Franco, l’aviation allemande bombarde la ville de Guernica, symbole de l’autonomie du Pays basque. Pendant trois heures, une pluie de bombes s’abat sur la ville, qui est détruite à 70%. Des centaines de personnes (le chiffre est encore débattu aujourd’hui) périssent.

La ville de Guernica est une cité à faible valeur stratégique, d’un point de vue militaire. Aussi, ce bombardement est pris pour ce qu’il est : un acte de terreur à l’encontre d’une population civile sans défense.
La genèse du Guernica
Picasso prend connaissance de la tragédie par l’intermédiaire du quotidien communiste Ce soir, qui publie le 30 avril un reportage illustré. Dès le lendemain, Picasso se met au travail : c’est le massacre de Guernica qu’il représentera en réponse à la commande que lui a passée le gouvernement espagnol en janvier précédent pour orner le Pavillon du pays à l’exposition internationale de Paris, qui doit ouvrir à la fin du mois de mai. Il abandonne donc le sujet qu’il avait précédemment envisagé, le peintre au travail, pour composer ce qui deviendra le plus grand tableau d’Histoire du XXe siècle.

En quelques jours, Picasso créé des dizaines de dessins préparatoires, élabore une composition, travaille les différentes figures : les chevaux, le Minotaure, le soldat, la mère à l’enfant mort. Le 11 mai, Picasso reporte sur la toile la composition. Il lui faudra trois semaines pour achever la peinture. L’œuvre est installée dans le pavillon dans le courant du mois, avant l’inauguration officielle le 12 juillet 1937, dans une relative indifférence.

Pour ceux qui sont touchés, de près ou de loin par la guerre civile espagnole, en revanche, l’œuvre devient vite un symbole, bien qu’elle soit souvent incomprise : pour les uns, elle est trop engagée, pour les autres pas assez. En effet, le gouvernement républicain, commanditaire de l’œuvre, aurait apprécié une composition au message idéologique plus clairement lisible. L’œuvre de Picasso n’est pas une peinture militante, mais une peinture de deuil, qui hurle la douleur d’un peuple massacré. Tout en figurant le bombardement de Guernica, elle s’élève au-dessus de l’anecdote et semble déjà préfigurer le destin tragique de l’Europe tout entière. C’est un tableau d’histoire, une scène de bataille du XXe siècle, la figuration d’une guerre industrielle qui va éclater quelques semaines plus tard.
De Paris à Madrid, en passant par New-York
Après l’exposition internationale de 1937, le tableau de Picasso, propriété de l’Espagne, ne regagne pas tout de suite le pays : il est d’abord envoyé en Norvège, en Suède et au Danemark pour une série d’expositions sur l’art contemporain. Il voyage ensuite en Angleterre et aux États-Unis où il est montré dans des levées de fonds au profit des troupes républicaines.

Franco gagne la guerre civile, tandis que l’Europe s’enfonce dans la terreur. Aux États-Unis, l’œuvre marque les esprits et se charge d’une symbolique nouvelle au regard des événements qui se déroulent sur l’ancien continent.
Picasso dépose alors plusieurs de ses œuvres au Museum of Modern Art, à New-York, institution avec laquelle il signe un accord : le tableau restera au musée jusqu’à ce que l’Espagne redevienne une démocratie. Si Guernica fait plusieurs fois le voyage vers l’Europe au cours des années qui suivent, Picasso n’aura pas la joie de le voir installé à Madrid. La dictature franquiste prend fin en 1975, deux ans après la mort du peintre. Guernica ne gagnera l’Espagne qu’en 1981.

Guernica est à voir au Musée Reina Sofia à Madrid. L’oeuvre, fragilisée par un quarante ans d’errance, ne voyage plus. L’exposition Guernica, actuellement présentée au Musée Picasso à Paris, ne contient donc pas le Guernica, mais bien d’autres oeuvres de Picasso, ainsi que des études et une riche documentation qui permettent de mieux approcher l’oeuvre et son histoire.


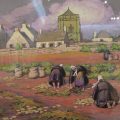


Excellent article, merci. La grandeur de Picasso tient à son humilité dont Guernica est le symbole.
lol, dans les divers et variés témoignages de personnes ayant rencontré/ fréquenté Picasso de son vivant, le mot humilité n’apparaît jamais le concernant.
Allez vérifier honnêtement, vous y trouverez plutôt le contraire.
Connaissez-vous les « Hiroshima Murals » par les peintres japonais Iri et Toshi MARUKI ? C’est l’équivalent asiatique de Guernica. Les artistes qui avaient de la famille à Hiroshima, apprenant le bombardement, s’y sont rendu sans se douter de ce qu’ils allaient découvrir: pire que les morts et la ville rasée: les survivant horriblement brûlés,aveugles,la peau tombant en lambeaux, mourant de soif…8 grands panneaux de 1.8 x 7.2 m. On peut trouver de la documentation et des images sur Internet.
Jean-Marie Gillis
Très belle chronique. J ai eu la chance de voir le tableau à Madrid. Nous étions très peu. Et ce fut la même sensation d étouffement, de grandeur et de souvenirs sur les souffrances du monde! Merci
Ton reportage est à la hauteur de l’oeuvre immense que tu présentes. Merci, Joh.
Bonjour !
Un spécialiste espagnol suscite la polémique en prétendant que l’œuvre de Picasso n’a jamais rien eu à voir avec le bombardement de la ville basque. la thèse est hardie, mais pas sans fondement. Il faudra bien, pour certains se résigner, à ne plus regarder regarder Picasso comme un demi-dieu. Voir ce tableau avec un regard dépassionné et politiquement plus neutre. Pourquoi ne pas rendre compte dans votre article de cette polémique ?
J’ai eu la possibilité de voir le tableau à Madrid, dans de bonnes conditions de visite c’est-à-dire, sans la « foule d’anonymes, pressante et bruyante malgré les rappels à l’ordre des gardiens » comme vous l’écrivez. Il y avait ce jour-là une magnifique rétrospective J. Sorolla.
Cordialement.
Bonjour. Je n’ai jamais rien entendu ou lu à propos de cette polémique… ce qui explique que je n’en parle pas.
J’ai fait une rapide recherche dans Google Actualités et peu de résultats en français apparaissent ; un article du Figaro accessible uniquement aux abonnés, et un autre d’Arte. J’ai parcouru la presse espagnole, évidemment plus prolixe sur le sujet. Il semble que l’ouvrage ait été critiqué pour son manque de rigueur scientifique. L’auteur, Maria Juarranz de la Fuente, apparaît comme un enseignant en histoire-géographie. A-t-il véritablement mené le travail de recherche qui s’impose, avec la rigueur exigée par notre discipline scientifique ? Les journalistes et le corps scientifique semblent en douter… Encore un auteur qui veut surfer sur la vague d’Alesia est dans le Jura et Troie en Angleterre ? Il me semblerait…
Le Musée Picasso expose actuellement un ensemble assez complet de pièces d’archives et de croquis relatifs à la création de Guernica et à l’engagement de l’artiste à cette période : il me semble très douteux d’en faire abstraction !
Que Picasso ait mêlé à cette oeuvre des éléments autobiographiques, c’est fort probable : il puise d’ailleurs dans un répertoire personnel (le cheval, la femme qui hurle, la lampe, le taureau) que l’on retrouve dans des tableaux qui eux, sont clairement autobiographique. Que l’oeuvre puisse avoir plusieurs degrés de lecture, il ne faut aucun doute : c’est le cas de nombre des créations de Picasso et, concernant celle-ci, Picasso l’a souvent laissé entendre. L’exposition actuellement à Paris évoque cette complexité d’interprétation des éléments constitutifs de la toile… Mais, de là à réécrire l’histoire pour affirmer que l’oeuvre n’a rien à voir avec Guernica, c’est un peu fort, vous en conviendrez !
Quant à Sorolla, vous avez bien de la chance d’avoir pu admirer cette rétrospective. J’ai visité son musée et une exposition à Giverny, c’est un fascinant peintre, dont je reparlerai un jour sur ce blog.
Beau post, très bien documenté, bravo ! Pour moi, il fait clairement écho au premier épisode de la deuxième saison de la série Genius, consacrée à Picasso, et où on saisi bien d’ailleurs la difficulté pour Picasso d’être engagé sans l’être : à l’époque, il est déjà reconnu et vit vraiment comme un bourgeois, il a des affinités politiques mais qui ne se lisent que très peu sur son travail, jusqu’à Guernica. Bon, ils appuient un peu sur le fait que Dora Maar le pousse à critiquer ouvertement ce fait, là, je ne sais pas trop si c’est vrai, même si elle est vraiment engagée politiquement. De plus, il faut aussi préciser que cette toile fut pour lui problématique parce qu’elle est quand même assez grande, comparée à ce qu’il a pu faire avant, et que ce type de format est un défi réel pour lui (et pour n’importe quel peintre).
Bien sûr que Picasso y met des choses personnelles et que la toile n’est peut-être pas exact d’un point de vue scientifique, mais il se sert de tout ce qu’il a vu, a vécu, la douleur qu’il a pu voir autour de lui, c’est sans doute ce qui fait la force de Guernica. Ceci dit, je suis d’accord avec un commentateur précédent : arrêtons de poser Picasso en demi-dieu de la peinture, car, s’il a bien révolutionné la peinture, en revanche, il a été sacrément opportuniste, et l’humilité n’est pas du tout le point fort du monsieur… Ce qui n’enlève rien à la puissance de l’œuvre Guernica bien sûr.
Merci en tout cas pour ton très beau post, je comprends les sentiments qui peuvent se faire jour devant une telle toile, d’autant plus que le contexte n’aide pas (trop de monde pour ma part).
Belle journée
Alexandrine