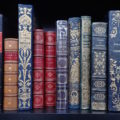Chaque année, outre les marchands, sont conviés au Salon du livre rare quelques invités : institutions publiques, artisans d’art, associations. C’est des stands de la Bibliothèque nationale de France et de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine que je vais vous parler dans ce dernier billet consacré au Salon international du Livre rare et de l’objet d’art 2018.

Les belles impressions du département des estampes
Des invités institutionnels, le département des estampes de la Bibliothèque nationale de France est un régulier : chaque année, les conservateurs sélectionnent une vingtaine d’estampes parmi leurs pièces les plus remarquables afin de délecter le public.
Cet accrochage est à ne manquer sous aucun prétexte, car les conservateurs veillent toujours à choisir des épreuves qui ne sont pas susceptibles d’être redondantes avec celles des marchands.
Cet accrochage est toujours thématique : « les animaux » une année, « la vie d’artiste » une autre. Et, pour cette édition 2018, Rémi Mathis et Valérie Sueur, respectivement en charge des collections XVIIe et XIXe siècle ont composé une sélection autour du génie créateur, excellent prétexte pour dévoiler la fabrique de l’estampe. Dessins préparatoires, tirages d’états, anatomie d’estampes en couleurs, nous voici plongés dans les secrets de la création.
Plus ancienne des pièces exposées, un tirage de la Vierge à l’Enfant dans la grotte, gravé d’après un tableau peint par Mantegna pour la chapelle ducale de Mantoue.
C’est un burin fascinant, car probablement resté inachevé (en tout cas, aucun état plus avancé n’est connu). L’effet, avec cette vierge et sa nuée d’anges si fouillés, contrastant avec ces mages justes esquissés, est très frappant.

Pour l’historien de l’art, ces estampes inachevées comme les tirages d’états sont plein d’enseignements, car ils permettent de mieux comprendre la façon dont procédaient autrefois les graveurs. Ici, le burin a d’abord tracé les contours des figures et les zones de valeur avant de s’attacher aux modelés.
Malgré tout ce que ce tirage d’état dévoile, cela ne permet pas de dissiper toutes les interrogations qui demeurent sur l’oeuvre gravé d’après Mantegna, un des premiers artistes de la Renaissance italienne à entretenir des liens si étroits avec l’univers de la gravure, bien que l’on doute qu’il ait lui-même manié la pointe.

J’ai vraiment apprécié de voir cette estampe présentée, car la conférence de Caroline Vrand (également conservatrice au département des estampes), en décembre dernier, à la BnF, m’avait franchement donné envie d’explorer plus en avant l’oeuvre gravé d’après Mantegna. Pour illustrer, j’ai cependant pris l’exemplaire du Metropolitan Museum, car ceux de la BnF ne sont pas encore numérisés.
J’ai trouvé tout aussi généreuse la présentation du Pont au change de Meryon – auquel j’ai déjà consacré un article : au Salon, on pouvait admirer non seulement deux états de l’estampe, mais également un dessin préparatoire, qui témoigne de la grande précision des relevés de l’artiste.



Le voisinait un dessin de Manet, accompagné de l’eau-forte qui en a été tirée, un montreur d’ours, pièce que j’ignorais totalement de son oeuvre gravé.
J’ai consacré, il y a quelques années, un billet aux eaux-fortes de Manet, sur le blog de la bibliothèque de l’INHA, Sous les coupoles.
Mon coup de coeur absolu sur le stand de la BnF, a été pour ces épreuves d’état de Calamatta, qui témoignent du travail du graveur pour traduire Le Voeu de Louis XIII d’Ingres, au burin. Jusqu’à l’invention de la photographie, la gravure était la seule manière de reproduire et de diffuser, rapidement et en nombre, une image d’un tableau. Aussi demandait-on à des graveurs professionnels de se charger de l’interprétation sur cuivre. On parle d’interprétation ou de traduction, car c’est bien là le travail du graveur : il transpose d’un médium (la peinture) à un autre (la gravure). Il doit adapter la touche, les couleurs, au langage en noir et blanc de l’estampe, au vocabulaire des taille et contre-taille. Parler de simple « reproduction » serait méconnaître, minimiser, voire nier toute l’intelligence du graveur, tout son savoir-faire.

Ingres peint le Voeu de Louis XIII en 1824 sur une commande du Ministère de l’Intérieur. Le tableau, destiné à la cathédrale de Montauban, rencontre un vif succès lors de sa présentation au Salon. L’interprétation de l’oeuvre est confiée à Luigi Calamatta, un graveur italien alors installé en France, qu’Ingres connaissait. La pièce va l’occuper douze ans, et sa parution va être un succès, comme en témoigne le commentaire de Gustave Planche, paru en 1837 dans la Revue des deux Mondes : « Nous sommes heureux de retrouver dans la gravure de M. Calamatta les qualités qui distinguent M. Ingres. (…) Le burin a suivi le pinceau pas à pas, avec une fidélité religieuse. (…) Il est évident pour nous, il sera évident pour tous les esprits attentifs, que M. Calamatta s’est profondément pénétré de la pensée du peintre, qu’il est monté jusqu’à la source même de cette belle composition, qu’il s’est inspiré de la croyance religieuse, sans laquelle ce tableau ne serait pas ».
Se pénétrer de l’oeuvre, oui, Calamatta en a eu le temps, puisqu’il lui a fallu douze ans pour venir à bout de l’interprétation. Douze années de labeur et d’efforts, dont les tirages d’état gardent la trace. À plusieurs reprises, pour juger de l’avancée de la gravure, Calamatta a fait tirer des épreuves de sa planche encore inachevée. L’un de ces tirages d’état est d’autant plus précieux qu’il est annoté par Ingres, qui conseille à Calamatta les parties à retoucher, et l’encourage « Cher ami (…) courage, courage, jusqu’au bout ».
De la même façon, la présentation des tirages séparés des planches composant Au Jardin d’Henri Guérard permettait de comprendre en un coup d’oeil comment on réalise une estampe en couleurs. L’artiste a décomposé son image en trois planches, qui correspondent aux trois couleurs employées : le bleu, le rouge et le jaune.

Chaque planche est gravée à l’aquatinte, roulette et pointe sèche, puis imprimée en superposant parfaitement les matrices. Un exercice qui exige une certaine dextérité !
Mémoire du papier : l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine
Je n’ai pu passer que peu de temps sur l’autre stand « Invité », bien que j’ai depuis longtemps une fascination pour l’institution cette année à l’honneur, l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC).
Installée en Normandie, près de Caen, l’IMEC est un centre d’archives de l’édition et conserve à ce titre, des centaines de mètres linéaires de notes, éditions originales, manuscrits….
La salle de lecture de l’Institut est fascinante et participe à elle seule de mon engouement pour le lieu : elle occupe l’ancienne église abbatiale d’Ardenne, réaménagée avec élégance.

Des chercheurs du monde entier viennent y consulter des fonds, participer à des colloques et séminaires. Ils peuvent même résider sur place !
L’IMEC s’ouvre aussi au grand public à l’occasion de conférences, rencontres, ateliers, expositions, visites guidées…
Je ne vous cache pas que je rêve, un jour, d’y faire un reportage pour le blog !
Pour le public du salon, l’IMEC avait conçu une petite exposition de quelques-unes de ses pièces remarquables, autour du thème du « génie créateur », partagé avec la Bibliothèque nationale de France.
Ainsi, on pouvait lire des extraits du manuscrit du Temps des Assassins de Philippe Soupault ; du Journal d’un voleur de Jean Genet, raturés, basés, biffés, corrigés.
Certains sont sages, appliqués, ordonnés, d’autres spontanés, désordonnés, raturés, taillés au vif, comme l’impressionnante page du manuscrit de L’homme et l’enfant d’Arthur Adamov.
Mais ce qui m’a le plus plu, impressionnée, c’est le script d’India Song de Marguerite Duras, annoté en couleurs.

Je vous ai déjà fait part de mes émotions à la vue de ces brouillons d’écrivains, qui offrent la sensation d’être « au-dessus de l’épaule du créateur ». J’avais ressenti cela devant les archives de Barthes, je l’ai à nouveau éprouvé ici.
C’est avec cette évocation, trop rapide, j’en conviens, de deux des stands invités que se clôt ce cycle de billets retours sur le Salon international du livre rare et de l’objet d’art 2018. J’espère que cela vous a autant plu à lire que moi à les rédiger (malgré le travail énorme que cela représente). Rendez-vous en 2019 sous les verrières du Grand Palais ?