Si vous vous intéressez un tant soit peu à l’histoire de Paris, nul doute que vous avez déjà croisé l’une de ses photographies, et peut-être retenu son nom, Eugène Atget. L’homme, devenu photographe sur le tard, est l’auteur d’un œuvre considérable : plus de 8000 clichés lui sont attribués. Nombre d’entre eux concernent Paris. De 1897 à son décès, en 1927, Atget a méticuleusement photographié chaque rue ancienne de la capitale, chaque détail pittoresque, tout ce que Paris comptait d’immeubles menacés, de petits métiers mourants, jusqu’à écrire « Je possède tout le vieux Paris ».

Ce billet fait suite à la visite guidée que j’ai donnée dans le cadre des 20 ans de Gallica, et que j’ai reprise pour les Journées du Patrimoine 2018 pour le compte de la Bibliothèque nationale de France.
Aujourd’hui, ces clichés, tirés avec plus ou moins de soin, se trouvent par milliers dans les grandes institutions parisiennes et – par les hasards des rencontres et des passions – au MoMA à New York. Numérisés, ils font le bonheur des nostalgiques du Paris d’autrefois. Pour ce nouveau billet, je vous propose une exploration – forcément superficielle – de l’immense œuvre de ce photographe « documentaliste » .

Paris immortalisé, Paris comme nous ne le verrons jamais plus, Paris un peu mystérieux. Si les photos d’Atget ont parfois une aura de mystère, la carrière de leur auteur n’est elle-même pas dénuée d’énigmes…
Un photographe né du hasard de la précarité
Atget n’est pas de ces photographes précocement tombés amoureux de la technique et de la pratique. Il y vient tardivement après avoir renoncé à sa vocation première, celle du théâtre. Monté à Paris en 1878 pour y devenir comédien, il abandonne le conservatoire après deux ans d’une scolarité en pointillé, son service militaire lui ayant interdit toute assiduité en cours. Il se produit certes sur les planches de théâtres de banlieue et de province, mais toujours dans des rôles mineurs, qui ne lui fournissent pas de quoi vivre.
Il s’essaie alors un temps à la peinture et à la caricature avant d’embrasser la carrière de photographe. Nous sommes au début de la décennie 1890. Personne ne sait qui a initié Atget aux maniements des appareils ni à l’art délicat du développement photographique.

Il ne semble pas y avoir une grande ambition artistique dans ses premiers travaux : Atget entend d’abord commercialiser des sujets d’étude qui puissent servir de document à des peintres et des artisans. Scènes champêtres, études de fleurs, nus, autant de clichés utiles à tout artiste au travail.
Mais en cette fin de XIXe siècle, le marché des clichés d’études pour artistes n’est-il pas déjà bouché ? De grandes maisons commercialisent déjà d’immenses catalogues d’images destinées aux élèves de l’École des Beaux-Arts, aux artistes installés et aux artisans d’art… Comment lutter face à cette concurrence ?
Garder trace du vieux Paris
Après quelques essais, Eugène Atget trouve un marché de niche, celui du « Vieux Paris » . Certes, Atget est loin d’être le premier à photographier Paris : Marville, Charles Nègre avant lui avaient déjà arpenté la capitale chargés de leurs lourds appareils. Ils immortalisaient ce « Paris qui s’en va », les vieux quartiers menacés par les grands travaux de modernisation urbaine d’Haussmann.

Atget lui se lance quelques décennies après ces illustres prédécesseurs. La voie est relativement libre, et il existe une demande de la part d’une clientèle spécifique : les amateurs du patrimoine local (collectionneurs, historiens amateurs, membres de sociétés savantes) et, surtout, les institutions (archives, bibliothèques, musées). Ces dernières sont alors engagées dans la constitution de grandes collections « topographiques », qui rassemblent des images (estampes, photographies) classées par zones géographiques. Bien avant Google Images et les bases de données, ces collections sont un précieux instrument de travail pour l’histoire urbaine et patrimoniale.

Atget a compris ces attentes et va adopter une méthode rigoureuse pour fournir à ses clients ce qu’ils recherchent. Il se concentre sur les vieux quartiers et le « Paris historique ». Grâce à des guides, dont celui rédigé par le marquis Félix de Rochegude, Atget repère les adresses dignes d’intérêt, soit pour l’architecture du bâti, soit pour les événements historiques qui s’y sont déroulés. Ensuite, il attend le moment propice pour venir photographier les façades et les rues : les conditions météorologiques doivent être excellentes et la lumière idéale. Souvent, Atget réalise des séquences qui forment un itinéraire (vue d’ensemble de la rue, façade, détail isolé), restituant une expérience similaire à celle du flâneur.
Une séance de prise de vue est toute une aventure, car Atget est de l’« ancien monde », photographiant avec un lourd appareil photo en bois « à la chambre » et des plaques de verre. Il faut un trépied pour le supporter et passer sous le « voile noir » pour effectuer la mise au point. Une démarche surprenante, un peu archaïque, alors que triomphent les petits appareils maniables et les supports souples. Jusqu’aux derniers mois de sa vie, Atget restera fidèle à cet encombrant attirail, qu’il continue de porter seul malgré ses soixante-dix ans.

Une petite entreprise
Les prises de vues effectuées, Eugène Atget développe les clichés dans son petit trois-pièces, les inventorie, les classe, puis part, classeurs sous le bras, présenter sa marchandise à ses clients. Cet aspect commercial est connu grâce à un petit carnet de clientèle, où il notait scrupuleusement les adresses et fonctions de ses interlocuteurs, quel jour et à quelle heure il fallait se présenter, ce qui les intéressait, ce qu’il leur avait montré ou vendu, pour combien… et la qualité de leur accueil : « George Raymond, mauvais, inutile d’y retourner » !

À mesure qu’il vendait ses tirages, Atget en développait de nouveaux. De cette activité artisanale (il travaillait seul, aidé de sa compagne), on garde un témoignage amusant : il développait ses tirages à la lumière du jour, sur son balcon, lieu où il ne boudait pas son plaisir de déclamer ses tirades préférées… pour le plus grand malheur de ses voisins !
Un inventaire systématique du Vieux Paris
L’œuvre d’Atget, on l’a compris, est tournée tout entière vers le Vieux Paris : « J’ai recueilli, pendant plus de vingt ans, par mon travail et mon initiative individuelle, dans toutes les vieilles rues du vieux Paris, des clichés photographiques (…) documents artistiques sur la belle architecture civile du XVIe au 19e siècle : les vieux hôtels, les maisons historiques ou curieuses, les belles façades, belles portes, belles boiseries, les heurtoirs, les vieilles fontaines, les escaliers de style (…); les intérieurs de toutes les églises de Paris (…). Cette énorme collection, artistique et documentaire est aujourd’hui terminée. Je puis dire que je possède tout le vieux Paris. » écrit-il en 1920 à Paul Léon, directeur des Beaux-Arts.
Mais pourquoi le Vieux Paris et jamais le nouveau Paris, celui des boulevards, de la modernité (rappelons qu’il meurt en 1927!) ? Ce n’est pas cela qui l’intéresse, mais les rues pittoresques, les immeubles menacés de destruction, les dernières manifestations des petits métiers appelés à disparaître… En cela, Atget s’inscrit dans une tradition de représentation – par le dessin, la gravure, la photographie et la littérature – du « Paris qui s’en va », tradition née au milieu du XIXe siècle avec les grandes vagues de transformations et de modernisation de la capitale.
Conscients d’être les derniers témoins d’un monde disparaissant, les artistes ont pris leur crayon pour fixer le souvenir du Paris pittoresque, suivi bientôt par les photographes. Au même moment, les travaux historiques sur Paris se multiplient, des collections se forment, et aboutissent bientôt à la création d’un musée – le musée Carnavalet, et d’une bibliothèque – la bibliothèque Historique de Paris.

Atget va travailler spécifiquement pour ce type d’institutions, leur fournissant les images nécessaires pour alimenter les grandes collections « topographiques » que l’on constitue alors. Son propre classement est tout entier tourné vers ce but : il range ses images en séries, elles-mêmes divisées en sous-séries. On y trouve notamment Paris pittoresque, Art dans le vieux Paris et Topographie du vieux Paris. Les clients peuvent acheter à la pièce une image tirée de l’une ou l’autre de ses séries, ou bien opter pour un album constitué par Atget, comme « Enseignes et vieilles boutiques » ou « Les zoniers ».
Atget, une figure majeure sauvée de l’oubli
Atget aurait pu rester un inconnu pour nous tous. Ses clichés, publiés de son vivant, ou bien intégrés aux collections topographiques des bibliothèques, ne sont pas accompagnés de son nom : ils sont considérés comme des documents et non comme des œuvres photographiques. Il a fallu, ces dernières décennies, d’intenses fouilles dont les cartons, recueils et autres classeurs pour redonner à ces images anonymes la signature d’Atget.
La transmission de la mémoire d’Atget doit beaucoup aux surréalistes, et, plus encore, à une femme, Bérénice Abbott, qui va sauver, à la fin des années 20, le fonds d’atelier du photographe.

Bérénice Abbott a alors 27 ans. Assistante de Man Ray, elle découvre par son intermédiaire leur voisin de quartier, Eugène Atget. Les photographies du vieil homme la fascinent. Les clichés circulent parmi les artistes des avant-gardes et les surréalistes, captivés par les photographies de vitrine, les jeux de reflets et les flous, déclarent Atget comme l’un de leurs précurseurs. Ils accrochent ses images aux côtés des leurs et les publient dans leurs revues.
En 1927, Atget disparaît. Bérénice Abbott se démène pour sauver sa mémoire et rachète son fond d’atelier (1500 négatifs et 10 000 tirages) pour 10000 francs. Elle l’emporte aux Etats-Unis où elle va organiser des expositions pour faire connaître le photographe disparu. Son travail aboutit, en 1968 à l’acquisition du fonds par le Museum of Modern Art de New York, qui possède ainsi le plus vaste ensemble d’œuvres d’Atget en dehors de Paris.

Explorez le fonds Atget sur Gallica !
Des 8000 clichés qu’Atget a laissés de Paris, la Bibliothèque nationale de France en possède près de la moitié. Ces 4000 photographies ont été parmi les premières images à rejoindre Gallica lors de sa création, il y a vingt ans… Depuis, l’offre s’est étoffée des clichés possédés par la bibliothèque de l’Institut national d’Histoire de l’Art et de la bibliothèque historique de la Ville de Paris.
La quantité pourrait décourager les Gallicanautes les moins avertis. Pour vous aider dans votre exploration des fonds, voici quelques conseils pratiques, que j’avais déjà donnés sur le blog Gallica.
La plus simple façon d’accéder aux clichés d’Atget est de passer par le menu « sélections », en haut à droite de la page, et de choisir « images » puis « photographies » et enfin « photographie par auteurs ». Un lien vous permettra de visualiser les 3967 documents de la Bibliothèque nationale de France dus à Atget. Pour aller plus vite, vous pouvez aussi cliquer ici.

Mais cette « sélection » ne comprend que les clichés conservés à la BnF et exclut ceux des bibliothèques partenaires, aussi présents dans Gallica. Pour les voir, utilisez le moteur de recherche et tapez simplement « Atget ». Vous pourrez ensuite filtrer par type de document (« image ») et ainsi accéder à plus de 6000 clichés. Pour vous retrouver dans cette masse, n’hésitez pas à affiner votre recherche en entendant le nom d’une rue ou le numéro d’un arrondissement dans le champ prévu à cet effet, dans la colonne de gauche. Les clichés originaux appartenant au département des estampes sont, pour leur exemplaire physique, classés dans des boîtes par arrondissement. En consultant la notice détaillée, vous pouvez repérer la cote du quartier qui vous intéresse et relancer la recherche sur cette cote uniquement.

Une partie des clichés a été géolocalisée automatiquement sur une carte interactive dans le cadre du projet Gallicarte (lauréat du premier hackathon de la BNF) : c’est ici pour y accéder.
Pour aller plus loin
- L’exposition virtuelle Atget sur le site de la BnF (très complet, déclinaison de l’exposition de 2007)
- Guillaume Le Gall (dir.), Atget : une rétrospective, Paris, Bibliothèque nationale de France / Hazan, 2007, 287 p.
- Jacques Bonnet, Eugène Atget. Un photographe si discret, Les Belles Lettres, coll. « Histoire de profil », 2014, 228 p.
Mais aussi :
- Sur le blog de Gallica, la version « billet » de ma visite guidée
- Sur le Huffigton Post, mon article Plongée dans Paris avec Gallica
- Et sur ce blog, un article sur la Zone de Paris, avec beaucoup de clichés d’Atget et une enquête sur les traces des affiches que l’on voit dans les photos d’Atget.











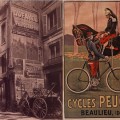



Que signifie cette date « 1793 » dans la légende ? :
« Eugène Atget, Maison d’André Chénier en 1793 – 97 rue de Cléry, 1909, Gallica/BnF »
C’est une référence au principal point d’intérêt qui a motivé la photographie d’Eugène Atget. Il immortalise des immeubles généralement soit pour les événements historiques qui s’y sont déroulés (arrestation, assassinat, lieu de vie d’une célébrité, comme ici) soit pour la qualité de l’architecture ou l’aspect pittoresque du bâtiment. Pour repérer les lieux intéressants, il s’aide du guide pratique à travers le Vieux Paris du Marquis de Rochegude.
Je ne connaissais pas André Chénier, mais Wikipédia m’a appris que c’était un poète et journaliste engagé pendant la Révolution. Il vivait en 1793 à cette adresse, rue de Cléry (il y a maintenant une plaque commémorative sur la façade). Il a été arrêté en 1794 et est mort sous l’échafaud. Pour en savoir plus sur sa vie : https://fr.wikipedia.org/wiki/André_Chénier
Merci !
Charles Baudelaire, témoin de la démolition du Paris ancien par Haussmann, a formulé cette forme nouvelle de nostalgie dans un poème qu’il ajoute à la deuxième édition des Flaurs du Mal en 1861, « Le Cygne », où il montre un malheureux cygne égaré au milieu des gravats :
« Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville
Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) »
On peut lire le poème entier à https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Cygne
D’autre part, le souci qu’avait Atget de dresser un inventaire – qui est bien mis en valeur dans le titre de l’article – rapproche le photographe de certains écrivains qui sont ses contemporains comme Emile Zola ou Jules Verne.
Je ne connaissais pas ce poème et je vous remercie, cher Jean-Michel, de me le faire découvrir.
Oui, c’est très « à la mode » ces grands inventaires systématiques et ces panoramas d’une ville, d’un sujet ou d’une société… Quelles entreprises ! Une des raisons pour lesquelles j’adore le XIXe siècle !
Bonjour,
Atget a également photographié la banlieue. Je me souviens avoir vu des photographies de Bièvres, du Parc de Chamarande, de Versailles… Ces images sont moins connues et c’est très certainement dommage. On en trouve certaines sur Gallica et le musée d’Île de France à Sceaux en possède un grand nombre.
Tout à fait ! J’ai déjà parlé, sur le blog, des photos de la Zone, mais je n’ai pas encore exploré la banlieue et les beaux parcs. Atget a aussi photographié certaines villes de province, comme Rouen, ce dont je compte bien parler un jour !
Je n’avais pas capté qu’Atget était mort si tard (1927 comme tu le soulignes justement). Ces photos semblent remonter à 1850 ou 1870… ce décalage est très troublant.
Oui, hein ?!
En fait, ça s’explique : Atget est de « l’ancien monde » : il photographie à la chambre (c’est alors complètement en train de tomber en désuétude, on a déjà l’appareil instantané et ultra-portable) ; il s’intéresse au passé ; il a une démarche documentaire typique du XIXe…
… Et encore plus troublant, c’est qu’il soit considéré comme un père fondateur de la photographie moderne par la fascination qu’il a exercé sur les surréalistes… Cela dit, ces derniers se sont surtout attachés à ses clichés de ses années, où l’on sent déjà une inflexion…