Les 24 et 25 novembre, j’animai mes deux derniers ateliers de linogravure de l’année 2018. Ces ateliers se déroulant dans des bibliothèques ou des musées, ce sont souvent les collections patrimoniales qui inspirent la thématique proposée aux participants.
Le responsable de la bibliothèque patrimoniale de Verdun, Michaël George, avait choisi, pour l’atelier des enfants, « les animaux » et avait sélectionné, dans ses collections, quelques beaux ouvrages sur ce thème. J’ai eu un coup de coeur pour la magnifique édition du Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle et des phénomènes de la nature qu’il avait sorti des réserves précieuses. Aussi me suis-je décidée à partager ce trésor avec les lecteurs de ce blog !

Six mille pages, sept cents planches d’illustrations gravées : voilà un ouvrage qui a du émerveiller ses premiers acheteurs au milieu du XIXe siècle ! En neuf volumes, le Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle propose un tour d’horizon des connaissances botaniques, zoologiques et minéralogiques de son temps.

Sciences pour tous !
Au XIXe siècle, la diffusion des connaissances scientifiques est au coeur des préoccupations de nombreux intellectuels : une solide culture scientifique partagée ne peut que participer au progrès de la nation. Partout, en France, se fondent des associations scientifiques, des muséums, des cours du soir, gratuits et ouverts à tous. L’idée est toujours la même : participer à l’avancée des sciences et diffuser largement les nouvelles découvertes.
L’édition n’est pas en reste et participe grandement de ce mouvement : les publications scientifiques se multiplient, mais également les ouvrages de vulgarisation, qui entendent mettre à la portée de chacun les connaissances dans tous les domaines. De récentes inventions techniques ont permis de baisser les coûts de production des imprimés et d’accroître la quantité d’illustrations, ce qui participe à l’élargissement des pratiques de lecture, notamment dans les couches les plus populaires. Au milieu du siècle, se multiplient ainsi des titres tels que La Science pour tous ou Les Sciences populaires.
Le dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle, publié durant la décennie 1830, s’inscrit dans cette dynamique. Il s’agit en effet d’un ouvrage de vulgarisation, comme le souligne l’introduction : « Nous avons pensé, avec les éditeurs de cet ouvrage, que le moment était venu, pour l’histoire naturelle, de coopérer à ce grand mouvement de la civilisation, et nous venons y apporter notre tribut, en cherchant à faire participer les masses aux belles découvertes que les savants ont faites dans les sciences naturelles. Nous voulons faire connaître aux gens du monde les phénomènes généraux de la nature, les lois qui les régissent (…). Nous ne présenterons pas la science, comme on l’a fait trop souvent, d’une manière abstraite, hérissée de mots techniques et barbares, incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas déjà savants (…). Nous cherchons, au contraire, à exprimer nos idées en langage ordinaire afin que chacun puisse nous comprendre facilement. »
Le propos se veut cependant rigoureux scientifiquement : l’éditeur fustige en effet les dictionnaires abrégés antérieurs, « surannés [et] remplis d’erreurs ». Mais pour être à la portée « des gens du monde et des étudiants », il faut savoir sélectionner les informations pertinentes : exposer comment les mouches se multiplient, quelles sont leurs habitudes, les moyens de les détruire, plutôt que dresser l’inventaire des « 2000 subdivisions d’espèces »…
Un livre emblématique de la belle édition des années 1830
S’il s’agit de vulgarisation, elle n’est pas pour autant totalement populaire : au vu de la préciosité de l’ouvrage, on imagine aisément qu’il n’ait pas été à la portée de toutes les bourses.
Le projet du Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle est lancé au début des années 1830 par Félix-Edouard Guérin-Méneville, un entomologiste déjà reconnu. Il rassemble autour de lui une vingtaine de contributeurs, chargés de rédiger les notices. Plusieurs illustrateurs et graveurs collaborent à la réalisation des planches, gravées sur acier, une technique nouvelle qui a l’avantage de supporter un plus important tirage que la gravure sur cuivre.
Les coûts d’édition d’un tel ouvrage demeurent, malgré les progrès de l’imprimerie, assez élevés. Aussi, comme cela est fréquent à l’époque, Guérin adopte le principe de la publication en livraisons, ce qui facilite la gestion de la trésorerie.
La publication est annoncée avec force publicité : les clients intéressés sont invités à souscrire, c’est-à-dire à payer d’avance pour obtenir un exemplaire à tarif préférentiel. Les textes et les planches leur sont ensuite envoyés en livraisons, à mesure que l’ouvrage est rédigé et imprimé. Dans le cas du Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle, il y aura plus de 700 livraisons, échelonnées sur six ans.

Deux formules sont proposées aux souscripteurs : l’édition avec les planches en noir (c’est-à-dire que les illustrations sont en noir et blanc) ou l’édition avec les planches coloriées. Une livraison avec planche en noir coûte deux sous, le prix est doublé si les planches sont coloriées. Plus tard, le prix des livraisons coloriées atteindra 6 sous.

L’édition conservée à Verdun appartient à cette seconde catégorie. Nous pouvons apprécier la richesse de la mise en couleurs, extrêmement soignée. Certaines planches sont même rehaussées d’une peinture argentée pour imiter les écailles des poissons !
Ce coloriage est réalisé au pinceau dans des ateliers spécialisés ou œuvrent des dizaines d’ouvrières, qui, pour la plupart, demeurent anonymes. Une enquête récemment menée par Martial Guedron et ses étudiants a mis en lumière une de ces entreprises parisiennes, celles de Madame Mantois.

L’édition en noir, évidemment, est moins luxueuse, comme on en jugera dans l’exemplaire numérisé par la BnF et disponible sur Gallica.
La livraison se fait en portefeuille, charge à l’acheteur de faire relier ses volumes. En général, l’éditeur et l’imprimeur délivrent des conseils à cette fin : dans quel ordre insérer les planches, etc. En comparant l’exemplaire de Verdun et celui de la BnF, on remarquera des choix divergents.
L’exemplaire de Verdun, provenant d’une collection privée (fonds Depuiset, donné en 1922), rassemble en trois volumes séparés l’intégralité des planches, tandis que dans l’exemplaire de la BnF, les planches sont insérées à la fin de chaque volume, rapprochant ainsi les illustrations des articles concernés.
Face au succès du Dictionnaire (il se serait vendu, selon le journal La Presse, 12000 exemplaires du titre) une seconde édition en est donnée dans les années 1840, avec quelques corrections, sous le titre de Nouveau dictionnaire classique d’histoire naturelle.

Le succès de la publication se mesure au nombre de citations qu’elle génère dans la presse et le livre. En cherchant « dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle » dans Gallica, on tombe sur de multiples références à l’ouvrage, dans des publications des plus diverses, allant des magazines généralistes aux mémoires de sociétés savantes, en passant par des magazines féminins, la presse professionnelle vétérinaire ou des feuilles de chasseurs.
Postérité d’un ouvrage de vulgarisation
Félix-Edouard Guérin-Ménéville tient là un de ses plus gros succès éditoriaux. Cet entomologiste reconnu a, tout au long de sa vie multiplié les publications. Sa carrière commence en 1822, alors qu’il a à peine vingt-trois ans : il s’embarque pour un tour du monde en rejoignant l’expédition scientifique de la corvette La Coquille. À son retour, il est chargé de la rédaction et de l’illustration des textes consacrés aux insectes, qui paraîtront dans le compte-rendu de l’expédition.

Son activité éditoriale se poursuit durant les décennies suivantes : il collabore aux ouvrages de Cuvier, à l’Encyclopédie méthodique et multiplie les articles. Il fonde également des revues scientifiques, comme le Magasin de zoologie d’anatomie comparée et de paléontologie… Sa bibliographie compte aujourd’hui plus de quatre cents ouvrages et articles, dont l’un des plus célèbres demeure bien sûr le Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle et des phénomènes de la nature.
Aujourd’hui, les éditions coloriées du Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle sont l’apanage des bibliothèques patrimoniales et de collectionneurs. Si les connaissances scientifiques sont désormais bien souvent obsolètes, demeure le plaisir d’admirer les planches si pittoresques. Au fil des illustrations, on relève le nom de quelques dessinateurs et graveurs.
L’oeil averti d’un spécialiste de l’image repérera sans doute quelques emprunts à des illustrations antérieures : les dessinateurs n’ont pas toujours œuvré d’après un véritable spécimen, se contentant de copier des gravures précédemment parues. L’exemple le plus flagrant est sans doute l’image illustrant l’article girafe : on reconnaît sans peine la célèbre silhouette de « Zarafa », la girafe offerte par Méhémet Ali à Charles X. Le dessinateur, Acarie Baron, semble avoir habilement mêlé la sérieuse lithographie parue en 1827 dans les Annales des Sciences naturelles aux accents plus pittoresques d’une xylographie populaire largement diffusée.
Ma planche préférée est sans nul doute celle consacrée à la mygale, d’un effet assez…surprenant !

Pour aller plus loin:
- Feuilleter sur Gallica
- L’exposition virtuelle Sciences pour tous et sa série de billets sur le blog Gallica


























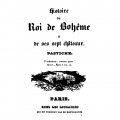




Ping : Dictionnaire illustré et arbre imaginaire | Ligne de Science
Oh, c’est superbe ! J’ai un gros gros faible pour les dictionnaires d’histoire naturelle et les dictionnaires d’anatomie, il faut vraiment que je me réfrène dans les Emmaüs et brocantes… Les illustrations sont très belles, on a envie de toutes les encadrer ! ^^ Merci pour ce beau partage !
Belle journée