Des centaines d’estampes, des dizaines de dessins — moins connus, il est vrai — : voici l’œuvre d’Israël Silvestre, un des plus célèbres graveurs de vues topographiques du XVIIe siècle. Son crayon et sa pointe ont immortalisé les plus beaux points de vue de la France d’alors (on ne disait pas encore panoramas), façonnant et fixant l’image de quelques remarquables châteaux depuis disparus ou de perspectives urbaines aujourd’hui transformées.

Israël Silvestre : en dehors des amateurs d’estampes et des passionnés du Grand Siècle, qui a retenu son nom ? Et pourtant, tant de fois ses gravures ont été reproduites ! Besoin d’évoquer un château du milieu du XVIIe siècle ? C’est certainement une gravure de Silvestre que l’on reproduira. Mais au-delà de ces quelques eaux-fortes tant de fois montrées, que faut-il retenir de sa carrière ?

Jusqu’au 25 juin 2018, le Musée du Louvre consacre une belle exposition à Israël Silvestre, renouvelant profondément la connaissance que nous avons de cet artiste, notamment par la mise en avant de ses dessins, jusqu’alors injustement méconnus.
Israël Silvestre, une vie au rythme du Grand Siècle
Israël Silvestre est un artiste à la longue existence (70 ans !), une vie ponctuée de voyages et de belles opportunités.

Une jeunesse dans le goût de Callot
Il naît en 1621 à Nancy, qui n’appartient pas encore à la France. Son père est peintre, mais depuis peu, semble-t-il : il déclare ce métier depuis son mariage avec la fille d’un artiste en vue de la cour de Lorraine. Le jeune Israël va donc côtoyer, grâce à sa famille maternelle le milieu des arts : son oncle et parrain, Israël Henriet, est un éditeur d’estampes assez important.
Quand, en 1631, Israël Silvestre, alors âgé de dix ans, voit son père succomber à la peste, c’est chez son oncle qu’il trouve refuge, à Paris. Ce dernier va lui enseigner le dessin et la gravure dans la manière de Jacques Callot, dont il est proche et qu’il édite. Israël Silvestre fera d’ailleurs chez son oncle de nombreuses rencontres déterminantes pour sa carrière, comme celle de Stefano della Bella, avec qui il va collaborer un temps.
Les voyages forment la jeunesse, et cela est tout particulièrement vrai pour les jeunes artistes. La destination idéale, la destination rêvée, c’est Rome. En Italie justement, Israël Silvestre va se rendre trois fois, entre 1638 et 1653. De ces voyages, il rapporte de très beaux dessins, dont une impressionnante Vue du Forum depuis le Colisée de plus d’un mètre de long.

Du voyage en Italie, il rapporte également une amitié qu’il gardera toute sa vie : celle de Charles Le Brun, appelé à dominer les arts au cours des premières décennies du règne de Louis XIV. Cet attachement entre les deux hommes ne sera pas tout à fait étranger à la carrière du graveur.
Alors que jusqu’au milieu des années 1650, Israël Silvestre a surtout gravé d’après des tiers, parfois en collaboration avec d’autres (Gabriel Pérelle, Stefano della Bella), et rarement d’après ses propres dessins, Israël Silvestre commence à s’affirmer comme aquafortiste d’invention.
Son amitié avec Le Brun lui ouvre les portes d’un chantier important, celui de Vaux-le-Vicomte, que l’intendant Nicolas Fouquet s’est fait bâtir. Par le dessin, Israël Silvestre fixe les magnificences du palais, les effets savants des jardins. Certains dessins sont gravés, mais la disgrâce de Fouquet, en 1661, interrompt l’édition de la suite complète.
Le discrédit de Fouquet ne nuit aucunement au graveur, aussitôt employé par le roi qui lui confie notamment la tâche de dessiner les fêtes royales : le fameux Carrousel de 1662, les non moins fameux Plaisirs de l’Ile enchantée à Versailles en 1664…
Au service du Roi
Les années 1661-1663 marquent un tournant dans la vie d’Israël Silvestre : il hérite de son oncle en 1661, est naturalisé français la même année, se marie la suivante et enfin est nommé graveur ordinaire du roi en 1663. Tout est en place pour une carrière marquée par les honneurs.
Après les relevés des fêtes données par le roi à Paris et à Versailles, il reçoit une nouvelle commande d’importance : celle de dessiner les villes de l’Est nouvellement rattachées à la France. Le voilà parti pour plusieurs années de séjours fréquents hors de la capitale : Toul, Metz, Verdun, Charleville, Mariembourg…
Pendant ce temps, un autre dessinateur, Van Der Meulen, dans un style très différent, opère lui aussi des relevés systématiques des cités conquises du Nord de la France.
Silvestre cumule progressivement les charges et les marques de reconnaissance : après avoir été agréé à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1666, il reçoit la charge de maître à dessiner des pages de la Grande Écurie, puis, en 1668, c’est un logement au Louvre que l’on lui attribue, marque d’une grande estime. Son ascension n’est pas terminée : deux ans plus tard, il devient conseiller à l’Académie royale de peinture et de sculptures, et, en 1673, il reçoit la charge de maître à dessiner du Dauphin.
Pendant tout ce temps, on le trouve à dessiner les plus belles résidences, à commencer par les maisons du roi. Il grave, pour le cabinet du roi, mais aussi pour son propre compte, parfois d’après de vieux dessins, comme ceux de ses voyages de jeunesse en Italie.
Lorsqu’il s’éteint en 1691, il laisse derrière lui un œuvre gravé aujourd’hui estimé à 700 estampes, ainsi que probablement des centaines de dessins, dont seuls quelques-uns nous sont parvenus.
Les dessins d’Israël Silvestre, une redécouverte
C’est là le point fort de l’exposition du Louvre : mettre en avant l’œuvre de dessinateur de Silvestre, jusqu’ici quasiment ignoré. Les raisons de ce silence ? L’histoire des collections…
Depuis fort longtemps le Louvre conserve des dessins de Silvestre, plus d’une centaine, soit grosso modo les trois quarts de son œuvre dessiné connu. Mais ces dessins, rassemblés dans un recueil, étaient difficiles à manipuler : trop grands, on les a découpés, pliés… un montage qui interdisait d’en regarder deux à la fois et excluait toute idée de prêt ou d’exposition.
C’est sur ce précieux recueil que le cabinet des Arts graphiques du Louvre a porté ces dernières années une partie de ses efforts : factice, constitué au mépris de l’intégrité des œuvres, il menaçait d’entraîner la disparition de certains dessins, fatigués d’être pliés et menaçant de se déchirer.
Le Louvre a donc décidé de procéder au démontage de cet album afin d’assurer une meilleure conservation des feuilles… ce qui a eu d’autres heureuses conséquences. La première est de permettre enfin l’étude convenable des dessins de Silvestre, qui peuvent désormais être comparés, manipulés sans risque. La seconde est que le démontage a réservé quelques surprises, comme la découverte de croquis inédits au dos de certaines feuilles. Et pour finir, la nouvelle indépendance de chaque feuille permet enfin de les exposer et même de les prêter ! Le résultat est sous nos yeux, avec cette belle exposition.

Une exposition comme aventure scientifique
Belle exposition, que j’ai eu la chance de découvrir accompagnée de ses deux commissaires, Bénédicte Gady et Juliette Trey. Rien ne me plait plus que ces visites pendant lesquelles les équipes scientifiques expliquent leurs choix, partagent avec enthousiasme leurs trouvailles, et expliquent avec mille petites anecdotes et exemples comment la recherche avance.
Je pense que cela transparaît bien dans l’accrochage, dans les textes de salles et dans ceux du catalogue d’exposition : la connaissance d’Israël Silvestre s’est affinée, de nouveaux détails sur sa vie et sa manière apparaissent. Plusieurs spécialistes se sont penchés sur les dessins, faisant de nouvelles découvertes. Outre le catalogue de l’exposition, un important article, signé Marianne Grivel, est à paraître : il fera le point sur notre connaissance de l’artiste, à la lumière des pièces d’archives récemment exhumées et des feuilles nouvellement attribuées.
Les attributions, justement, sont le témoignage le plus frappant de cette recherche en train de se faire : un dessin autrefois anonyme, est désormais donné à Israël Silvestre, tandis que tel autre est écarté de son corpus parce que la main ne peut être la sienne. Ce travail d’attribution, nous expliquait Bénédicte Gady lors de la visite, est véritablement facilité par la préparation d’une telle exposition : en rassemblant les dessins, en les accrochant les uns à côté des autres, certaines évidences que l’on aurait difficilement perçues en travaillant sur des reproductions sautent tout un coup aux yeux. Jusqu’au moment de l’accrochage : ainsi, le cartel d’une œuvre a changé au dernier moment parce que la mise en regard de deux dessins faisait tout à coup pencher la balance en faveur d’une hypothèse de main…

Pour l’anecdote, il est apparu, au moment de ce grand chantier, qu’un album du Louvre, appelé depuis des lustres le recueil « Pérelle-Silvestre »… ne contenait aucun dessin de la main d’Israël Silvestre !
Promenade dans la France du Grand Siècle
Au-delà de toutes ces considérations qui raviront les spécialistes, l’exposition Israël Silvestre a de quoi séduire tous les publics, car il suffit de regarder et de se laisser promener dans les paysages : goûter ici l’animation des quais parisiens, s’imaginer là méditatif devant les vestiges de la Rome antique.
En se concentrant bien sur une vue de jardin, je suis sûre que l’on peut entendre le caplotis de l’eau des fontaines, le bruit du râteau de ce jardinier ou encore le lointain murmure de la conversation de ces dames.
Plaisir de voyager virtuellement dans la France du grand siècle, mais délectation, aussi, de savourer les raffinements du crayon d’un dessinateur hors pair.

Les dessins exposés témoignent des techniques employées par Israël Silvestre tout au long de sa vie. L’essai et les notices du catalogue détaillent les évolutions de sa manière, expliquant comment il trace ses relevés aux crayons, avant de les reprendre à l’encre, et, parfois, de les rehausser de lavis et d’aquarelle. À mes yeux, les plus fascinants sont ces dessins aux reprises inachevées : les traits de plume côtoient les tracés au crayon, un lavis gris ou de la couleur fait vibrer quelques détails.
Sur la même feuille, un bâtiment peut être minutieusement décrit tandis qu’un premier plan à peine esquissé de quelques lignes aussi rapidement jetées que sûres. À l’œil qui scrute, qui fouille, le dessin révèle quelques annotations de l’artiste : ce banc-ci devrait être « approché au coin », là le champ est « une terre labourée » tandis qu’ici, une note précise la couleur (« rougeâtre ») pour faciliter l’enluminure postérieure.
Israël Silvestre gravait lui-même à l’eau-forte ses dessins pour en assurer la diffusion. En comparant les dessins aux gravures, on observe la précision de la reprise, mais aussi les aménagements de mise en scène. Ainsi, les personnages, tracés avec facilité, varient au gré des humeurs, apparaissent et disparaissent…
Les personnages : comme j’ai aimé fouiller les paysages à leur recherche. Dans les dessins, je relève ceux juste esquissés au crayon et ensuite négligés par la plume. Ils sont comme des fantômes.
Les dessins — comme les gravures d’Israël Silvestre sont une mine d’or documentaire. Ainsi, n’y a-t-il pas de quoi être fasciné, en lisant dans le catalogue que tel dessin figurant un bal masqué a été identifié par Mickaël Bouffarde comme celui donné par Anne d’Autriche le 15 février 1665 sur la base d’un témoignage d’un chroniqueur, qui relatant cet événement, indiquait avoir croisé dans la salle un peintre et un graveur, qui semble bien être Silvestre. Autre indice concordant : cette petite étude d’une figure costumée en turc correspondrait également à un de ceux décrits par le chroniqueur.
D’une précision documentaire infaillible, Israël Silvestre ? Pas pour autant ! Ne croyez pas que l’on pourrait faire une reconstitution 3D d’un lieu sur la seule foi de ses relevés : Israël a le sens de l’effet, des perspectives, et il n’hésite pas à arranger la réalité si cela lui apparaît nécessaire. Ainsi, dans certaines de ses grandes vues urbaines, il marie plusieurs points de vue pour présenter les bâtiments importants sous leur meilleur angle. Cela n’a rien d’original, c’est même une chose fort courante dans l’histoire de la vue topographique… Mais ce sera pour un autre billet !
Je remercie du fond du coeur Bénédicte Gady, Juliette Trey et les équipes du Musée du Louvre, qui m’ont permis de bénéficier d’une fabuleuse visite guidée de cette exposition, en compagnie des commissaire.
Pour aller plus loin
L’exposition La France vue du Grand siècle. Dessins d’Israël Silvestre (1621-1691) est à voir au Musée du Louvre jusqu’au 25 juin 2018. Le présent billet prend toutes ses sources dans le catalogue qui accompagne cette exposition : Bénédicte Gady, Juliette Trey (dir.), La France vue du Grand Siècle. Dessins d’Israël Silvestre (1621-1691), Paris, Musée du Louvre / Liénart, 2018.
Pour poursuivre la découverte de l’oeuvre d’Israël Silvestre, on pourra :
- Consulter le catalogue en ligne du département des Arts Graphiques du Musée du Louvre ou la liste des oeuvres présentées à l’exposition.
- Consulter le catalogue raisonné de l’oeuvre d’Israël Silvestre, donné en 1857 par Faucheux et numérisé sur Gallica.
- Consulter les dessins et estampes conservés à la Bibliothèque nationale de France et numérisés sur Gallica.
- Découvrir le site web créé par les descendants de l’artiste, où l’on peut consulter des centaines de gravures d’Israël Silvestre


















































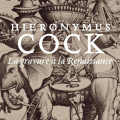

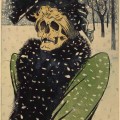
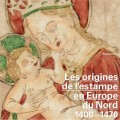
vos articles sont toujours très intéressants, quand bien même (je) on peut être ignorants en ces matières (gravure, graphite, etc).
La curiosité n’est alors vraiment pas un vilain défaut, tant elle reste un univers de découvertes, à la fois captivantes et pédagogiques.
Oh merci 🙂
J’espère bien vous faire aimer passionnément l’estampe et le dessin car … c’est mon projet =D
Je doute de pouvoir en profiter autrement qu’à travers ton chouette billet mais cette expo a l’air vraiment à mon goût !
L’intégration de la frise à la fin est cool, autant dans l’idée que dans la forme.
Oh, comme je regrette que tu n’aies pas la chance de la voir : te connaissant, tu te serais régalé des multiples détails vivants de ces dessins ! Ca aurait même fait des super gif animés… J’espère que mes photos combleront un peu ce manque…
C’est hyper intéressant, et très richement illustré en plus ! Les dessinateurs d’architecture sont rarement restés dans les annales, ce qui est fort dommage, car, avec M. Silvestre, on trouve dans ces dessins et gravures toute la richesse de la vie de son époque, et pas uniquement d’un point de vue architectural : c’est un formidable témoignage anthropologique. Merci pour ce beau partage,
Belle journée
Merci Alexandrine ! Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Je connaissais déjà bien Israël Silvestre, mais cette exposition m’a donné envie d’en savoir plus encore, et également de me replonger dans l’oeuvre des dessinateurs topographes de la même époque … pour de futurs billets ?
Merci de ces si beaux articles (clairs, expliqués, illustrés).
Avant de vous lire je n’aimais pas du tout le dessin, ou exceptionnellement. Je trouvais qu’il me manquait la couleur (je me reprochais du reste de n’aimer que des vignettes de chocolat Poulain), je zappais les vitrines.
Et puis vous lire de ci de là, une expo, une autre, j’ai récemment volontairement cherché à voir l’expo (contemporain certes ) de Philippe Mohlitz « Pilleur de rêves » à Bordeaux alors que j’aurais sournoisement évité avant (le nombre de fois où j’ai évité ces expos au Louvre, car pas le temps, difficile, je n’aime pas, pas pour moi, pff non le dessin et sa variante pfft non l’estampe ..)
Et grâce à vous je commence à apprécier ( voire à me demander si, pour certains, et parfois, et à condition de prendre le temps, ce n’est pas plus subtil et plus émouvant ) et c’est tellement agréable de voir un petit morceau de ciel s’ouvrir …
Semaine prochaine : Israël Silvestre.
Merci à vous