Après vous avoir entretenu des estampes au Salon du livre rare, il est temps de vous parler de bibliophilie. Un gros morceau, puisque le salon compte près de 150 stands de libraires et que ces derniers réservent évidemment leurs plus remarquables pièces pour l’événement.

Cent mille livres
Alors, autant le confirmer tout de suite : je n’ai pas tout vu ! Chaque année, j’essaie d’affiner ma stratégie de visite pour profiter du salon le mieux possible, sans rater trop de stands. Faire un premier repérage, puis approfondir certains stands, dire bonjour aux librairies que je connais, puis papillonner tranquillement.
Cette année, j’ai donc adopté une stratégie très rationnelle : procéder allée par allée, entrecoupant le tout de pauses sympathiques chez les libraires que je connais ou avec des amis croisés par hasard. Armée de mon plan, je me suis presque scrupuleusement tenue à ce plan, notant systématiquement les pièces admirées directement sur la carte du salon.
Une heure et demie après mon arrivée, le jour du vernissage j’avais juste parcouru l’allée E… et encore d’un seul côté ! Vous comprendrez donc que mon compte-rendu soit totalement incomplet, car malgré vingt-cinq heures passées sur le salon, il y a des stands auxquels je n’ai même pas pu jeter un coup d’oeil !
Les découvertes du soir de vernissage
Histoires de moulins
Qu’ai-je vu au salon dans l’allée E ? Un volume, tout au sommet d’une étagère du libraire lyonnais Clagahé, est le tout premier que j’ai remarqué : un ouvrage consacré aux moulins hollandais, publié durant le second quart du XVIIIe siècle. Sa particularité, qui explique qu’il ait retenu mon attention ? Des paperasses, à soulever délicatement, expliquant le fonctionnement et la mécanique des moulins. J’adore ce genre de livres (il y en avait un autre reposant sur le même dispositif, mais consacré aux jardins paysagers), cependant vu le poids et la fragilité de tels exemplaires (et la hauteur de l’étagère), il ne me semblait pas raisonnable de demander à le feuilleter. Malheureusement, il ne me semble pas qu’il ait été numérisé par une bibliothèque : une rapide recherche sur internet ne m’a pas permis de retrouver la trace des textes ici reliés, visiblement rares, sinon sur Wikisource pour l’un d’eux (sans les paperolles).

Matrices et tirages de tête
Au stand suivant, en revanche, j’ai pu feuilleter l’objet de mon intérêt : les frères Eppe, librairies à Paris, alignaient sur leurs étagères de magnifiques reliures. Je ne connais pas grand-chose dans ce domaine, aussi ne vais-je pas vous en parler plus dans le détail, mais j’aime bien admirer les dos et les plats, surtout lorsqu’il s’agit de reliures d’art raffinées et délicates, de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle.
Sur ce stand donc, une reliure avait capté mon attention, car elle était incrustée d’un cuivre gravé. C’est quelque chose que l’on rencontre régulièrement autour de 1900 : les cuivres gravés, qui ont servi à l’impression des illustrations de l’ouvrage, viennent orner les reliures du tirage de tête. Fin plus heureuse pour ces cuivres normalement destinés à être biffés, sinon cassés ou fondus.

Ayant consacré mon mémoire de M2 à la question de la matrice d’estampe, je regarde toujours avec attention ce type d’exemplaires. Voyant mon intérêt, les libraires m’ont proposé de feuilleter le volume. Il s’agit d’une édition d’un texte de Huysmans, En Rade, parue en 1911 et enrichie de 19 eaux-fortes de Paul Guignebault.

Au vu du cuivre enchâssé dans la reliure, j’avais deviné qu’il s’agissait d’un tirage de tête. On désigne sous ce nom les tout premiers exemplaires d’un tirage, que l’on distingue ainsi des exemplaires du tirage dit courant. Le tirage dit de tête, limité à quelques exemplaires se singularise par des particularités comme un papier plus précieux, des illustrations supplémentaires, etc., qui suscitent la convoitise des bibliophiles.
L’exemplaire des Frères Edde présentait, outre le cuivre enchâssé, les caractéristiques des 20 exemplaires de tête de ce tirage qui comptait au total 250 exemplaires : le tirage de toutes les illustrations hors-texte dans leurs trois états (eau-forte pure, eau-forte et pointe-sèche, épreuves en couleurs), ainsi qu’une impression à part, en fin de volume, de tous les bois gravés ornant les pages typographiques. Enfin, une aquarelle originale de l’artiste a été jointe à la reliure. Un vraiment bel exemplaire.
Mon intérêt pour les matrices allait également être satisfait au stand suivant puisque le librairie Pierre Prevost exposait une matrice lithographique de Picasso. Il y a relativement peu de pierres lithographiques encore inscrites d’une composition conservée, car la pierre litho est une ressource rare, onéreuse (et encombrante). Aussi, dès le tirage achevé, si l’on est sûr que le motif n’aura pas à être réimprimé, on l’efface par polissage de la pierre, qui est alors disponible pour une autre création lithographique.

Caricatures sur papier blanc
Continuons notre progression sur les stands de l’allée E. À la librairie Bogatyr Traineau, de Versailles, j’ai reçu un accueil fort sympathique : le libraire m’a montré une édition de Rabelais illustrée par Gustave Doré. Mais j’ai surtout retenu de son stand une collection reliée du journal hebdomadaire satirique L’Eclipse, paru de 1868 à 1876. Cette collection présente un intérêt particulier du fait qu’elle est composée de tirages de luxe sur papier blanc (et non sur papier journal) et que les illustrations sont rehaussées d’aquarelle. C’est une pratique éditoriale relativement courante au XIXe siècle, que l’on retrouve aussi pour les planches du célèbre Daumier. Les amateurs voulant conserver les estampes ou les exemplaires pouvaient acquérir des tirages de luxe sur papier blanc plutôt que les impressions courantes sur papier ordinaire.


Affiches de librairie, et caricatures, toujours.
Arrivée au bout – enfin!- de l’allée E, j’ai entamé l’allée F, en remontant vers le dôme du Grand Palais. Chez le libraire bruxellois Pascal de Sadeleer, j’ai été immédiatement attirée par les affiches de librairies, témoignage relativement rare des outils de promotion du livre au XIXe siècle. Imprimées sur du papier de médiocre qualité, peu pérenne, ces affiches devaient faire la promotion d’une parution nouvelle. Ils portent le titre de l’ouvrage, le nom de son ou ses auteurs, de l’éditeur, les prix de vente – volume relié, numéro ou livraison, le cas échéant -, un argumentaire de l’ouvrage, et, si le tirage est illustré, quelques exemples de bois ou de lithographies. Tout pour aiguiser l’intérêt des clients !

Ainsi, une des affiches présentées annonçait la parution du journal quotidien Le Pamphlet dont l’existence fut très brève (61 numéros) de mai à novembre 1848. Le texte est bref et continent l’essentiel : prix, mode de diffusion, périodicité, type (journal satirique, comique et politique, illustré) et principaux thèmes abordés (« Physionomie de l’Assemblée nationale ; Bouffonnerie du monde politique ; Le dessous des cartes (…); Écho de la salle des pas-perdus (…) ; Nouvelles du monde; Indiscrétions de Salons »). Et, pour bien insister sur le caractère le plus attrayant du titre, ses illustrations, la reproduction d’une quinzaine de ses vignettes et la mention d’une estimation du nombre de gravures à paraître « plus de 5000 par an ».
Ces affiches, qui ne pouvaient être épinglées qu’à l’intérieur des librairies (et non dans la rue) étaient dispensées de l’acquittement du timbre d’affichage, une taxe obligatoire pour le collage en extérieur. N’étant pas destinées à être exposées à tous les vents, ces affiches pouvaient être imprimées sur papier blanc, normalement réservé aux annonces officielles et administratives.
Libertinages et ouvrages coquins
Chez Sadeleer, j’ai jeté un coup d’oeil indiscret sur une petite série d’ouvrages présentés sous vitrine : les célèbres Paysan perverti et La Paysanne pervertie de Restif de la Bretonne était sagement alignés, un seul volume entrouvert dévoilant au flâneur transformé en voyeur, selon un dispositif bien connu de la littérature libertine, une scène très « libre et piquante ».

Les curiosa sont très recherchées des bibliophiles et le Salon en dévoilait plusieurs. Ainsi, un peu plus loin, sur le stand F17 des libraires Hogier et Hatchuel, on pouvait voir une édition illustrée de Thérèse philosophe datée de 1785 et un exemplaire également augmenté de figures de Félicia ou mes Fredaines de Nerciat. Pour compléter ce chapitre très libertin, il me reste à évoquer le stand de Justin Croft Antiquarian Books, où les curieux se pressaient pour jeter un coup d’oeil plus ou moins appuyé à un inventif Album érotique lithographié (dont j’ai malheureusement oublié de photographier le cartel), ainsi qu’à quelques autres publications dans le même esprit.
Bois gravés
Mais reprenons la progression de mes pérégrinations là où je les avais laissées, c’est-à-dire sur le stand F17. Les libraires Hogier et Hatchuel présentaient d’autres ouvrages suscitant mon intérêt. J’ai admiré, par exemple, un superbe cul-de-lampe du XVIIe siècle gravé sur bois, ornant une édition de l’autobiographie d’Uriel Da Costa (1687).

Mais surtout, j’ai repéré une édition, assez rare, du Traité de gravure sur bois de Papillon, un personnage fascinant pour lequel j’ai une grande affection. Fils d’un graveur sur bois, Papillon a consacré sa vie à cette technique alors mal considérée, car jugée trop fruste au regard des raffinements de la taille-douce. Persuadé de la supériorité de la xylographie sur toutes les autres manières de graver, Papillon s’est employé des années durant à compiler l’histoire de la technique, à coucher sur le papier chaque secret et savoir-faire de praticien. La somme de ce travail sera publiée sous forme de traité en 1766. S’il fut moqué par les connaisseurs pour ses nombreuses erreurs historiques, la partie technique est aujourd’hui encore fort précieuse pour les historiens de l’estampe et les graveurs en bois.

Je vous en reparlerai un jour où l’autre, car j’ai depuis plus de trois ans au moins un brouillon de billet consacré à la vie et l’œuvre de Papillon.
À ce stade de la soirée de vernissage du Salon du livre rare, je commençais à me sentir lassée de mon exploration systématique des allées et j’ai donc décidé d’abandonner l’allée F pour saluer les librairies auxquels je suis fidèle depuis des années.
Curiosités typographiques, cartonnages et mouchoirs imprimés
Comme à chaque édition, je me suis délectée du stand de la Librairie Knuff, de Vendôme, qui nous offre toujours une belle sélection autour de l’histoire de la typographie, de l’imprimerie et des techniques en général.
Un florilège de curiosités : catalogues de modèles d’ornements typographiques, livres gravés de calligraphies raffinées, échantillons de superbes papiers marbrés…
Sur le chemin de la sortie, je me suis arrêtée devant la librairie de François Giard (C9, Lille), qui présentait un superbe étalage de cartonnages d’éditeurs, si appréciés du grand public. Il y avait également une belle affiche de librairie, annonçant le fascinant livre de Grandville, Les animaux peints par eux-mêmes (encore un illustrateur dont je dois vous parler, car j’ai eu la chance d’admirer un de ses carnets de croquis à la Bibliothèque municipale de Nancy).
Et alors que retentissait l’annonce déclarant la fermeture imminente du salon, mes yeux se sont posés sur un mouchoir imprimé orné d’un plan de Paris, proposé par Antiquariat Neidhardt.

Encore une chouette invention du XIXe siècle que ces mouchoirs imprimés de plans ou d’autres informations forts utiles, comme les gestes à adopter pour les administrer les premiers secours. Beaucoup de ces mouchoirs étaient produits à Rouen, et j’ai vu, il y a quelques années, une exposition fort intéressante sur ces artéfacts au Musée de Martainville (Seine-Maritime). Encore un sujet potentiel de billet !
… Ce billet étant déjà fort long, je vais m’arrêter là pour aujourd’hui et réserver le récit de la suite de ma visite à une publication ultérieure. J’espère que vous n’en avez pas marre !







![Vicieuses Le Nismois [Alphonse Momas], les petites vicieuses, Paris, 1899, avec aquarelles de Joseph Apoux, librairie Justin Croft](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2018/04/Vicieuses.jpg?w=244&h=339&ssl=1)









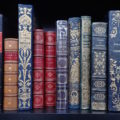




Je savais même pas qu’un tel salon existait, merci pour la découverte ! Je crois que si j’y avais été, j’aurais eu envie de tout voir, tout photographier – chose curieuse…
Quelle chance, il a lieu tous les ans ! Vous viendrez à la prochaine édition ! Je peux tâcher d’avoir des invitations pour quelques lecteurs…
Waw, ce serait fantastique ^^J’aimerais bien ! (Venir, dans tous les cas)
Merci pour ce billet très intéressant, comme tous les autres que vous nous proposez. Un étrange coïncidence : juste avant de lire votre billet je venais d’écouter, dans un colloque, une présentation sur Papillon ! C’est Maxime Métraux qui nous a parlé de ce graveur et de son oeuvre. Peut-être le connaissez-vous ? Il fait justement sa thèse sur la dynastie des Papillon et la gravure sur bois aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Bonjour ! Oh, de quel colloque s’agit-il ? J’essaierai de rattraper mon absence en lisant les comptes-rendus. Je fais une veille sur les thèses en cours en histoire de l’estampe, et j’avais repérée celle de Maxime Métraux, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de lui écrire pour en savoir plus… Ce que je devrai faire 🙂
C’était le colloque des sociétés savantes et du CTHS sur la transmission des savoirs. Il a lieu cette semaine à l’INALCO (du 23 au 27 avril). Les actes seront publiés en ligne
Merci beaucoup 🙂 Depuis, j’ai été voir l’oeuvre gravé de Papillon à la BnF, quel bonheur !