Si vous avez vu l’exposition Delacroix au Musée du Louvre (ou suivi les nombreux partages de photos sur les réseaux sociaux), la mention « avec remarques marginales », apposée sur les cartels de certaines de ses estampes, n’a pas dû manquer de vous intriguer.
Aujourd’hui, je vous propose un petit focus sur ces « remarques marginales » et sur leur place dans l’histoire de l’estampe.

Digressions dans la marge
Prenons un artiste, en train de dessiner. Il s’échauffe, cherche l’inspiration : voici un petit croquis qui naît au bord de la feuille, pour lutter contre l’angoisse de la page blanche. Un crayon à tester ? Voilà encore la marge qui se noircit d’un gribouillis. Le feu de la création brûle, l’imagination se débride : une autre esquisse, rapidement notée, charge encore le papier.

Les graveurs ont les mêmes habitudes : on essaie une pointe tout juste affutée à la bordure du cuivre ; on se dérouille le poignet dans les franges de la composition ; on y laisse aussi courir l’imagination. Et voici une image encadrée de remarques marginales, immortalisées sur le papier par une impression d’état (ainsi que l’on nomme les tirages réalisés par le graveur au cours du travail, pour mesurer le chemin parcouru et évaluer celui qui reste).

Convoitées remarques marginales
Si ces remarques marginales ne sauraient trouver leur place sur un tirage destiné à la commercialisation, elles font cependant le plus grand bonheur des collectionneurs, qui les traquent sans répit. Rares, ces tirages avec remarques sont donc précieux (comme tous ceux avant la lettre d’ailleurs). Ils ont une fraîcheur que les tirages courants ne conservent pas toujours, car le passage répété sous la presse finit toujours par écraser les tailles. Mais surtout, ces remarques marginales sont le témoignage direct de l’inspiration, du feu de la création qui brûle en l’artiste.
Dès lors, si les collectionneurs et amateurs se les arrachent, il y a, pour les artistes, occasion de faire du bénéfice, à condition, bien évidemment, de savoir cultiver la rareté.
Voilà donc que certains prennent bien soin de placer quelques croquis dans les marges, dont on fera quelques épreuves soignées, réservées aux amateurs les plus éclairés (…ou les plus fortunés).
Au milieu du XIXe siècle, le monde de l’estampe connaît une mutation profonde, conséquence de la concurrence de plus en plus rude des procédés photomécaniques, mais aussi des aspirations nouvelles des artistes. On cultive désormais la rareté, les papiers choisis, les tirages limités, voire individualisés… et les remarques marginales !
Des remarques marginales aux marges symphoniques
Certains poussent ce système dans des raffinements remarquables, comme Félix Buhot, inventeur des marges symphoniques autour de 1875-1880.
Autour de son image principale, déjà très travaillée, Buhot multiplie les remarques marginales, couvrant ainsi tout l’espace disponible de saynète avec ou sans rapport avec la composition de départ. Cette dernière s’échappe parfois de son cadre, se répandant dans les bordures.

Ces marges, l’artiste les rehausse parfois d’or à l’impression… c’est ainsi que naissent ce qu’on a appelé les marges symphoniques.
Buhot pousse si loin son système qu’il en vient parfois à graver ses marges symphoniques sur une plaque à part, qui encadrent, après un second passage sous presse, le motif principal. Dès lors, la remarque marginale n’est plus spontanée, puisque préparée par plusieurs dessins préparatoires, collages, essais.
Métamorphoses de la marge symphonique : Pierre Alechinsky et les remarques marginales
Cette tradition artistique de la remarque marginale et de la marge symphonique en gravure, l’artiste contemporain Pierre Alechinsky y a certainement puisé. Dans ses estampes, comme dans ses peintures, l’image centrale est souvent accompagnée d’un large encadrement, richement travaillé. Ce travail sur la bordure, la marge, la périphérie, devient, au cours des années 60 puis 70, sa marque de fabrique.
Les critiques et historiens de l’art qui se sont penchés sur son œuvre font volontiers le rapprochement avec la pratique de la « remarque marginale » en imprimerie, c’est-à-dire l’annotation apposée par l’auteur, le relecteur ou le typographe en vue d’une correction des épreuves d’un texte. Rien de surprenant pour un artiste qui déclare « je suis un peintre venu de l’imprimerie ».

Pour désigner les estampes à bordures de Alechinsky, on emploie parfois le terme de « marginalia », mot qui désigne les annotations manuscrites dans les marges d’un livre, mais aussi les enluminures périphériques (et parfois déroutantes pour nos yeux du XXIe siècle) qui ornent certains manuscrits médiévaux.
Comme dans ces derniers, la clé de compréhension des marginalia réside dans le dialogue qu’elles entretiennent avec le motif central. Mais point de hiérarchie chez Alechinsky : le motif central n’est pas toujours le « principal » et la marge peut autant brouiller qu’éclairer le propos.
Pour en revenir aux remarques marginales de Delacroix
Mais puisque j’ouvrais cet article avec les remarques marginales de Delacroix, achevons-le en y jetant un coup d’œil plus attentif. À l’exposition du Musée du Louvre, sont accrochées une trentaine d’estampes sur les 132 qu’il a produites au cours de sa carrière. Une section est consacrée à ses lithographies romantiques, et notamment au cycle consacré à Faust de Goethe, qu’il réalise en 1826 et 1827. Sur les cimaises, tirages avec la lettre alternent avec des tirages avant la lettre et avec remarques.


Que doit-on lire dans ces graphiques gribouillages, dans ces épées abandonnées, ces lions et ces cheveux en furie ? En 1998, ces tirages avaient déjà été montrés lors de l’exposition « Delacroix, le trait romantique » (Bibliothèque nationale de France). Dans le catalogue de cette manifestation, Barthélémy Jobert, commissaire de l’exposition, avançait à leur propos trois hypothèses : soit ces remarques sont de simples croquis d’échauffement et pensées venues lors de l’exécution, soit elles viennent enrichir le sujet principal en délivrant une clé d’interprétation, un sens caché, soit encore, elles ne seraient qu’un élément décoratif, venu enrichir la mise en page, à la manière des enluminures médiévales. Sans doute est-ce un peu de tout cela à la fois…

Delacroix accordait à ces remarques assez d’importance pour demander à Charles Motte, son imprimeur, de lui en tirer quelques exemplaires avant leur effacement : ces tirages du premier état, extrêmement rares, sont restés en sa possession ou offerts à des proches. Quelques-uns sont entrés dans les collections publiques par la suite, pour notre plus grand bonheur.
Pour aller plus loin
- Cat. exp., Delacroix, le trait romantique, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1998.
- Cat. exp., Eugène Delacroix, Paris, Musée du Louvre, 2018.
- Jean-Luc Dufresne (dir), Félix Buhot, peintre-graveur entre romantisme et impressionnisme, Cherbourg, Isoète, 1998.
- Itzahak Goldberg, Remarques marginales à l’encre dans l’œuvre d’Alechinsky, In : Frontières, marges et confins, Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008. En ligne: <http://books.openedition.org/pupo/2942>.
- Cat. exp., Les impressions de Pierre Alechinsky, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2005.













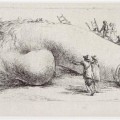



Un univers s’ouvre à moi avec ces remarques marginales comme un brouillon pour un écrivain. Merci beaucoup !
Si j’avais déjà croisée ces remarques marginales sans en connaître le terme, le coup des marges symphoniques c’est une révélation ! Passionnant !
Ping : Tout savoir sur la signature d’une œuvre d’art – Le guide de l'estampe