Rencontrer la meilleure société du XVIIIe siècle, presque en chair et en os, cela vous dit ? C’est ce que le Musée du Louvre nous propose jusqu’au 10 septembre avec l’exposition « En société ». L’occasion d’admirer la plus belle collection de pastels anciens au monde et de s’offrir un troublant face à face avec les grands personnages de l’Ancien Régime, car tous les pastels exposés sont des portraits !

Le Musée du Louvre peut s’enorgueillir de nombreuses choses : le fait de posséder la plus extraordinaire collection de pastels des XVIIe et XVIIIe siècles n’en est pas la moindre, quand on sait la rareté, la fragilité et la préciosité de ces oeuvres. Cent soixante numéros, de quelques cinquante artistes différents, essentiellement français – et parmi lesquels les plus grandes signatures : Maurice-Quentin de La Tour, Chardin, Perronneau… Presque tout l’âge d’or du pastel réuni ! Cette collection s’est pour l’essentiel constituée sous la Révolution et au cours des premières décennies du XIXe siècle, à partir des fonds de l’Académie royale de peinture et de sculpture, des saisies des biens des émigrés et des collections royales qui ornaient Versailles.

Le XVIIIe siècle, un âge d’or du pastel
Mais qu’est-ce que le pastel, et qu’est-ce qui explique son immense succès au XVIIIe siècle? La technique a été inventée à la Renaissance. Le pastel est un bâtonnet de couleurs, composé de pigment et d’une charge (souvent de la craie) agglomérée par un liant (souvent de la gomme arabique). Il dépose sur le papier une poudre à la couleur éclatante, ce qui fait tout son charme.
Utilisé dès le XVe siècle pour rehausser de couleurs des dessins tracés au crayon, le pastel gagne son autonomie à la fin du XVIIe siècle alors qu’on commence à l’employer seul. En 1699, Joseph Vivien est le premier artiste à être reçu à l’Académie royale de peinture et de sculpture comme peintre en portrait de pastel. La mode est lancée.
Elle se voit confirmée en France en 1720 lorsque Rosalba Carriera, une talentueuse pastelliste vénitienne, séjourne à Paris. Sous l’influence de ses portraits pleins de grâce et ses textures toutes en transparences, de nombreux artistes adoptent sa technique – et la clientèle suit.
De Rosalba Carriera, le Louvre possède Nymphe de la suite d’Apollon, une oeuvre qu’elle a envoyée à l’Académie royale de peinture et de sculpture après son retour en Vénétie, en remerciement de sa réception dans la prestigieuse institution.

L’émulation autour du pastel est grande et, rapidement, de nouveaux maîtres dépassent dans cet art Boucher ou Nattier. Le plus célèbre est sans nul doute Maurice-Quentin de La Tour, surnommé par les critiques de son temps le « prince des pastellistes ». Son oeuvre la plus célèbre est son monumental portrait de Madame de Pompadour, où se lit tout ce qui a fait le succès du pastel : la vie et l’impression de présence du modèle, le rendu si fin des textures et des chairs, l’illusionnisme et la virtuosité du rendu des textures, notamment lorsqu’il s’agit des textiles.
Parmi les grands noms du pastel, on compte aussi Chardin, à la technique bien différente et audacieuse, avec ses petites touches visibles. Le peintre est venu au pastel à la fin de sa carrière, alors que sa santé lui interdisait désormais l’usage de la peinture à l’huile, dont le plomb lui avait brûlé les yeux.

Il y a aussi le célèbre Liotard avec ses portraits aussi réalistes qu’austères, malheureusement bien rares en France (les collections suisses en sont bien plus riches) ou encore Jean-Baptiste Perronneau, auquel Orléans, dont le Musée des Beaux-Arts possède un bel ensemble, a récemment rendu hommage.
Avec de tels talents, le pastel est en pleine effervescence et les commanditaires s’arrachent les meilleurs artistes. Outre l’attrait du résultat, plus brillant et vivant que la peinture à l’huile, on apprécie les facilités pratiques permises par ce médium : rapidité d’exécution, facilité d’emploi (aucune préparation nécessaire), garanti sans odeur ni temps de séchage !

Un succès qui inquiète et menace les portraitistes traditionnels, qui opèrent à la peinture à l’huile. Ils obtiennent de haute lutte de fermer les portes de l’Académie à ces concurrents exclusivement pastellistes, qui ne pourront désormais plus être reçus… Ce qui ne suffira pas à endiguer la mode !
Si le goût pour le pastel s’essouffle à la fin du siècle, c’est en partie dû à l’essor du néoclassicisme, mais plus encore aux troubles du temps. Sous la Révolution, on préfère aux encombrants pastels la discrétion des miniatures, plus faciles à déplacer, sans toutefois complètement faire disparaître cette technique.
Virtuosité et fragilités du pastel
La collection du Musée du Louvre raconte tout ce pan de l’histoire de l’art. Il faut mesurer la chance que nous avons, visiteurs du Louvre de l’été 2018, à voir ainsi tous ces chefs-d’oeuvre exposés simultanément : un tel événement ne se reproduira pas avant quarante ou cinquante ans ! D’abord parce que les pastels sont fragiles : ce qui fait leur beauté – ces couleurs éclatantes et cette matière poudreuses – est aussi leur faiblesse. Plus que tout autre médium, le pastel est sujet au décolorations, aux pertes de matières, à l’empoussièrement et à la moisissure. Aussi, aujourd’hui, nos musées se refusent à les prêter – un voyage pourrait leur être fatal – et les exposent avec parcimonie.

Si le Louvre s’est lancé dans un tel accrochage, c’est que cette exposition vient clore un ambitieux chantier de restauration et de recherche, mené depuis près de sept ans grâce au généreux mécénat d’un couple de riches américains, Joan et Mike Kahn.
Chaque pastel a fait l’objet d’un soigneux dépoussiérage, et, pour certains, de délicates opérations telles que le retrait des moisissures qui venaient ternir les ombres.

Secrets et histoires de pastels
Un tel chantier ne pouvait qu’occasionner de nouvelles découvertes scientifiques : l’exposition, et plus encore le catalogue raisonné qui l’accompagne en livrent les fructueux résultats : telle oeuvre a fait l’objet d’une nouvelle attribution, le modèle de telle autre a été identifié, tandis que bien des historiques ont été précisés.

C’est là que l’on mesure, au-delà de son volume et du prestige de ses signatures, ce qui fait la richesse de cette collection : bien des pastels avaient conservé leur montage et encadrement d’origine : leur démontage, nécessaire pour opérer les dépoussiérages, a permis de mieux connaître les pratiques de l’époque et a occasionné quelques surprises, comme la découverte, cachée dans le cadre jamais ouvert d’un pastel de Rosalba Carriera, d’une petite estampe figurant les rois mages, placée là par l’artiste, très pieuse, afin que son oeuvre voyage sans encombre de Venise à Paris. D’autres de ses oeuvres, conservées de par le monde, ont révélé les mêmes images protectrices.
Le Louvre est également riche d’études préparatoires qui révèlent comment les artistes opéraient. Ainsi, le Louvre possède plusieurs préparations de Maurice-Quentin de La Tour (et bien d’autres sont conservées au musée Aintoine Lecuyer, à Saint-Quentin). L’une d’elles a été retrouvée au verso d’un pastel du maître figurant Marie Leczinska, où elle protégeait le châssis. Cette esquisse porte le visage de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe, dont le Louvre possède aussi le pastel final, commandé en 1756 et livré en 1760. On comprend alors comment les séances de pose – limitées – permettaient de fixer les traits du modèle. La préparation ainsi obtenue pouvait être copiée ou plus simplement collée sur le support définitif, puis complétée par l’ajout du décor et du costume, dont la réalisation n’exigeait pas la présence du modèle.
On peut lire facilement ce genre de collage sur le portrait de Jean Restout par Quentin de La Tour, composé de treize feuilles de papier raboutées. A vrai dire, cette multiplicité de morceaux est en partie due à des retouches effectuées par l’artiste vingt ans après sa soumission à l’Académie. Maurice Quentin de la Tour voulait améliorer le rendu de l’œuvre , mais, en fait de perfectionnement, l’opération se solda par un échec : l’oeuvre était irrémédiablement endommagée.
Fort heureusement, le magnifique portrait de Madame de Pompadour, le plus célèbre des pastels du XVIIIe siècle, a été préservé d’un tel traitement ! Sa restauration, en 2017, a elle aussi été l’occasion de découvertes. Les différentes séances de pose qu’avaient accordées la marquise à l’artiste ont laissé de piquantes anecdotes. Des trois préparations de la tête, réalisées pendant les séances (et aujourd’hui conservée au Musée Antoine Lecuyer de Saint-Quentin), deux furent gâchées par l’artiste alors qu’il les traitait et il lui fallut en produire une quatrième pour aboutir. C’est elle qui est collée au coeur du grand pastel, composé de 6 feuilles de papier assemblées. Le reste de la composition, le décor et surtout la superbe robe fleurie – ont été réalisées ultérieurement, dans le calme de l’atelier.

L’étude de l’oeuvre a révélé plusieurs repentirs qui ont nécessité bien des précautions à l’artiste au moment des retouches (grattages et empiècements délicats) changement de la position de la main, du volume de l’encyclopédie et du pied gauche de la marquise.
Maurice Quentin de la Tour était si fier de cette oeuvre qu’il l’envoya seule au Salon de 1755. Pourtant, quatre décennies plus tard, lorsque le pastel, passé en main privée, fut proposé à la vente au Museum Central des Arts, Vivant Denon fit la fine bouche en refusant d’examiner l’oeuvre, qui lui était d’ailleurs proposée fort chère. Elle est finalement acquise en 1803 pour un prix bien plus modeste, 500 francs. Et encore, ne le fut-elle apparemment que parce que la vitre du cadre – la plus grande jamais produite par Saint-Gobain sous l’Ancien Régime – relevait de l’exploit technique !
Malheureusement la glace en question a depuis disparu, victime d’une maladie du verre, qui a contraint les conservateurs à la remplacer au milieu du XXe siècle.

On connaît mieux la technique de certains pastellistes grâce à quelques oeuvres inachevées, comme le très beau portrait de son épouse qu’avait commencé à peindre Joseph Boze. La tête et le bras droit, tout à fait aboutis, émergent d’un vêtement juste esquissé. L’effet est surprenant, et l’inachèvement plein d’enseignements : il apparaît par exemple que l’artiste frottait son papier à la pierre ponce pour le rendre plus duveteux et aider le pastel à mieux se fixer.

Costumes et visages
Si la robe de Madeleine-Françoise Boze est à peine esquissée, la plupart des personnages de l’exposition arborent de somptueux costumes : ce n’est que surenchère de dentelles, étoffes chatoyantes, bijoux délicats, broderies raffinées… Les pastellistes ont autant rivalisé à saisir la psychologie de leurs modèles que la beauté de leurs atours. Jusqu’à imaginer des artifices techniques fort audacieux : ainsi, Lenoir, pour rendre le scintillement du costume oriental de l’acteur Lekain, pose-t-il à la surface du pastel des gouttes de gouache sur lesquelles la lumière se reflète.
Si l’exposition du Musée du Louvre est si plaisante, elle ne le doit pas seulement à la virtuosité de ses oeuvres ni aux découvertes scientifiques qui y sont dévoilées, mais aussi à la galerie de portraits qu’elle offre, ces figures si vivantes qu’elles s’en animeraient presque. Retirez aux modèles leurs atours XVIIIe siècle, ne vous semblent-ils pas presque nos contemporains ? Comment ne pas être troublé par ces regards si intenses, francs et parfois goguenards ?
Pour aller plus loin
Exposition à voir au Musée du Louvre jusqu’au 10 septembre 2018. Un volumineux et riche catalogue raisonné de la collection fait office de catalogue.
A lire aussi sur le blog, un billet sur la manière de pastel ou l’imitation du pastel par la gravure.
































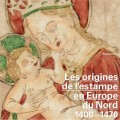




Magnifique !
Bonjour,
C’est vrai que ces portraits sont très vivants. On dirait que les personnages vont soudain nous adresser la parole ! Peux-tu donner des détails sur les « feuilles de papier raboutées » et les collages ? Est-ce une technique généralement utilisé pour les pastels ? On parle de vraies feuilles de papier ? ou plutôt du carton ? Est-ce que l’artiste disposait de feuilles de toute dimension ou était-il obligé d’assembler les feuilles
?