Des silhouettes sensuelles et fatales, de longues chevelures ondoyantes, ornées de fleurs ou noyées dans des volutes de fumée. Vous pensiez tout connaître de l’esthétique d’Alfons Mucha ? Au Musée du Luxembourg, une rétrospective permet de redécouvrir le parcours de cette figure majeure de l’Art nouveau… et d’explorer des facettes bien moins connues de sa carrière.

Mucha, ce n’est pas que l’Art nouveau ! Et cela décevra peut-être ceux venus au Musée du Luxembourg spécialement pour s’enivrer des courbes gracieuses de ses créatures féminines : moins de la moitié de l’accrochage leur est consacré, le reste du parcours explorant d’autres aspects de la personnalité de l’artiste. On y découvrira son obédience franc-maçonne, son intérêt pour le mysticisme, son œuvre peinte et — surtout — son engagement en faveur des peuples slaves.
Vienne, Munich et Paris : les débuts d’un artiste
Mais commençons par le commencement : qu’est-ce qui a pu faire d’un jeune homme, né en Moravie en 1860, la figure de proue de l’Art nouveau parisien et de l’esprit Fin-de-Siècle ?
Adolescent, Alfons Mucha souhaite embrasser la carrière d’artiste, mais sa candidature est rejetée par l’École des Beaux-Arts de Prague. C’est donc à Vienne qu’il fait ses premières armes, auprès d’un peintre en décors de théâtre.
Deux événements vont changer le cours de sa carrière : le terrible incendie de l’Opéra de Vienne, qui entraîne la faillite de son employeur, lui faisant perdre son emploi et sa rencontre avec le comte Khuen Belasi, qui devient son premier mécène. Ce dernier finance un séjour d’étude à Munich, puis à Paris, en échange d’un décor peint pour la salle à manger de son château.

Débarquant à Paris en 1887, Mucha découvre une ville cosmopolite et un climat particulièrement favorable : un fort sentiment slavophile et russophile traverse les cercles intellectuels parisiens. Mucha, qui fréquente l’Académie Julian et l’Académie Colarossi s’intègre sans peine. Il s’y lie d’amitié avec Vuillard, Bonnard, et surtout Gauguin, avec lequel il partagera un temps son atelier. De ses amitiés, et de l’ambiance festive qui règne rue de la Grande Chaumière où loge Mucha, témoignent des photographies. On s’amusera de l’accoutrement qu’y arbore Gauguin !
L’insouciance est cependant de courte durée pour Mucha, car bientôt l’argent vient à manquer : son mécène, lui-même en difficultés financières, cesse de lui verser sa bourse. Heureusement, à Paris, dans ces années, le travail ne manque pas pour les jeunes artistes débrouillards et talentueux : on trouve à gagner sa vie par de menus travaux d’illustration et Mucha dessine donc pour l’édition et la publicité.
Mucha, artisan de l’imagerie du Paris Fin-de-Siècle
C’est dans l’atelier de l’imprimeur de lithographie Lemercier pour qui il réalise de modestes éphémèra que Mucha va faire la rencontre décisive de sa vie. Un soir de décembre 1895, Sarah Bernhardt exige que l’on réalise une nouvelle affiche pour sa pièce Gismonda, laquelle doit être jouée dix jours plus tard. Tous les affichistes en vue de Lemercier sont pris par d’autres travaux et personne ne peut répondre à la commande dans les délais fixés. Elle échoit donc au jeune Mucha, qui va saisir l’opportunité de se faire remarquer et proposer une affiche au graphisme audacieux. Le format allongé — qui rappelle les kakémonos japonais — est inhabituel, le visuel à la fois épuré et chargé d’ornement, le texte réduit à l’essentiel. La maquette déplait au directeur, mais contraint par le temps, celui-ci la présente à la comédienne. Sarah Bernhardt se montre extrêmement enthousiaste. Placardée dans les rues dès le jour suivant, l’affiche rencontre un succès immédiat.

Sarah Bernhardt, craignant de voir lui échapper ce talent prometteur fait signer à Mucha un contrat d’exclusivité pour six ans. Ensemble, ils vont achever de fixer l’image de la star : Mucha dessine les costumes, les décors, les bijoux de la comédienne et, bien sûr ses affiches, toujours selon le même modèle. Les affiches se succèdent et le succès ne se dément pas : richesse ornementale, silhouettes féminines sensuelles et fatales, volutes et entrelacs, lettrages soignés, mais discrets, le style Mucha est né.
Les créations de Mucha couvrent les murs de la capitale : elles vantent le pétillant du champagne Moët & Chandon, les qualités des biscuits Lefèvre-Utile ou celles des papiers à cigarette Job. On décline les motifs en boîtes à biscuits, cartons publicitaires, calendriers, éphémèra de tous genres. Le style de Mucha s’adapte parfaitement à ces supports divers et son graphisme caractérisé par un large cerne noir est parfaitement propice à l’impression lithographique en couleurs.
Les motifs et le style de Mucha, démultipliés, imités, vont incarner, pour son temps et pour les générations suivantes, l’Esprit de la Belle Époque et de l’Art nouveau.
Mucha et les Arts décoratifs
Les collectionneurs ne s’y trompent pas, et s’arrachent les créations de Mucha. Son imprimeur, fin en affaires, tire spécialement pour cette clientèle des épreuves de luxe, sur papier précieux ou avant la lettre… Ce qui n’empêche pas certains affichomanes d’aller, de nuit, décrocher les affiches des murs ou de soudoyer les colleurs.
Devant le succès de l’imagerie Mucha, l’imprimeur Champenoix décide de développer une gamme d’affiches décoratives, sans réclame, destinées au grand public. L’artiste est séduit par ce projet, qui répond à son aspiration de créer un art pour tous, accessible à toutes les bourses. Ainsi naissent des séries d’affiches sur le thème des quatre saisons ou des étoiles.
Mucha donne également des motifs pour différentes industries : céramique, orfèvrerie, textile… Son goût pour les arts décoratifs le pousse également vers l’enseignement : en 1897, il ouvre un cours de composition décorative et publie des portefeuilles de motifs.
En 1900, le joaillier Fouquet lui confie la création du décor de sa boutique de la rue Royale : vitrine, présentoirs, meubles, poignées de porte… tout porte la signature de Mucha. Ce décor, emblématique de l’Art nouveau, est aujourd’hui conservé à Carnavalet, et on aurait rêvé qu’il soit présenté dans l’exposition, d’autant que le musée est actuellement fermé pour restauration.
Mystique, spirite et franc-maçon
À mi-parcours de l’exposition, on bascule dans un autre univers, la face non pas cachée, mais simplement méconnue d’Alfons Mucha. Une salle peinte d’un bleu nocturne intense nous invite à pénétrer dans l’univers intime et spirituel de l’artiste. On le découvre mystique et spirite — rien de surprenant pour un intellectuel évoluant dans le Paris Fin-de-Siècle, proche des Nabis, de Gauguin et de La Plume.

Les œuvres nées de cet intérêt pour le spiritisme sont en revanche étonnantes, notamment parce qu’elles ne partagent rien, stylistiquement, avec l’imagerie du Mucha affichiste.
En 1898, Mucha rejoint le Grand-Orient de France et, plus tard, il sera le fondateur de la loge tchécoslovaque, dont il dessinera le diplôme.
Autour de 1900, Mucha illustre une édition du Pater, où, là encore, l’iconographie peut surprendre. Mucha est à la recherche d’un art universel, qui contribue au progrès de l’Humanité et au maintien de la Paix.
L’âme slave de Mucha
Contribuer au progrès de l’Humanité, à commencer par celui des peuples slaves, c’est bien ce qui guide la vie de Mucha après 1900.
L’artiste, installé à Paris depuis plus d’une décennie, n’a jamais rompu avec ses racines moraves. À Paris, il préside un cercle tchèque, et cultive son goût pour les cultures slaves, arborant fièrement des costumes traditionnels.
En 1900, il participe activement aux préparatifs de l’Exposition universelle : entre cent autres travaux, l’Empire austro-hongrois lui confie la décoration du pavillon de la Bosnie-Herzégovine, un de territoires sous sa domination. Mucha réalise un important décor peint tout à la gloire des traditions et de l’histoire nationale.
La situation, pour l’artiste, n’est guère confortable : ses convictions personnelles sont en faveur de l’indépendance des peuples d’Europe de l’Est et s’opposent donc aux visées politiques de l’Empire austro-hongrois. Son travail satisfait néanmoins le pouvoir, qui lui remet l’Ordre de François-Joseph Ier. Une décoration qui ne fait que renforcer le malaise de Mucha…
Mucha sort d’une décennie de travail harassante : parvenu au sommet de sa gloire d’affichiste et de décorateur, il veut désormais tourner la page et s’accomplir comme peintre. Il forme le projet d’une œuvre monumentale, qui milite pour la liberté des peuples slaves.
Sur le conseil de la Baronne de Rothschild, Mucha quitte Paris pour l’Amérique. Outre Atlantique, il trouve une importante communauté d’Europe de l’Est ayant fait fortune aux Etats-Unis. C’est au sein de celle-ci qu’il rencontre son nouveau mécène, Charles Richard Crane, qui accepte de financer son grand projet, l’épopée slave, conçue comme un gigantesque panorama narrant vingt épisodes glorieux de l’histoire des peuples slaves. Près de vingt ans de travail sont nécessaires pour accoucher du cycle, présenté à Prague à partir de 1919, au lendemain de l’indépendance de la République Tchèque, mais achevé seulement vers 1928.

Le combat pour la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes est gagné, mais l’équilibre européen demeure précaire. Dans ce jeune État, Alfons Mucha est une figure majeure, une fierté nationale. On lui confie plusieurs commandes importantes : le décor du salon du maire de Prague, le dessin des premiers timbres et billets, des vitraux pour la cathédrale. Désormais âgé, Mucha continue de mettre son art au service de son idéal, l’indépendance de son peuple et la paix.
Au crépuscule de sa vie, l’horizon se bouche : en mars 1939, les Allemands entrent dans Prague. Mucha est parmi les premiers à être arrêté : ses convictions politiques et son obédience franc-maçonne sont connues. La Gestapo le torture puis le relâche. C’était l’épreuve de trop pour ce vieillard de 78 ans : il s’éteint le 14 Juillet d’une pneumonie contractée en captivité.

Exposition Mucha, jusqu’au 28 janvier 2019, Musée du Luxembourg. Comme vous pouvez le juger aux photographies, j’ai eu la chance visiter l’exposition à deux reprises dans des conditions exceptionnelles : je remercie le Musée du Luxembourg de m’avoir invitée pour la répétition générale de la conférence-chantée de Grégoire Ichou et la chaîne Public Sénat de m’avoir conviée à une visite guidée.
























































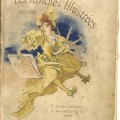




Merci de cet excellent article.
Wahou….