Dans le cadre de la manifestation « un soir à Orsay », des étudiants de l’Ecole du Louvre et des universités parisiennes ont été invités à présenter les 7 et 14 février 2013 une œuvre de leur choix issue des collections du musée. Pour ma part, ma prestation concernait une nouvelle acquisition d’Orsay, le tableau de Paul-Elie Ranson intitulé « La sorcière au chat ».
D’abord, le visiteur est surpris par cette peinture aux couleurs intenses qui contrastent tant avec les coloris pastels et évanescents des tableaux de la galerie symboliste. L’œuvre de Ranson, nouvellement accrochée sur les cimaises, saisit l’œil. Quand on demande aux visiteurs ce qu’ils y voient, la réponse est invariablement la même ; les éléments toujours énoncés dans le même ordre : « un chat, un truc à corne (une gargouille ou… peut-être bien un diable, non ?), un oiseau (corbeau, aigle), une étoile… et un personnage bien-sûr » concluent-ils comme une évidence…
La femme sorcière
La sorcière au chat représente en effet une vieille femme, placée au centre du tableau. On l’identifie comme une sorcière à son nez crochu. Son poing, fermé, masque une partie de son visage. Ses yeux, clos, laissent à penser qu’elle songe ou dort. Autour d’elle, sur un fond orangé, parsemé de motifs décoratifs, se détachent comme des ombres chinoises un chat, un corbeau, une étoile, d’étranges signes et le diable, discret mais trahi par ses yeux luisants.
Présentant un thème ésotérique évident, ce tableau s’inscrit dans une série développée entre 1891 et 1898 par Paul-Elie Ranson autour de la femme-sorcière, personnage souvent associé par les historiens de l’art à la figure de son épouse.

Sorcière maléfique ou vieille femme victime de mauvais songes ?
Comme les autres membres du groupe nabi auquel il appartient depuis sa fondation, Paul Emile Ranson est pénétré par la volonté de donner une dimension spirituelle à sa création. Si chez Maurice Denis, cela se traduit par de nombreuses œuvres à l’iconographie chrétienne, Paul-Elie Ranson exprime sa quête de spiritualité par un grand intérêt pour l’occultisme et l’ésotérisme. De ce fait, ses œuvres, peuplées d’êtres étranges et de monstres, s’inscrivent dans le prolongement de l’intérêt du XIXe siècle pour les sciences occultes. Ranson tient également ce goût pour le bizarre des contes fantastiques qui ont émaillé son enfance.
On offre habituellement deux interprétations de cette « Sorcière au chat » : certains y lisent une vieille femme assoupie en proie à d’horrifiants cauchemars inspirés par le diable et ses suppôts, d’autres, en revanche, y voient une sorcière fomentant de terribles sortilèges, les éléments qui l’entourent symbolisant son pouvoir.
Un tableau nabi
Stylistiquement, ce tableau détonne par son traitement particulièrement moderne, très synthétique, et par sa gamme chromatique violente et réduite à l’extrême : de grands aplats noirs, orangés et ocres ponctués de tâches claires. Quant aux silhouettes, elles sont soulignées par de vigoureux cernes sombres.
Ce tableau illustre parfaitement le style très décoratif et synthétique de Paul Elie de Ranson, qui est justement l’artiste qui a poussé le plus loin la veine décorative au sein du groupe Nabi. Ce traitement synthétique n’est pas sans rappeler les estampes de Vallotton qui opposent de la même façon les valeurs et les formes.

On discerne dans « La sorcière au chat » deux influences particulièrement importantes. D’une part, l’estampe japonaise, très prisée dans les cercles artistiques parisiens dans les années 1890, à laquelle Ranson emprunte en partie l’usage du cerne noir pour souligner les silhouettes et l’abolition de la perspective… L’influence japonaise a tellement marqué Ranson que cela lui a valu le surnom du « Nabi japonard plus japonard que le nabi japonard » (Bonnard). D’autre part, le théâtre d’ombres, tel qu’il était pratiqué par H. Rivière et d’autres artistes dans l’établissement de Robert Salis, le théâtre du Chat noir. Il faut d’ailleurs noter que Ranson a entretenu un lien fort avec les arts du spectacle tout au long de sa carrière, produisant lui-même des marionnettes.
 La Sorcière au chat noir a été très récemment (2012) acquise par le Musée d’Orsay à une vente publique. Paul Ranson, dont le musée ne possède que 6 œuvres, est souvent qualifié de « nabi oublié » bien qu’il ait eu un rôle central au sein du groupe. Nabi de la première heure, c’est à l’Académie Julian qu’il rencontre, en 1886, Maurice Denis, Pierre Bonnard, Paul Sérusier et Edouard Vuillard. Mort en 1909 d’une fièvre typhoïque, Ranson est le premier membre du groupe à disparaître ce qui explique le relatif oubli dans lequel il est rapidement tombé…
La Sorcière au chat noir a été très récemment (2012) acquise par le Musée d’Orsay à une vente publique. Paul Ranson, dont le musée ne possède que 6 œuvres, est souvent qualifié de « nabi oublié » bien qu’il ait eu un rôle central au sein du groupe. Nabi de la première heure, c’est à l’Académie Julian qu’il rencontre, en 1886, Maurice Denis, Pierre Bonnard, Paul Sérusier et Edouard Vuillard. Mort en 1909 d’une fièvre typhoïque, Ranson est le premier membre du groupe à disparaître ce qui explique le relatif oubli dans lequel il est rapidement tombé…


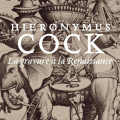



Ping : Oeuvres | Pearltrees