Jusqu’au 13 janvier 2014, le musée du Louvre propose une exposition sur les origines de l’estampe en Europe du Nord (1400-1470). A travers une sélection de 83 oeuvres issues des plus prestigieuses collections françaises d’estampes (BnF et collection Rothschild), le parcours délivre les clés pour comprendre la naissance de cet art du multiple. Un événement à ne pas rater tant les pièces exposées sont exceptionnelles, rares et peu fréquemment présentées.
L’estampe naît à la toute fin du XIVe siècle dans les régions du sud de l’Allemagne. Image obtenue par l’impression d’une matrice gravée sur une feuille de papier, l’estampe peut être produite à des milliers voire des dizaines de milliers d’épreuves identiques. Cinquante ans avant « l’invention » de l’imprimerie par Gutenberg, l’estampe est le premier art du multiple qui permet une diffusion massive des images, modifiant profondément les usages de celles-ci.
L’estampe, des origines mystérieuses
Les origines de l’estampe demeurent mystérieuses : dans quel contexte exact cette technique a-t-elle émergé? A quelle date précisément? Dans quelle zone géographique? Cette dernière question a focalisé toute l’attention des historiens de l’art pendant près d’un siècle et demi. Sur fond d’antagonismes nationalistes, français et allemands se sont battus pour la paternité de l’invention de la gravure. Aujourd’hui, la question est définitivement tranchée : les spécialistes s’accordent à reconnaître que le foyer germanique a été déterminant dans le développement de l’estampe. Cette focalisation des travaux sur l’origine géographique a beaucoup nuit à la connaissance de l’estampe du XVe siècle, l’argumentaire nationaliste primant sur toute autre aspect : le champ d’investigation et d’étude en était ainsi cruellement réduit. Heureusement, depuis 40 ans, des chercheurs américains et allemands ont renouvelé l’approche de l’estampe primitive s’intéressant à la fois aux structures de production des images qu’à leur circuits de diffusion et à leurs usages. Majeures, leurs découvertes n’ont cependant pas suffit à faire toute la lumière sur les conditions de la naissance de l’estampe en Europe.

L’exposition présentée au Louvre entend faire la synthèse de ces travaux récents et présenter au public les plus belles pièces des collections françaises. Le parcours, très pédagogique, aborde les évolutions de l’estampe entre 1400 et 1470 à travers trois axes : les techniques, les acteurs et les usages.
Xylographie, gravure sur métal, criblé : l’estampe sous l’angle technique

La diversité du rendu plastique des estampes exposées peut surprendre : certaines pièces présentent de vigoureux et épais traits qui synthétisent le motif, tandis que d’autres sont délicatement gravées de multiples et fines tailles.
Dès les origines de l’estampe, les graveurs expérimentent différentes techniques : la xylographie ou gravure sur bois, la taille-douce sur métal et le criblé.
Le bois Protat illustre parfaitement la première technique apparue, celle de la xylographie. Le motif est épargné par le graveur de façon à ce que les traits de l’image apparaissent en relief. Présenté pour la première fois au public, le bois Protat est la pièce maîtresse de l’exposition. Il s’agit de la plus ancienne matrice d’estampe conservée, puisqu’elle date probablement du début du XVe siècle.
Vers 1430-1440, une seconde technique émerge dans le milieu des orfèvres du sud de l’Allemagne : la gravure sur métal en taille douce. Le motif est tracé sur la matrice métallique à l’aide d’une pointe ou d’un burin. L’extraordinaire encensoir de Martin Schongauer illustre le degré de virtuosité exceptionnel atteint moins de soixante ans après l’apparition de la gravure en taille-douce.

Parallèlement, pendant quelques décennies seulement, certains graveurs pratiquent la gravure en criblé, sorte de technique bâtarde, que l’on pourrait un peu rapidement résumer à un mélange des deux procédés précédemment exposés. En effet, le criblé résulte de la gravure en relief d’une plaque de métal : c’est-à-dire que le motif est épargné, comme dans la technique de la xylographie. Au sein du corpus assez restreint des gravures en criblé, la petite Sainte Catherine conservée au département des Estampes de la BnF figure parmi les chefs d’oeuvre les plus aboutis de cette technique. Le manteau de la sainte constellé d’un semi de points, est d’un raffinement extraordinaire!

Habituellement, les expositions qui traitent de l’estampe du XVe siècle abordent séparément chacune de ces techniques, sans les mêler. L’exposition du Louvre prend le parti-pris inverse en confrontant xylographies, tailles-douces et criblés afin de mieux mettre en évidence les liens que ces différentes techniques entretiennent et de souligner la permanence des modèles. Car si la gravure en métal apparaît plus tardivement et dans d’autres cercles, elle participe d’une même dynamique de production d’images imprimées.
Circuits de production / circuits de diffusion, des acteurs méconnus
Pour ces périodes hautes de l’histoire de l’estampe, les structures de production et les circuits de diffusions sont mal connus. Le métier est nouveau et peu structuré : il n’existe pas de corporations ni de réglementation. Dans les archives, les traces des premiers acteurs sont assez floues, puisque qu’aucun mot ne semble précisément désigner les graveurs, qui pratiquent alors souvent également d’autres activités artisanales ou artistiques. Cela rend l’écriture de l’histoire de l’estampe difficile, d’autant que les graveurs sont longtemps restés anonymes. Le maître E.S., dont on admire le talent dans l’exposition, est le premier graveur à avoir apposé son monogramme sur ses estampes. A la génération suivante, Schongauer sera le premier graveur à laisser son nom à la postérité.
Multiples usages, une image accessible à tous
La majorité des estampes présentées dans cette exposition ont un sujet religieux : Vierge à l’Enfant, martyr(s) et miracles de saints… Cette prédominance de l’imagerie religieuse s’explique aisément par les usages qui sont alors associés à l’estampe.
A la fin du XIVe siècle, les pratiques de religieuses évoluent : les fidèles sont encouragés à la dévotion privée. Dans ce cadre, l’image devient le support de prière et de méditation.

Autour des importants centres de pèlerinage, de nombreuses images religieuses sont diffusées et commercialisées : elles figurent des Vierges à l’enfant, des épisodes de la vie du Christ ou de saints locaux, des scènes de martyres. On prête à certaines figurations des propriétés apotropaïques tandis que d’autres images permettent d’obtenir des indulgences.
Didactique, l’estampe devient un support privilégié pour l’enseignement religieux. Une feuille exposée au Louvre figure une série de petites vignettes évoquant les dix commandements, les cinq sens et les sept péchés capitaux. La petite image d’un fidèle se confessant auprès d’un religieux explicite l’usage probable de cette estampe comme guide permettant d’identifier et de confesser les péchés.

Mais les usages de cette technique nouvelle de multiplication des images sont bien plus diverses. L’estampe a servi à produire des cartes à jouer et diverses images profanes. On admire en particulier une très belle feuille du maître des cartes à jouer figurant sept oiseaux. Très surprenantes sont les estampes grivoises du maîtres E.S. qui prolongent les drôleries présentes dans les marges des manuscrits du XIVe siècle.

Abondantes et multiples hier, rares aujourd’hui
Si une matrice d’estampe pouvait être tirée à des milliers d’exemplaires, les épreuves encore conservées aujourd’hui sont extrêmement peu nombreuses. Pour la période 1400-1440, seulement soixante-dix estampes sont connues! Manipulées, punaisées sur les murs, collées dans des livres, pliées pour entrer dans une poche, ces images, usées, ont été jetées, brûlées… On comprend donc le caractère exceptionnel de l’exposition du Louvre !
Infos pratiques : du 17 octobre 2013 au 13 janvier 2014 au Musée du Louvre, aile Sully, 2e étage. Prix compris dans le ticket d’entrée pour les collections permanentes. Toutes les informations sur le site du musée du Louvre.


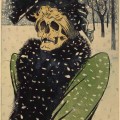

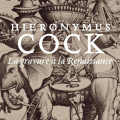

Ping : Les coffrets à estampe | Orion en aéroplane
Je remercie Orion en aéroplane, pour ses explications précises et justes sur l’estampe. J’ignorais que ce site expliquait si bien et avec précisions le métier de graveur sur bois ou linoléum. Je lui dois des excuses car j’ai publié un message sur l’estampe en omettant de signaler leur nom, il y a à peine une heure.
13/10/16.
Bonjour, l’article est fort intéressant. Je ne peux néanmoins que souligner l’existence bien antérieure du procédé de la xylographie en asie extrême-orientale. En effet, la technique existait en Chine comme en Corée plusieurs siècles avant l’apparition des estampes en Allemagne. D’ailleurs, la Corée possède la plus ancienne oeuvre de ce type datée de 706 (le Sutra Dharani).
C’est tout à fait vrai. L’estampe apparaît en Asie plusieurs siècles auparavant mais son apparition dans le monde occidental est également une invention puisqu’il n’y a pas eu de transfert culturel sur cette technologie…
A moins d’en prouver un jour le contraire, c’est toujours la même chose. Toujours est-il que votre article est réellement intéressant et passionnant.