Il ne vous reste que quelques jours pour voir l’exposition « Dessins français du XVIIe siècle » et y admirer quelques-uns des fleurons du département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, dont certains sont des inédits récemment redécouverts.

De la seconde école de Fontainebleau aux prémices du XVIIIe siècle
C’est un long XVIIe siècle que l’exposition nous offre de parcourir : du règne d’Henri IV (1589-1610) à la mort de Louis XIV (1715), le paysage artistique a beaucoup évolué.

Lorsqu’il entre enfin dans Paris, en 1594, Henri IV entend redonner à la capitale toute sa splendeur. A Fontainebleau il poursuit les travaux initiés par François Ier, contribuant à l’éclosion d’une brillante « seconde école de Fontainebleau », tandis qu’à Paris, il attire de nombreux artistes venus des Flandres, parmi lesquels de talentueux tapissiers et graveurs, qui introduiront en France des pratiques nouvelles.
Le règne de Louis XIII (1610-1643) est marqué par le goût pour l’Italie, qui attire les artistes, bien que peu peuvent réellement faire le voyage. C’est néanmoins le cas de Jacques Callot, qui séjourne quelques années à la cours Florentine, et surtout celui de Simon Vouet, qui, pensionné par la Marie de Médicis, réside 15 ans en Italie ! En 1627, Louis XIII le rappelle à Paris pour en faire son Premier Peintre. Dans ses bagages, il rapporte le modèle des Carrache et les pratiques d’études anatomiques d’après le modèle.

Dans la première moitié du règne de Louis XIV, Charles Le Brun, un des membres fondateurs de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, domine la scène artistique. Premier peintre du roi, directeur de l’Académie et de la Manufacture royale des Gobelins, il dirige les grands chantiers et forme bon nombre des jeunes peintres de la génération suivante.

Le parcours chronologique de l’exposition s’achève avec les dessins de quelques-uns des artistes de la fin du règne louis-quatorzien, qui déjà, annoncent le goût du XVIIIe siècle : Charles de La Fosse, Jean Jouvenet.
Raconter l’art du XVIIe siècle à travers le dessin et l’estampe
A travers le dessin, c’est toute l’histoire de l’art du XVIIe siècle qui se raconte, car le dessin a été le pivot des arts. Ces feuilles ne sont pas seulement de beaux dessins (étude, esquisse ou composition plus aboutie) mais, bien souvent, des travaux préparatoires à un décor monumental, à un tableau, à une tapisserie ou encore à une estampe.

C’est sur les liens qui unissent le dessin et l’estampe que les commissaires ont souhaité insister. Quoi de plus logique pour une institution, qui depuis sa création, sous Louis XIV justement, mêle dans ses portefeuilles les deux média? Ainsi, l’accrochage met systématiquement en regard des dessins les estampes qui en ont été tirées, si tant est que celles-ci soient conservées dans les collections de la bibliothèque.

On découvre ainsi comment les graveurs de métier interprétaient sur le cuivre les dessins que leur confiaient des peintres tels que Simon Vouet ou Estache Le Sueur ou comment d’autres concevaient eux-mêmes par le dessin leur projet. Les vocabulaires graphiques varient beaucoup selon la destination des feuilles : des traits appliqués, préfigurant les tailles du burin, des esquisses rapidement tracées, plaçant les grandes masses ou encore des lavis dont les taches modulent les volumes…

A travers ces dessins et ces estampes qui se font miroir, se reconstitue aussi un réseau parisien aux liens professionnels et familiaux fort (l’endogamie y était fréquente).
L’exposition ne montre pas seulement le « grand art » de ce « grand siècle », mais également une production plus courante, comme celle des almanach, ces calendriers monumentaux ornés d’une image à la gloire du pouvoir. Produit en nombre sous le règne de Louis XIV, ils sont aujourd’hui très rares, car conçus comme des pièces éphémères, destinées à être jetés une fois l’année écoulée.


Quelques inédits et beaucoup de chefs d’œuvres
Résultat de plusieurs décennies de recherche, l’exposition présente plusieurs inédits découverts dans les milliers de portefeuilles du département des Estampes (dont les collections sont évaluées à 12 millions de pièces!) et propose de nouvelles attributions pour d’autres feuilles.

Parmi les nouvelles découvertes remarquables, il y a de quoi s’émerveiller devant un portrait de la main de Louis XIII, qui avait attrapé auprès de Toussaint Dubreuil puis de Simon Vouet un joli coup de crayon, ou encore devant ce rare dessin de jeunesse de Le Brun, qui, encore débutant, dessinait pour la gravure et la tapisserie.

A voir jusqu’au 15 juin seulement, à la Bibliothèque nationale de France (site Richelieu) : informations pratiques sur le site internet de l’institution.

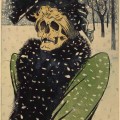
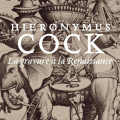
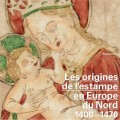

Pour une fois je ne serai pas d’accord avec vous 🙂 Vous écrivez « l’Italie, qui attire les artistes, bien que peu peuvent réellement faire le voyage ». Il me semble pourtant que tous ces peintres qui ont eu vingt ans sous Louis XIII sont allés en Italie : Claude Gellée, Nicolas Poussin, Jacques Callot, Simon Vouet, Jacques Blanchard et j’en passe, n’ayant pas votre érudition !
Il est vrai que beaucoup des peintres les plus connus y sont allés (Nicolas Poussin, Simon Vouet) mais le voyage était encore hors de portée de nombreuses bourses. A l’époque, il n’y avait pas encore d’Académie de France à Rome.
D’ailleurs, Jacques Callot avait fugué enfant et rallié l’Italie en se mêlant à un groupe de gitans… Et Poussin et Vouet ne seraient jamais rentrés en France si ils n’y avaient pas été contraints.
Je dois avouer que je connais assez mal cette époque : je vais vérifier mes informations dans mes cours…
Merci à vous de nous faire profiter de vos exigeantes découvertes, je me permets d’apporter mon grain : vous avez raison quand vous évoquez un voyage difficile à réaliser pour de nombreux peintres dans la mesure où l’Europe des Académies n’est pas encore née sous Louis XIII : elle advient par volonté politique à la fin du XVIIè siècle et connait son âge d’or au XVIIIème siècle. Continuez ce partage, je vais rebloguer tout de go, à nouveau merci.
Tout cela me fait penser que j’ai envie (depuis fort longtemps) de raconter l’extraordinaire vie de Jacques Callot!
J’attends avec impatience car mise à part les Grandes Misères de La Guerre (celle de Trente Ans) je n’y connais pas grand chose.
Merci pour votre reblogue! En espérant vous forunir encore du bon grain!
A reblogué ceci sur Une poule sur un muret a ajouté:
Pour lire ce bel article qui vous donnera envie de vous rendre à l’expo (mais très vite) ou si ce n’est pas possible naviguer sur le site qui lui est dédié.