Imaginons la visite muséale connectée de demain, où comment l’exposition pourrait devenir une bibliothèque, si l’on aidait un peu plus les ouvrages à voler hors des vitrines!

Livre exposé, livre enfermé?
Souvent, dans les expositions que je visite, sont présentés des livres. Des livres anciens, des livres récents, des manuscrits en latin, des imprimés annotés, des BD, des brochures populaires, des journaux sur du mauvais papier. Et il n’y a rien de plus frustrant. Le livre est là, enfermé, sous une vitrine. Prisonnier, condamné à ce que des milliers d’yeux parcourent sans cesse la même double page, cette double page à laquelle il a été ouvert. Cette double page qui comporte une information essentielle au propos de l’exposition, qui illustre une partie, qui dialogue avec d’autres artefacts. Quelques fois, c’est presque le hasard qui dicte la page d’ouverture : une triviale question de conservation d’un livre trop fragile. Souvent, le choix de l’ouverture relève du sacrifice : à défaut de tout montrer, il a fallu se résoudre à ne choisir qu’une page, le livre ne s’ouvrant qu’en un endroit à la fois.
- Jean Miélot, Miracles de Notre-Dame, XVe siècle, BnF
- [Roman du comte d’Artois], XVe siècle, BnF
L’objet textuel, dans l’exposition, ça n’est jamais évident. Il y aurait de quoi écrire des pages et des pages (une thèse, peut-être) sur l’exposabilité du livre. Mais là n’est pas mon propos. Je veux vous parler de la frustration du visiteur, interrompu dans sa lecture par la césure d’une page qui lui est interdit de tourner. La frustration du visiteur qui devine, sans pouvoir les voir, que le manuscrit contient d’autres enluminures, sûrement tout aussi belles que celle qu’il a sous les yeux. Sous vitrine, le livre est devenu muet, réduit à un fragment : une reliure fermée ou une double page parmi des milliers de feuillets. La partie dévoilée pour résumer un tout inaccessible.
Voir au musée, lire à la maison
A cette frustration que ressent le visiteur, le numérique peut apporter de multiples solutions pour une exposition en « réalité » augmentée! Voici l’expérience muséale dont je rêve…
Souvent, il existe un exemplaire numérisé, quelque part dans une bibliothèque numérique, de l’ouvrage exposé. Scrupuleusement, le visiteur curieux peut noter les références, photographier les cartels afin de retrouver sur Gallica cette Physiologie de la Lorette exposée au Musée Balzac ou ce numéro du Journal des voyages présenté dans l’exposition Kanak, l’art est une parole au Musée du Quai Branly.

Voilà une habitude que j’ai prise pour retrouver les documents qui m’avaient interpellée lors de mes sorties culturelles… parfois sans succès. Si bien que plus d’une fois, je me suis mise à rêver que les musées indiquent, directement sur leur site, une liste des pièces présentées dans l’exposition et par ailleurs numérisées et disponibles en ligne. Certaines institutions le font, comme la BnF qui accompagne ses importantes expositions de mini-sites fort pédagogiques dont les liens renvoient, de plus en plus, vers Gallica. Mais pourquoi ne pas le généraliser la pratique?

Livre numérisé, livre en liberté!
La consultation de l’ouvrage numérisé est presque toujours cantonnée à l’après-visite, déconnectée de l’expérience muséale. On ne peut plus comparer l’illustration au croquis préparatoire, regarder simultanément le manuscrit et texte imprimé. Et surtout, devant l’ouvrage numérisé, il manque le précieux appareil de médiation qu’offrait l’exposition…
A l’exposition Gustave Doré, quelle frustration de ne pouvoir détailler les cases d’une planche trop large, de ne pouvoir se pencher sur une illustration accrochée trop haut, de ne pouvoir tourner les pages d’une monumentale édition des fables! Comme j’aurais aimé parcourir l’exposition avec ma tablette, accédant directement aux ouvrages numérisés via l’application Gallica : mon expérience de visite en aurait été plus riche et beaucoup plus longue aussi… J’aurai pu feuilleter une revue de 1850 sur place, télécharger une version e-pub gratuite de tel ouvrage pour occuper un trajet en RER, partager un coup de coeur sur les réseaux sociaux!

Bien sûr tout cela est déjà à la portée du curieux équipé d’un bon matériel, de patience et d’une connexion 4G, mais pourquoi ne pas le rendre accessible au plus grand nombre, en signalant directement dans le parcours de l’exposition les ouvrages disponibles en ligne (avec un truc plus joli que des QRcodes, pitié!) et du wifi pour télécharger tout ça en trente secondes?
Et pour ceux qui n’ont pas de tablette? Des écrans tactiles accolés aux vitrines, contenant le double numérique et manipulable du livre exposé ou des bornes de consultation où lire, confortablement installé, l’ouvrage tout entier!

Il y aurait, autour de cette simple « sortie virtuelle du livre de la vitrine » des possibilités de dissémination énormes. Ainsi, il serait possible de partager toujours plus l’expérience muséale sur les réseaux sociaux, susciter chez d’autres l’envie de la visite ou « combler » un éloignement physique! Le visiteur s’enverrait par mail le lien vers un ouvrage qui lui a plu, l’étudiant sauvegarderait un document utile pour ses travaux dans sa bibliothèque Zotero … et l’annoterait dans le même temps!
Bref, on a libéré les livres sur la toile, faites les voler dans le musée maintenant!
Et vous, avez vous observé des dispositifs de médiation intéressants qui permettent de « sortir » le livre de sa vitrine? Racontez-les nous, les commentaires vous sont ouverts!




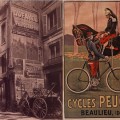

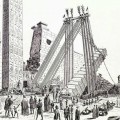

Passionnant !
« Des pages et des pages sur l’exposabilité du livre » : on ne vous a pas attendue, chère amie
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1228-le-livre-expose-enjeux-et-methodes-d-une-museographie-de-l-ecrit.pdf
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-02-0106-006
Oui, j’avais lu les actes il y a deux ans, je les avais complètement oubliés… Merci de me rafraîchir la mémoire.
Néanmoins, le paysage du numérique, l’offre des bib en ligne et des solutions techniques de médiation à tellement évolué depuis 1999 qu’il serait chouette de refaire de telles journées d’études.
Les articles cités, où on s’exprime encore en francs, sont obsolètes, comme les techniques qui y sont évoquées. En plus l’article de Peccadille a le mérite, lui, d’être clair et bien écrit.
Merci, Peccadille, pour cet article formidable qui me donne envie de faire voler les livres dans les musées !
Très bon billet !
Tu veux écouter des manuscrits pendant une visite ? Tu peux : http://www.bmi.agglo-epinal.fr//EXPLOITATION/ecouter-nos-manuscrits.aspx.
Quant à indiquer avec QR code ou autre l’accès au document numérisé, les bibliothèques s’y mettent avec bonheur… quand les emprunteurs (musées souvent) le négligent, même quand c’est dans les clauses du prêt !
C’est génial! Quelle belle idée!
Après avoir poussé mon cri du coeur, il faudra que j’écrive un article sur les solutions déjà présentes.
Après avoir abondement discuté du problème avec des amis, ils semblent que la frilosité des emprunteurs vienne de la peur (illégitime à mon sens) de faire chuter les ventes de catalogues…
Excellent article !!!
Je suis entièrement d’accord avec toi. Du coup, je vais partager sur twitter. 😉
Le musée d’histoire de Marseille est énormément équipé d’écrans tactiles, proposant zooms, images, photos, vidéos, cartes…. C’est le premier musée que je vois aussi bien équipé en numérique, meme si ce n’est pas exactement ce que tu décris dans l’article, il s’en approche. Si tu as l’occasion de le visiter n’hésite pas !
A bientôt. 🙂
Le musée d’histoire de Marseille présente des merveilles, comme cette paire de sandales du temps où Marseille était une ville grecque. Elles ont la pointure d’un enfant ou d’une jeune fille. Rarement un objet m’autant ému. Il est vrai que je suis marseillais 🙂 Excusez-moi si je suis un peu hors-sujet !
Ping : Quand la bibliothèque (numérique)...
Merci beaucoup Madame Peccadille pour ce très beau billet.
Du point de vue de l’enrichissement de visite, de la diffusion de la connaissance, oui on ne peut qu’être enthousiaste sur les propositions présentées.
On pourrait se demander même pourquoi ce n’est pas déjà le cas. Une des difficultés peut-être est la concurrence du catalogue. En effet la mise à disposition en ligne de la liste des références d’œuvres d’une exposition avec les prolongements possibles là ou ailleurs correspond à l’objectif premier du catalogue.
D’abord le catalogue papier est aujourd’hui encore le référent scientifique d’une exposition. La publication numérique constituerait une évolution majeure qui s’accompagnerait de problématiques nouvelles comme la pérennisation des ressources documentaire. L’avenir est certainement par là, mais il n’est pas certain que beaucoup d’établissements y soient prêts notamment dans leurs moyens. Si on regarde attentivement le mémoire d’Elise Gruselle sur Les publications numériques dans les musées http://issuu.com/elisegruselle/docs/les_publications_num_riques_dans_les_mus_es , une chose est particulièrement frappante dans les exemples présentés : la très grande majorité des sites d’exposition ont disparu quelques années après leur mise en ligne.
Par ailleurs le catalogue constitue souvent un enjeu économique conséquent, enjeu non négligeable notamment pour les établissements publics à qui l’on demande toujours plus d’autofinancement. Il ne s’agit pas d’intérêts purement mercantiles cherchant à maximiser le profit de l’événement culturel mais bien d’un modèle économique dans lequel le catalogue peut avoir une part importante dans les ressources permettant le montage d’exposition.
La mise à disposition de ressources documentaires complémentaires, exhaustives et pérennes apparaît sans doute pour un futur proche comme une évolution autant souhaitable –le billet l’exprime très bien- qu’inéluctable mais constitue encore aujourd’hui un choix qui peut s’avérer difficile pour les établissements culturels tant du point de la documentarisation de ces ressources que pour les enjeux économiques liés.
Heureusement il y a déjà des réalisations qui vont dans le sens du billet. À la Bnf par exemple avec le site dédié aux expositions : http://expositions.bnf.fr/. Un soin particulier semble avoir été porté à la pérennisation de ces sites qui ont autant un intérêt en complément de visites qu’en ressource autonome. Ils sont d’ailleurs largement référencés sur les plateformes pédagogiques et réutilisés notamment dans un contexte scolaire, parfois bien après l’exposition.
Et je me souviens après l’exposition L’Âge d’or des cartes cartes marines, qui m’avait tant émerveillé, avoir voyagé longuement navigué dans les cartes sur la Gallica via le site dédié de l’exposition, http://expositions.bnf.fr/marine/index.htm ; pour mon grand bonheur. Merci la Bnf !
Ping : Visites et lectures augmentées - prospec...
Merci pour le partage, il est vrai que le numérique a bel et bien intégré le paysage littéraire, annonçant même à ses début la fin des livres en papier. Je vous propose également de passer sur mon blog: où je reviens sur l’épineuse question de l’intégration du numérique dans les bibliothèques: http://christophelucius.fr/post/99315801941/le-numerique-peut-il-faire-revivre-les-bibliotheques
Je vous remercie de votre commentaire. Je pense que le numérique ne marque pas la fin des livres papiers mais ouvre juste de nouvelles perspectives et de nouveaux usages. Pour écrire comme pour lire, j’aime passer de l’un à l’autre. Je me régale d’une lecture séquentielle comme d’une lecture continue, d’une lecture sur papier comme d’une lecture sur écran : le support et la manière de lire sont en adéquation avec mes besoins et mon environnement du moment !
Je vous remercie de m’avoir indiqué le lien vers votre blog : la lecture de cet article était très intéressante !
Je découvre 3 ans plus tard le billet de Peccadille sur un sujet toujours d’actualité et qui m »intéresse sous l’angle particulier de l’exposition d’originaux d’archives. Je découvre ce billet en même temps que le blog tout entier, si intéressant.
Je partage la frustration, exposée avec tant de vivacité d’esprit, dont il est question devant l’impossibilité d’ouvrir la vitrine et de lire, alors que le but même de l’exposition est la découverte : un peu comme s’il n’y avait dans un resto que des menus …
Ici (Archives départementales de la Gironde), nous pratiquons le fac-similé feuilletable, placé sur la vitrine, pour certains documents.
Mais pour rendre compte de la réalité de la ressource, il faudrait à chaque fois présenter la liasse d’origine (où se trouve souvent l’information qui sert à rédiger la notice, d’ailleurs) et, de fil en aiguille, une grande partie des fonds mis en œuvre.
Si je comprends bien, le rêve dont il s’agit est de donner accès à un hybride de salle de lecture et de salle d’exposition dans l’univers virtuel. C’est une idée d’autant plus intéressante à creuser que pour les visiteurs, tout ce que nous faisons paraît étanche. Ainsi ai-je eu plusieurs fois la surprise de voir un visiteur de nos expos trouver étonnant le fait qu’il puisse, après le démontage et les réintégrations, accéder en salle de lecture aux documents provisoirement placés dans la prison de verre. La sacralisation de la vitrine (accrue par l’effort scénographique) est telle qu’elle accroît paradoxalement l’idée que nous voudrions au contraire combattre avec les expositions, que les archives constituent un monde inaccessible.
Mais comme une numérisation intégrale n’est pas imaginable, pourquoi ne pas chercher à mettre d’avantage en avant la valeur opératoire d’une cote, à cheval sur le monde réel et le monde virtuel ? Et si on cherche à le faire, comment y parvenir ?
Merci, Georges, pour ce beau et passionnant commentaire, qui m’amène d’une part à redécouvrir ce billet que j’avais oublié et d’autre part beaucoup de matière à réfléchir. A l’époque où je l’ai écrit, je n’y connaissais presque rien aux archives. J’ai depuis découvert beaucoup de choses dans ce domaine (un an d’expérience professionnelle en archives) et les questions que vous soulevez me sont familières.
Notamment celle de la sacralisation de la vitrine ou de l’institution. En effet, combien de fois m’a-t-on demandé « mais tout le monde peut aller aux archives ? Ca n’est pas réservé aux chercheurs ? ».
J’aime bien les fac similé feuilletables dans les expositions. Il leur manque souvent la matérialité de l’original cependant. C’est un bon début, peu onéreux, même si, en cas de manipulations fréquentes, ça s’abîme bien vite.
A Lyon, les expositions patrimoniales de la Bibliothèque municipales sont doublées d’expositions virtuelles où sont rassemblés tous les liens vers les ouvrages numérisés. Je crois même me souvenir que les ouvrages accessibles en ligne sont signalés sur les cartels et dans le livret de visite. Cela me semble actuellement une des meilleures options. Peut-être y aurait-il un produit à développer autour de cette problématique ?
Votre commentaire m’a fait relire mon billet et redécouvrir son contenu alors même que j’ai passé ma soirée d’hier à chasser sur les bibliothèques numériques et autres bases de données quelques unes des enluminures vues à l’exposition « Verre, un Moyen-Age inventif » du Musée de Cluny (billet à venir dans les jours qui viennent). J’ai reproduit les gestes évoqués dans ce billet, me questionnant sur l’accessibilité des manuscrits pour les non-avertis.
Chose amusante, j’ai passé un petit bout de temps à chercher les Miracles de Notre-Dame de Jean Miélot, qui était exposé à Bruxelles en 2013 ou 2014 … et, ouvert à la même page, à Cluny en 2017 !
les expositions d’archives, genre plus récent que celui des expos d’art, ont habituellement pour but de faire découvrir un sujet historique et de fournir des pistes pour le creuser.
Elles cherchent aussi à leur façon à dissiper les effets d’un mythe de l’accessibilité, dont Matteo Ferleani a très bien démonté le mécanisme pour le patrimoine numérisé dans son ensemble.
C’est pourquoi si la mise en scène des documents eux-mêmes a progressé, on peut regretter que la référence, la cote, vues comme des clefs de contact permettant de lancer une recherche, soient d’une telle discrétion.
J’ai vu un jour dans un blog de généalogistes (une seule fois) une réflexion faite au passage sur le temps que pouvait faire gagner le fait de comprendre ce qu’était une cote dans un monde ou par définition, la masse de ce qui est « off line » l’emporte, de façon croissante, sur la masse de ce qui est « on line ».
C’est d’ailleurs un trait commun avec les bibliothèques (et dans une moindre mesure avec les musées, où la prise en compte réglementaire de la nécessité de l’inventaire est finalement assez récente).
Nous avons l’occasion de réfléchir pas mal à cette question ici, dans le cadre de la refonte à venir de notre site Internet : comment faire pour qu’il montre la partie immergée de l’iceberg de façon équilibrée ? Comment faire pour que l’écran n’enferme pas … dans l’écran ?