Il y a toujours quelque chose de fascinant à observer lorsqu’on passe dans les locaux des ateliers d’art de la Réunion des Musées Nationaux (RMN). Lors de ma dernière visite, quelques jours avant Noël, je rencontre Lucile Vanstaevel, jeune imprimeur d’art anciennement apprentie et employée depuis quelques mois à la Chalcographie du Louvre. Elle tirait une planche figurant les ponts de Paris, gravée vers 1910 par Caroline-Helena Armington (1875-1939). L’occasion de décrire le savoir-faire perpétué ici, ou « comment imprime-t-on des matrices anciennes ? ».
La Chalcographie du Louvre conserve plus de 14 000 planches datées du XVIIe au XXIe siècle. Une partie est encore exploitée à des fins commerciales (mais pas seulement…) par la Réunion des Musées nationaux.
Chaque année 3000 tirages sortent des presses pour répondre à des commandes ou alimenter les boutiques des musées. Ici, quatre imprimeurs font vivre une collection patrimoniale tout en conservant un précieux savoir-faire. Ce lundi veille de fête de fin d’année, je rencontre Lucile qui s’active à tirer une trentaine d’exemplaires d’une matrice du début du XXe siècle : Le Pont des Arts et l’Île de la Cité. Gravée vers 1910 par Caroline-Helena Armington une artiste d’origine canadienne arrivée en France autour de 1900, la série des Ponts de Paris se vend bien, car elle séduit les touristes. Pour une centaine d’euros, ils s’offrent bien mieux qu’une reproduction acquise sur les quais : une véritable impression, soignée et précise, d’une eau-forte originale.

La série des ponts de Paris est donc un succès de la boutique du Louvre et il faut régulièrement réapprovisionner le stock. Pour le tirage d’une trentaine d’épreuves, Lucile va consacrer deux jours de travail.
Préparation du travail
La première étape de ce travail consiste à prélever la matrice dans la réserve et à contrôler son état. Lucile commence par retirer la couche de vernis qui protège le métal de l’oxydation en dehors des périodes d’exploitation. Ici, la matrice, une plaque de cuivre gravée à l’eau-forte a été chromée pour renforcer sa dureté — et donc réduire l’usure qu’entraîne son exploitation.
Lucile inspecte méticuleusement l’élément d’impression : la planche est-elle parfaitement plane ? les tailles sont-elles encore nettes ou nécessitent-elles un nettoyage plus poussé ? Y’a-t-il des accidents de surface ? L’imprimeur repère une bosse dans le ciel et quelques tailles fines presque bouchées qui risqueront de disparaître à l’impression. Autant d’irrégularités qu’il convient de prendre en compte pour offrir un tirage aussi parfait que possible.

Pour modèle, Lucile dispose d’un tirage de référence, qui fait office de « bon à tirer » : il est nécessaire de s’y référer pour ajuster l’encrage et assurer l’uniformité des épreuves. Dans l’estampe contemporaine, l’imprimeur procède toujours à divers essais, parmi lesquels l’artiste arrête une épreuve qui le satisfait : il s’agit du bon à tirer, à partir duquel tous les tirages sont effectués. Pour l’estampe ancienne, de tels documents n’existent pas toujours dans l’atelier et il est parfois nécessaire de se référer aux tirages d’époque conservés dans les bibliothèques patrimoniales : c’est à partir d’eux qu’une nouvelle épreuve de référence est réalisée.
Pour les Ponts de Paris, régulièrement tirés, il existe de telles feuilles de référence. Lucile a attentivement étudié celle du Pont Notre-Dame afin d’appréhender la couleur exacte de l’encre et les particularités de l’encrage. À la chalcographie, il est rare que l’on emploie l’encre « sortie du pot » (c’est-à-dire telle qu’elle est commercialisée) : il est souvent nécessaire de faire une petite cuisine pour obtenir la consistance d’encre adaptée à la matrice. « Une particularité de la chalcographie » me confie Lucile, qui n’a pas appris ces secrets d’ateliers à l’École. « Ici, on prend le temps de mener une recherche sur les encres » poursuit-elle. Pour cette planche, elle a additionné de l’encre noire « carbone » aux reflets bleutés, de l’encre noire Vulcano (à teinte rouge), un peu de sépia et d’encre transparente additionnée à un peu de cire microcristalline pour mieux démouler et à de un vernis résineux pour plus de malléabilité. La mise au point de l’encre, les tirages d’essai pour repérer les difficultés, la comparaison au modèle, tout cela lui a demandé une heure de travail car elle commence à avoir le coup de main. L’impression des trente épreuves lui demandera deux jours. J’assiste plusieurs fois au cycle qui fait naître l’image à une cadence de 4 épreuves par heure.

Encrer la matrice
L’opération commence par l’encrage de la matrice. Lucile a un petit tas de son mélange, qu’elle travaille de temps en temps à la spatule : il faut que l’encre reste élastique sans devenir ni trop collante ni trop liquide. Pour cela, la température de l’atelier joue beaucoup et il fait par conséquent bon dans l’imprimerie. De plus, la matrice est placée sur une plaque chauffante afin d’assurer une bonne adhésion de l’encre. Lucile procède à un généreux encrage à l’aide du rouleau : le geste est vigoureux car l’encre doit bien pénétrer les tailles.
Intervient ensuite l’essuyage : il faut retirer toute l’encre superflue qui se trouve hors des tailles. Les parties non gravées de la matrice doivent en effet être nettoyées jusqu’à briller : toute trace d’encre hors des parties gravées se verra sur l’impression et altérera le tracé original.

L’essuyage est progressif : l’imprimeur commence à retirer le plus gros à l’aide d’une tarlatane (de la mousseline amidonnée), puis réitère l’opération avec une autre tarlatane plus propre. Le gros de l’encre est retiré : le motif gravé réapparaît. Intervient alors le paumage : plus de mousseline ici pour retirer le surplus d’encre, mais la paume de la main, qui, chargée d’un peu de blanc de Meudon caresse le métal afin de laisser une très légère couche d’encre qui viendra teinter de manière uniforme l’ensemble de l’image. L’essuyage est maintenant terminé, et la surface de l’élément d’impression brille comme un miroir.


Une attention toute particulière est portée au nettoyage des biseaux, qui doivent être immaculés. La pression des cylindres de la presse exercée sur la planche créera un gaufrage du papier au pourtour de la plaque (c’est ce qu’on appelle « le coup de planche ») et tout résidu d’encre y est fatal.

Lucile connaît bien la planche du jour et a optimisé au mieux l’essuyage et le paumage. « Il ne faut pas trop essuyer le ciel et préférer bloquer l’encre à la main sur cette partie sinon on fait disparaître ou « piqueter » le tracé des nuages : les tailles sont ici très fines », me précise-t-elle. Si fines qu’il faut un peu aider l’encre à affleurer hors des tailles par l’opération finale de retroussage. L’épreuve témoin laisse voir dans le ciel des effets de velouté autour des tailles, dans un goût propre à l’estampe du tournant du siècle. Ce velouté est obtenu en passant délicatement une mousseline sur les tailles, ce qui fait légèrement remonter l’encre au bord de ces dernières.

Passage sous presse
La matrice est enfin prête pour l’impression : Lucile place sa plaque de métal sur le plateau de la presse. Au cours de la mise au point, elle a fait des marques de repérage pour bien placer l’élément d’impression et les feuilles de papier. Ainsi, elle est assurée de produire des épreuves parfaitement centrées et identiques. La feuille mise en place, elle lance l’impression en rabattant les langes, ces épaisses couvertures de feutre qui assouplissent la pression du rouleau et évitent que la feuille de papier ne se tranche sur les bords de la plaque.

Le papier utilisé pour l’impression est légèrement humidifié afin d’être plus souple et réceptif à l’encre : on dit d’une impression bien venue qu’elle « est amour » !

Les réglages de la pression, le nombre et l’épaisseur des langes sont choisis par l’imprimeur selon les particularités de la matrice et le résultat escompté. Autant de mises au point que Lucile a effectuées en amont. C’est pourquoi une fois le tirage d’une plaque enclenchée, il convient d’en tirer un nombre convenable d’exemplaires afin d’amortir le temps passé à la mise au point de l’encre et au réglage de la presse.

La chalcographie du Louvre dispose de quatre presses, toutes électriques, ce qui soulage les imprimeurs d’un effort physique considérable, celui d’actionner le plateau à la force de leur bras, comme on le voit représenté dans les gravures anciennes.
À la sortie de la presse intervient le moment le plus émouvant, celui de la séparation encre l’épreuve encore humide et la matrice : à l’aide de « mitaines », l’imprimeur se saisit de la feuille et la retire, délicatement mais fermement. Un des additifs de l’encre, la cire microcristalline, aide au démoulage.

Après l’impression
Lucile inspecte son travail et vérifie qu’il n’y a aucun manque dans les zones sensibles. La matrice, ancienne et souvent tirée, présente en effet des défauts : il y a un coup dans le cuivre, qui laisse des traces s’il est mal essuyé. En même temps, le ciel, très peu profondément gravé, disparaît si l’essuyage est trop vigoureux ou si le retroussage a été oublié. Savant dosage.

L’impression de l’épreuve est terminée, Lucile peut maintenant recommencer l’ensemble des opérations pour donner naissance à une nouvelle image, identique en tout point à la précédente. L’ensemble des tirages qu’elle a effectués aujourd’hui sera disposé dans le cartonnier afin que l’humidité s’évapore progressivement et uniformément des fibres du papier.
À l’issue de quelques jours, les épreuves seront inspectées par l’un des artisans qui s’assurera de leur uniformité et corrigera d’éventuels détails. Bonnes pour la commercialisation, elles seront visées de la marque de la chalcographie par gaufrage du papier. Cette marque est un gage de qualité et permet de dater le tirage (afin qu’il ne soit pas vendu comme une épreuve ancienne).
Des épreuves de la série des Ponts de Paris sont disponibles à la vente dans la boutique de la RMN au Louvre et sur le site de la chalocographie.














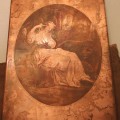



Super d’avoir pris le temps d’écrire et d’illustrer cet article ! Merci
Très joli reportage !
Ping : Merkwaardig (week 5) | www.weyerman.nl
Merci beaucoup de consacrer du temps à nous faire découvrir ces savoirs-faire ; c’est tellement intéressant et agréable ! – l’ » ancienne école » a toujours de beaux jours devant elle 🙂