Avant d’entrer dans le vif du sujet et de vous raconter la guerre d’Augustin Garnault, laissez-moi vous présenter les personnages de notre histoire : Augustin, ses parents, Auguste et Léontine, ses oncles, Jules et Henri, son épouse, Cécile… et bien d’autres, qui rejoindront le récit.

Nota : les documents ici présentés, sauf mention contraire, sont des archives familiales. Merci de ne pas les reproduire sans autorisation.
Une enfance à la forge de éernay
Augustin Garnault nait le 12 septembre 1888 à Ternay, un petit village de 400 habitants, au nord de la Vienne aux confins des Deux-Sèvres, à 10 km de Loudun et 17 km de Thouars. Son père, Auguste Garnault est maréchal-ferrant ; sa mère Léontine Briant assure l’intendance de l’entreprise familiale, qui porte leurs deux noms.

À la fin du XIXe siècle, le maréchal-ferrant est un homme important au sein d’une communauté villageoise. Il assure la ferrure des chevaux, la fabrication et la réparation du matériel agricole. Il semble que ses serpes et ses haches étaient réputées dans tout le canton et au-delà, notamment auprès des gauchers puisqu’Auguste, lui-même gaucher, fabrique des instruments spécifiquement à leur usage.
Auguste Garnault a aussi su s’adapter à l’industrialisation des campagnes : il est concessionnaire d’un fabricant de matériel agricole américain, John Deer. Les machines, des moissonneuses-lieuses et des faucheuses lui arrivent en pièces détachées par le port de Nantes. Elles sont acheminées jusqu’au village en chemin de fer, puis en charrette. Pour deux moissonneuses achetées, la troisième ne lui coûte rien. Ce commerce enrichit le couple, qui espère ainsi assurer une rente pour sa vieillesse.

L’en-tête de l’entreprise familiale nous apprend qu’Auguste vend et répare également des bicyclettes. Il avait probablement été l’un des premiers du village à enfourcher un tel engin : en 1892, il achetait sa première bicyclette (à l’origine de quelques anecdotes que je vous raconterai une autre fois), et c’est par la suite seulement qu’il se mit lui-même à en commercialiser. Peut-être était-il membre du cercle vélocipédique de Saint-Léger, un bourg voisin ?
L’atelier se trouve au hameau de Montjaugin, où vit la famille. Juste après leur mariage, Auguste et Léontine ont acheté une habitation en cave (une demeure troglodytique, qui fut comblée en 1968). Quelques années plus tard, ils font construire sur leur terrain une maison, qui abrite aussi la forge. Cette dernière est agrandie en 1898. Les ouvriers, quant à eux, sont logés dans la chambre troglodytique.
C’est donc à Ternay, au lieu-dit Montjaugin qu’Augustin grandit. Bien qu’une école existe dans le village, c’est à celle de Curçay, le bourg voisin, qu’il est scolarisé. Pourquoi ce choix ? Est-ce parce que son oncle maternel vit là-bas ou bien est-ce parce que le maître, Louis Jacques Manson est très apprécié (son rapport d’inspection, conservé aux Archives départementales de la Vienne est fort élogieux) ? Quoiqu’il en soit, il mène Augustin jusqu’au certificat d’études primaires qu’il obtient le 5 juillet 1901. A l’époque, seuls 30% des écoliers décrochent ce diplôme. Augustin a-t-il poursuivi ses études au delà ? Je ne le pensais pas, mais en cherchant sa trace sur internet, je suis tombée sur une plaque commémorative apposée au Collège de Loudun, en hommage à ses anciens élèves morts pour la France. Un certain A. Garnaud y figure. Le souvenir français de Loudun a fait le rapprochement, mais est-ce bien lui ? Un homonyme ? Le nom est répondu dans la région… Il faudra enquêter !
Il existe une photo de l’enfance d’Augustin, il a alors environ cinq ans, nous sommes probablement en 1893. La photographie a été prise à Morton, à huit kilomètres de Ternay. C’est là que vit une bonne partie de la famille paternelle. Son grand-père, Pierre Frédéric, au centre, est aussi maréchal-ferrant. Son fils Jules (à droite) travaille avec lui. La femme qui l’accompagne est probablement son épouse, Adrienne. Léontine et Auguste sont à gauche de la photographie. Les deux femmes assises, entre lesquelles Augustin se tient sont probablement sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Toutes deux se prénomment Louise. La doyenne de la photographie a environ soixante-quinze ans le jour de cette prise de vue : elle est née en 1817 !

Les débuts d’un cultivateur
Adolescent, Augustin prend une décision qui ne fut pas sans provoquer quelques tensions familiales : il renonce à suivre la voie tracée par son père et son grand-père, celle de maréchal-ferrant. Au travail du métal, il préfère le labeur de la terre et décide de devenir cultivateur.
Il part donc travailler chez son oncle maternel, Henri Briant, qui est fermier à Curçay. Nous sommes en 1905. C’est probablement à cette époque qu’Augustin, âgé de dix-sept ans, commence à côtoyer celle qui deviendra sa femme, Cécile Simon. De trois ans son cadet, elle vit dans la maison face à celle d’Henri Briant avec sa mère, Heloïse Richard. Son père, Célestin Simon, est mort depuis 1901. Elle a deux frères, Edmond et Gaston. Le premier s’installe comme boulanger, le second sera agriculteur.

Faire son service militaire en 1910
En 1908, Augustin a vingt ans. Comme tous les garçons de sa classe d’âge, il se rend au bureau de recrutement pour le conseil de révision. La commission le déclare apte au service. Les registres matricules, conservés aux Archives départementales de la Vienne, nous livrent sa description physique : il mesure un mètre soixante-cinq, a les cheveux et les sourcils noirs, le visage ovale et les yeux gris.
La liste de conscription, récemment mise en ligne par les Archives départementales de la Vienne nous donne des détails supplémentaires sur sa personnalité : Augustin n’est pas musicien, mais il sait monter à cheval et faire du vélo. Il sait aussi conduire des voitures hippomobiles, mais pas automobiles. Il n’est pas non plus colombophile ou aérostier. Il ne sait pas nager et n’a jamais reçu de prix de gymnastique ou de tir.

Le 6 octobre 1909, il débute son service militaire, qui dure alors deux ans. Deux ans pendant lesquels, à chaque lettre qu’il écrira à ses proches, il comptera le nombre de jours avant « la fuite ». On l’incorpore dans le 33e Régiment d’artillerie de Campagne, basé à Poitiers. La correspondance qu’il adresse à ses parents (une quarantaine de lettres actuellement identifiées, mais pas toutes datées) éclaire le quotidien d’un jeune conscrit. Pour sa première missive, il utilise un papier fourni par l’armée : l’en-tête figure la caserne. Par une petite croix, il pointe son dortoir à la caserne d’Aboville, accompagné de ces mots « Voici où je couche. 78 marches à monter » ! On imagine bien qu’un garçon de la campagne a peu eu l’occasion d’en gravir autant !

Au régiment, on l’affecte au rôle de pointeur, c’est-à-dire de celui qui règle le tir du canon. Augustin est peu satisfait de cette affectation : il aurait préféré être conducteur et s’occuper des montures, lui qui aime les chevaux. Mais cette tâche est réservée aux conscrits les moins instruits : ceux qui savent calculer, comme lui, sont, écrit-il à ses parents, de préférence orientés vers les postes plus techniques, comme celui de pointeur.
Le contact du canon lui est fort désagréable, d’autant que, durant tout son service militaire, Augustin souffre de problèmes aux oreilles. Des épisodes de surdité l’empêchent de suivre correctement les écoles à feu. Les soucis de santé, l’incompréhension du médecin de la caserne occupent une bonne part de sa correspondance.
Outre les lettres qu’il adresse régulièrement à ses parents et quelques missives à des camarades, Augustin a une autre correspondante : Cécile Simon, la jeune voisine de son oncle. Dans les missives, il la tutoie, elle le vouvoie. Les permissions sont l’occasion de se rencontrer, aux assemblées de village et à diverses fêtes locales. Bien que Cécile semble avoir d’autres prétendants (quelques lettres qu’elle a reçues le laissent penser), c’est avec Augustin qu’elle se fiance au retour de ce dernier, à la fin de l’année 1911.
Deux ans de bonheur
Cécile et Augustin se marient le 4 février 1912. Cette année-là, cinq mariages sont célébrés dans le village de Curçay. Le jeune couple emménage dans une chambre de la « Maison Bleue », la gentilhommière dont Henri Briant possède la moitié.

En mars 1913 le couple donne naissance à leur premier et unique enfant, Gaëtan, mon arrière-grand-père – le seul de cette histoire que j’ai connu.
Le 1er août 1914, la guerre est imminente, l’ordre de mobilisation est lancé. Comme tous les cultivateurs et journaliers mobilisés, Augustin abandonne la moisson dans les champs et se met en route pour rejoindre son corps, à Angers. Il ignore qu’il ne reverra pas les siens avant longtemps : on leur a promis une guerre courte.
Sources mobilisées
- Mémoires de Gaëtan Garnault et notes sur l’histoire familiale. Archives privées de la famille Garnault.
- Correspondance d’Augustin Garnault. Archives privées de la famille Garnault.
- Photographies de la famille Garnault. Archives privées de la famille Garnault.
- Annuaires de la Vienne, années 1899, 1904, 1910, 1912. Archives départementales de la Vienne, 79 J 4-6.
- Recensements de la population pour les villages de Curçay et Ternay, Archives départementales de la Vienne
- Registres matricules et listes de conscription, Archives départementales de la Vienne, série 1 R
- Procès verbaux du certificat d’études primaires, Archives départementales de la Vienne, 1 T 2/536
- Dossier d’inspection de Louis Jacques Manson, Archives départementales de la Vienne, en cours de classement.
- Cadastre de Ternay, Archives départementales de la Vienne, 4 P 1485 et 4 P 3323-3326.
Un immense merci aux agents des Archives départementales de la Vienne pour l’aide qu’ils m’ont apporté dans mes recherches. Reconnaissance également à André Rivière et Joël Guyonneau, pour les deux photographies du 33e RAC qu’ils m’ont autorisé à reproduire.





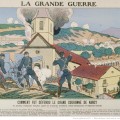


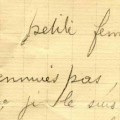
Une partie de ma famille vient de Loudun… autant dire que bon nombre de références de cet article me sont familières… c’est très troublant. En tous cas, c’est un beau travail !
Ah, je suis heureuse que les articles sur le Loudunais trouvent des oreilles qui ont en tête les images de la campagne ! Cela me fait plaisir. Une fois que j’aurais épuisé le sujet « Augustin », je partirai à la rencontre d’autres habitants du canton… d’hier et d’aujourd’hui !
On sent qu’il y a un énorme travail de recherche derrière mais ça ne fait que renforcer l’immersion… Aucun doute je lirais la suite !
… Ca ça me motive à écrire la suite. Merci Mealin !!!
Très beau témoignage.
J’ai d’autant plus apprécié votre billet que mon arrière grand-père a eu un parcours proche de votre arrière arrière grand-père. Il était lui-aussi maréchal-ferrant, mais dans un petit village de l’Indre, après la guerre, a fait son service militaire au 20 RA de Poitiers en 1903, et a été mobilisé en aout 1914, comme réserviste… Je fais actuellement des recherches, mais sans documents familiaux…
Quelle agréable surprise de voir mon grand-père Julien dans son atelier! J’aurais bien aimé mieux le connaître. Merci à vous.
Il y a longtemps qu’un commentaire sur ce blog ne m’avait fait si plaisir ! Quel heureux hasard quand des visages photographiés parlent à plusieurs personnes !
Cette photo là, je l’ai longuement regardée : que faire de cette indication manuscrite « atelier du charron J. Calou » ? Lequel était-ce parmi les deux hommes de droite ? Où se situait son atelier dans le village de Ternay ? Le bâtiment existait-il toujours ? Quelle relation – amicale ou professionnelle – liait ces hommes ?
J’espère qu’en échangeant nos connaissances sur nos familles respectives nous pourrons décrypter ensemble ce que nous raconte cette photographie… Comme je vous le disais par mail, je vais farfouiller dans les papiers familiaux pour chercher une mention de votre grand-père : il est possible que mon arrière-grand-père en parle dans ses mémoires, qu’il apparaisse dans le livre de compte ou bien encore que nous reconnaissions son visage sur une photographie de mariage… L’enquête ne fait que commencer !
Ravi je suis de vous avoir fait si plaisir également. Mon grand-père Julien CALOU, charron mais aussi maréchal-ferrant, se situe tout à droite et son atelier se situait bien à Ternay et le bâtiment existe bien toujours oui mais certainement transformé. Je vous indiquerai cela ultérieurement par mail. Merci pour vos futures recherches et tenons-nous au courant oui. Et oui, une sacrée enquête bien passionnante qui mérite de nombreuses investigations 🙂 …