Augustin Garnault était artilleur pendant la Première Guerre mondiale. Sur le blog, je partage avec vous mes recherches sur son parcours. Pour retrouver l’intégralité des articles, c’est ici.
La première lettre de notre histoire date du 4 août 1914. L’Allemagne vient de déclarer la guerre à la France ; Augustin n’est pas encore parti au front – il vient juste de rejoindre son régiment à Angers – mais déjà il entame sa correspondance avec son épouse.

Mobilisation générale !
Comment ont-ils appris l’ordre de mobilisation ? Cécile et Augustin étaient-ils aux champs, ce samedi 1er août 1914, un peu après quatre heures de l’après-midi ? Comme toute la France rurale, Curçay était occupé aux moissons lorsque l’imminence de la guerre a interrompu les travaux des champs. Si dans les villes les rumeurs enflaient et que les mieux informés savaient le risque de guerre imminent, celle-ci fut une surprise pour la majorité des ruraux. Quelques jours auparavant, le 26 juillet, le ministère de l’Intérieur avait demandé aux préfets de convoquer les directeurs de journaux et de les convaincre de ne pas insister dans leurs pages sur la gravité de la situation internationale.
À Curçay, comme dans tout le pays loudunais, la préoccupation était donc plus aux travaux des champs qu’au lointain conflit austro-hongrois.

Ce samedi là, dans l’après-midi, un ordre est télégraphié à toutes les préfectures de France : celui de la mobilisation. De village en village, les gendarmes portent la nouvelle. Dans la campagne, les cloches sonnent le tocsin. Les villageois interrompent leur besogne et gagnent la place communale. Là, devant le perron de la mairie, la foule se presse. À Curçay, Ernest Piraudeau, l’élu local, lit à la population l’ordre de mobilisation générale que lui ont remis les gendarmes. Dans les heures qui suivront, le garde champêtre et afficheur municipal, M. Lasne ira jusque dans les hameaux isolés pour placarder l’avis.

Reste-t-il cette affiche dans les archives communales ? Des traces de la mobilisation générale? Des témoignages ? Il faudra que j’aille à la mairie du village pour le savoir…
Comment les habitants de Curçay ont-ils reçu la nouvelle ? Il y a longtemps que les historiens ont remis en cause le mythe des scènes de liesse et des soldats partant à la guerre la fleur au fusil. S’il y a bien eu des manifestations de patriotisme dans les gares et les grandes villes, la plupart des Français sont seulement résolus à faire leur devoir en « bon Français » selon la formule employée par mon aïeul. L’école, l’église, l’armée ont inculqué aux hommes le sentiment patriotique, le désir de revanche après la défaite de 1870 et l’obéissance. Défendre la nation devant la menace ennemie apparaît comme une nécessité, un devoir que l’on ne discute pas.
Dans les campagnes, expliquent André Loez et Rémi Cazals dans leur ouvrage Vivre et mourir dans les tranchées, l’annonce de la mobilisation est immédiatement perçue comme le début de la guerre. D’ailleurs, un témoignage retrouvé par Jacques Bouquet, l’auteur de 1914-1918, la Vienne. Un département de l’arrière dans la Grande Guerre, confirme cette confusion : « 4h 1/2 du soir : je suis à l’église. Des hommes se précipitent, effarés, par la porte et par l’escalier. Qu’y a-t-il ? Nous allons sonner le tocsin car la guerre est déclarée (…) 5h 1/2 : on s’est trompés : ce n’est pas la déclaration de guerre, c’est la mobilisation. Quel soulagement ! » rapporte en 1920 le curé-doyen de Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers.
Partout, la séparation est douloureuse pour les familles, mais les codes sociaux veulent que l’on n’étale pas ses émotions sur la place publique. Aussi les femmes pleurent discrètement et les hommes serrent les dents.
Rejoindre le régiment
Augustin, qui a fini son service militaire deux ans plus tôt fait partie des mobilisés. À la maison, il conserve son livret militaire où est indiquée la procédure à suivre – où se rendre, quel jour. Car tous les soldats ne sont pas mobilisés au même moment : ce serait sinon ingérable pour les autorités ; casernes et gares seraient saturées. Dans le livret militaire, donc, un tampon indique quel jour, en cas de mobilisation, le soldat doit se présenter à la caserne.

Je n’ai malheureusement pas retrouvé le livret militaire d’Augustin, mais je suppose qu’il était convoqué au premier jour de la mobilisation puisqu’il est à Angers dès le 2 août.
Comment se sont déroulés les adieux à sa femme, à son fils ? Ses parents l’ont-ils accompagné à la gare de Saint-Léger-de-Montbrillais comme ils le faisaient du temps de son service militaire ? A-t-il eu le temps d’aller embrasser son oncle et sa tante, à Morton ?

Augustin n’est bien sûr pas le seul à partir. Des dizaines d’autres jeunes gens du canton sont mobilisés. Combien ne reviendront pas ?
Arrivé à la gare Saint-Laud d’Angers, Augustin n’a qu’à suivre les réservistes qui se regroupent sous le panneau qui porte l’inscription 33e régiment. On les conduit à la caserne, où on leur remet l’uniforme et le matériel : ils entrent en civil et ressortent en soldat.

À la caserne du quartier Langlois, nouvellement construite pour le 33e RAC, Augustin retrouve quelques garçons de sa classe d’âge et surtout le capitaine avec qui il a effectué son service militaire. « Quand je suis parti d’Angers, mon capitaine était content que je sois avec lui. » confira Augustin à ses parents le 15 avril 1915.

Angers, le 4 août 1914
« Depuis deux jours dans la ville d’Angers nous sommes des milliers à circuler » écrit-il à Cécile. Difficile d’imaginer l’effervescence qui règne dans les rues de la ville, autour des casernes et de la gare. Des dizaines de milliers d’hommes se présentent au corps. Les journaux locaux, comme Le Petit Courrier témoignent également de cette agitation inhabituelle.
Mais faut-il vraiment faire confiance aux récits que dressent les journalistes ? Tout au long du conflit, les journaux recevront des directives pour maintenir le moral des Français. Ainsi, dans les jours qui suivent la mobilisation, les reporters et pigistes, pris dans l’élan patriotique, insistent plus volontiers sur l’héroïsme des soldats, leurs touchants adieux aux êtres chéris et sur le spectacle des jeunes hommes défilant en tenue militaire que sur les douloureuses séparations.
J’aurais aimé trouver des photographies des rues d’Angers dans les premiers jours d’août 1914, mais il semble qu’il n’en existe pas. Un archiviste de la ville m’a seulement signalé une photographie, parue dans la presse, qui montre la gare Saint-Laud en août 1914.
La première lettre
C’est donc là, dans ce contexte, qu’Augustin écrit sa première lettre du conflit, du moins la première que nous conservons. Lettre de séparation, qui se veut rassurante, pleine d’espoir.
Chère petite femme,
Ne t’ennuies pas, sois aussi brave comme je le suis, je suis [armé?]. Je viens de t’envoyer une lettre avec tous les camarades de ma classe, des Maréchaux de Logis de ma classe aussi, alors il faut marcher, nous y allons tous bravement tous en coeur. Il faut espérer qu’il n’y aura pas de mal et que nous serons les vainqueurs, ce n’est pas comme si j’étais seul. Depuis 2 jours dans la ville d’Angers nous sommes des milliers à circuler, je crois que demain 5 août nous allons vers Langres dans la Haute-Marne mais ce n’est pas sûr. Je te prie d’embrasser toujours mon petit Gaëtan pour moi, je vous embrasse tous deux bien fort tous les jours. Ne te fait pas de chimères, faites comme vous le pouvez, espérance de se revoir d’ici peu.
Écris-moi et me fait voir que tu es comme moi, je suis bon français et ne recule pas.
Bien le bonjour à tous.
Comme je te le dis ne compte pas sur mes correspondances, car nous n’aurons pas toujours le temps, je ferai mon possible et il pourrait se faire que la circulation n’aura pas lieu.
Nous n’avons pas beaucoup de temps à nous.
Ton petit homme qui ne t’oubliras jamais aussi mon petit Gaëtan et vous tous ne vous désolez pas .
Voici mon adresse ; Garnault Augustin au 9e corps de l’armée, 18e division, 33e d’artillerie, 3e batterie à suivre.
… à suivre, donc.

Bibliographie
Pour comprendre l’impact de la mobilisation sur la vie d’un cultivateur du Poitou et imaginer dans quel contexte la séparation s’est produite, je me suis appuyée sur plusieurs ouvrages, dont Vivre et mourir dans les tranchées d’André Loez et Rémi Cazals et Survivre au front, 1914-1918, les poilus entre contrainte et consentement, de François Cochet. Les deux premiers chapitres de ce livre dépeignent la société française en 1914 et ses codifications sociales, ainsi que l’apprentissage du consentement des futurs soldats au cours de leur enfance puis de leur service militaire. Mais c’est l’ouvrage de Clémentine Vidal-Naquet, Couples dans la Grande Guerre qui m’a éclairée le plus précisément sur les séparations au moment de la mobilisation. Ses analyses sur l’expression des émotions ressenties par les acteurs et sur le traitement dans la presse des scènes d’adieu sont passionnantes, que j’aurais aimé savoir transcrire avec plus de finesse dans ce billet.
Le catalogue de l’exposition des Archives nationales, Août 1914, tous en guerre ! m’a beaucoup éclairée sur le processus de mobilisation de la nation et sur le rôle des préfets et des maires dans les premiers mois de la guerre.
Enfin, j’ai puisé des éléments de contexte local dans le livret édité par les Archives départementales des Deux-Sèvres, Loin du front… un front intérieur, Les Deux Sèvres dans la Grande Guerre et dans le précieux livre de Jacques Bouquet, 1914-1918, la Vienne, un département dans la Grande Guerre. Je remercie chaleureusement Élisabeth qui m’a envoyé quelques informations publiées dans le catalogue des AD du Maine-et-Loire, L’Anjou dans la Grande Guerre ainsi que les archivistes des AD de la Vienne et du Maine-et-Loire pour leur aide.














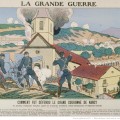

votre sujet rejoint l’intérêt que je porte à cette dramatique période et explique mon attachement à vos billets,
dans la revue HIppocampe 13 qui sera présentée le 31 juin 4 rue Marceau à 18h30 je développe un projet
d’installation dont la trajectoire croise celle des pigeons voyageurs en usage dans ce conflit!
Je vous avais fait signe lors de votre article sur le salon de l’estampe au grand palais en 2015, j’avais noté vos coordonnées e-mail que j’ai perdues depuis! La lithographie que je pratique, étant l’un de mes médiums choisis…
Bien cordialement à vous
Daniel Nadaud
Bonjour ! Ah mais j’ai déjà croisé la revue Hippocampe 13 un jour… mais où ?
J’espère être présente le 31 juin pour découvrir ce travail.
Je vais essayer de vous écrire sur le mail que vous avez laissé…
A bientôt !
Je m’étais demandé plusieurs fois comment les familles connaissaient l’adresse où écrire, c’était donc tout simplement le nom et matricule complet à indiquer manifestement ! Cela devait être sacré logistique pour tout faire suivre au bon endroit…
Cher Mealin, tu as cerné le sujet d’un billet à venir : je comptais consacrer un texte entier sur l’organisation des correspondances, c’est très intéressant. D’ailleurs, je connais quelqu’un qui va publier un livre sur ce sujet (la poste pendant la guerre)