Dans le dernier article, nous avions laissé Augustin à Etaples-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais, un 22 octobre 1914. Après les intenses combats de Champagne, le 33e régiment d’artillerie est envoyé en Belgique, où il vient renforcer les troupes engagées dans la bataille d’Ypres. C’est une nouvelle phase du conflit qui commence, celle de la guerre de position.

A l’échelle de l’histoire d’Augustin, les premières lettres conservées de façon continue datent de décembre 1914, alors qu’il est encore dans les environs d’Ypres. Il restera en Belgique jusqu’au mois d’avril 1915.
Dans ce billet, je vais vous parler de la bataille de Flandres, à laquelle Augustin a participé. Il s’agit de placer le décor avant de nous lancer dans l’exploration des lettres d’Augustin, qui évoquent moins les combats que les choses du quotidien (les nouvelles des proches, l’attente du colis, la faim, le froid).
De la course à la mer à la guerre de position.
À force de vouloir déborder l’ennemi par le côté, les armées qui s’affrontent ont fini par se heurter à la façade maritime : octobre 1914 marque la fin de la guerre de mouvement. Les Belges, dans leur retraite, ont joué une carte audacieuse et stratégique : ils ont inversé le système d’écluses qui protège habituellement les polders gagnés sur la mer. Fermées à marée basse et ouvertes à marée haute, les écluses ont laissé passer l’eau, inondant des centaines d’hectares, de Nieuport à Dixmude, maintenant ainsi les troupes ennemies à bonne distance. Au sud de ce marécage, la ligne de front se fige et les soldats commencent à s’enterrer dans les tranchées, de part et d’autre d’un no man’s land de quelques centaines de mètres.

Si les Français et leurs alliés répugnent encore à creuser des tranchées, les Allemands ont une longueur d’avance, car ils ont déjà exploré cette pratique de la guerre et ont, par conséquent, une maîtrise technique plus aboutie.
Dans les tranchées de première ligne, l’infanterie se masse. À l’arrière, à quelques centaines de mètres, prennent place les batteries d’artillerie de campagne, chargées de bombarder les lignes ennemies et leurs canons, mais dont les tirs mal réglés atteignent parfois leur propre camp.

Le 33e régiment d’artillerie dans les Flandres
Fin octobre, le 33e régiment d’artillerie de campagne est envoyé dans les Flandres pour renforcer l’armée française et alliée face aux troupes allemandes qui se concentrent sur une petite zone face à Ypres. La ville est stratégique : s’ils parviennent à s’en emparer, les Allemands s’ouvriront la voie de Calais. Alors qu’ils marchent vers leurs futures positions, les gars du 33e régiment traversent Ypres, qui sera presque entièrement détruite durant la guerre. Ils prennent position sur le saillant d’Ypres, un ensemble de collines qui protège la ville à l’ouest. Cette zone est d’autant plus stratégique qu’elle forme le point de jonction entre l’armée française et l’armée anglaise.

Sur le saillant d’Ypres, le 33e régiment d’artillerie de campagne va combattre pendant cinq longs mois. Comment narrer cette période alors qu’Augustin ne raconte rien des combats dans ses missives ? Une fois de plus, c’est d’autres sources, à savoir l’historique de son régiment et le Journal des Marches et opérations de son groupe qui m’ont permis de situer, jour après jour, la position d’Augustin sur le front.
Il serait fastidieux de transcrire intégralement les éléments livrés par le Journal des Marches et opérations aussi ne vais-je évoquer de ces cinq mois de combat que deux épisodes particulièrement éprouvants pour la troisième batterie et qui ont dû marquer Augustin dans sa chair.
Au mois de novembre, le 9e corps d’armée se trouve dans un secteur très inconfortable, légèrement en avant du reste du front, et desservi par une unique route, ce qui rend le ravitaillement compliqué et la retraite quasi impossible. Aussi, une attaque allemande est particulièrement redoutée. Le risque est d’autant plus grand qu’il s’agit du point de jonction entre l’armée française et l’armée anglaise et que l’ennemi pourrait être tenté de s’en prendre à cette zone, forcément plus faible. C’est justement ce qui se produit : pendant toute la première quinzaine du mois, les Allemands vont essayer d’enfoncer les lignes. Le 12 novembre, alors qu’une brume épaisse bouche l’horizon, les 2e et 3e batteries du 33e Régiment d’artillerie voient surgir face à eux, à environ 600 mètres en surplomb, des tirailleurs allemands. De l’infanterie française qui était censée se trouver là, plus aucune trace. Les artilleurs doivent donc défendre seuls la zone, avec un nombre d’obus réduit, puisqu’il est impossible de les ravitailler. Ils reçoivent l’ordre de tirer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de munitions. Bien que l’État-major les ait finalement autorisés à reculer, le commandant décide de maintenir ses hommes. Si l’attaque surprise est finalement endiguée grâce au renfort in extremis d’un autre groupe du régiment, la batterie d’Augustin est très éprouvée : douze hommes sont blessés et le maréchal des logis Germain Belardat meurt.

Un mois plus tard, le 14 décembre 1915, à nouveau, Augustin traverse des heures particulièrement difficiles. Les 17e et 18e divisions reçoivent l’ordre d’attaquer sur tout leur front. Dans ce cadre, la troisième batterie est chargée d’appuyer le 68e Régiment d’infanterie dans la zone de la ferme Verbeek et de la route de Menin. L’attaque, très violente, va durer plusieurs jours. Le 14, ce sont plus de mille obus explosifs que les première et troisième batteries tirent sur les lignes adverses. Quant à l’infanterie, elle parvient à gagner 80 mètres, sans pour autant atteindre les tranchées allemandes. Ce n’est que deux jours plus tard que les poilus s’emparent de la première ligne. L’artillerie continue de tirer, pour parer à toute contre-attaque. Les obus allemands ne cessent, et le 20 décembre, à 10h, la troisième batterie perd son sous-lieutenant (Maurice Fouch), tué par un tir de 150 mm. Augustin voit aussi plusieurs camarades, dont un dénommé Guillebant, recevoir de graves blessures.
C’est dans ce contexte difficile qu’Augustin fête son premier Noël de la guerre. Trois mois plus tard, lui et ses camarades sont encore en Belgique.
Le 26 mars, enfin, vient la relève. Ils bénéficieront d’un repos de six jours à Eringhem (Nord-Pas-de-Calais) durant lequel il faudra réparer vêtements et matériel, très usés par les difficiles conditions de l’hiver 1914 dans les Flandres.
« Notre corps est le seul, parait-il, qui n’a jamais eu de repos et qui est un des plus éprouvés. Ce ne serait pas de trop que l’on reprendrait un peu de force car malgré on commence à être fatigué » (lettre du 6 mars 1915)
Une guerre qui se transforme
Toute cette période, de la fin 1914 au début 1915 est très importante dans la transformation de la guerre : c’est à ce moment qu’apparaissent de nouvelles techniques. C’est par exemple le début de l’utilisation de la téléphonie, de la télégraphie et des avions pour régler les tirs des canons.

Mais dans ses lettres, Augustin ne parle pas de cela, des combats, des innovations techniques. Ce sont d’autres choses qui occupent ses missives : l’inventaire des colis échangés avec sa femme ou ses parents, les nouvelles du pays, le sort enviable de ceux qui sont restés à l’arrière, ou plus simplement, de camarades de son régiment, moins exposés que lui, comme les cuisiniers ou les conducteurs.
« (..) tandis que nous étant toujours sur les positions avec 30 cm de boue nous ne voyons que cochons et vaches dans les champs et la misère toujours, de temps en temps des morts et blessés apportés sur des brancards enfin puisque ce triste métier le veut de se tirer l’un à l’autre. Ceux qui ne sont pas malheureux non plus ce sont ceux qui sont aux sections de munitions, ce qui mènent les fourgons (…), ils ne craignent rien cela et peuvent avoir de tout. » (lettre du 15 décembre 1914)
La dureté des conditions de vie, il les évoque sans détour, racontant la boue qui les assaillit et la nourriture qui manque.
« De ce moment la température n’est pas froide sinon qu’il tombe de l’eau tous les jours mais mon caoutchouc me rend bien service. Ce qui est malheureux ce sont les pauvres gars qui ont les pieds gelés comme tu dis. » (lettre du 15 décembre 1914)
« Pour tout c’est de même, pour nos culottes, on a tous, de la batterie de tir nos culottes usées, déchirées, perdues. »
Plusieurs fois, dans ses lettres, Augustin s’inquiète de ceux du pays morts ou disparus, blessés. Dans son unité même, il constate l’ampleur des absents.
« D’après ce que vous me dites ainsi que Cécile, je vois que nous ne sommes plus guère des environs [de Curçay] au feu, malheureusement les uns tués, les autres blessés, d’autres malades, d’autres en convalescence, c’est bien de même chez nous à notre batterie, nous ne sommes plus guère de partis depuis le premier jour d’Angers et combien il y en a qui viennent 8 jours, 15 jours ou un mois, pas habitué à la misère, ils tombent malades tout de suite. Je ne comprends pas moi qui suis si sensible dans le civil qu’en guère je suis un des plus forts, espérons que ça continue jusqu’au bout » (lettre du 15 janvier 1915)
« Nous c’est la misère noire, c’est terrible de voir cela, mai[s] jusque là j’en ai vu des rudes, depuis le départ d’Angers, il n’y en a plus guère de servants avec moi. Sur 80 servants nous ne sommes plus que 18 qui sont partis d’Angers comme moi. Beaucoup ont déjà été remplacés deux fois. » (lettre du 1er janvier 1915)
Les chiffres avancés par Augustin sont-ils fiables ? Le Journal des Marches et Opération du régiment nous apprend en effet que sur les 540 hommes qui composent le premier groupe du 33e RAC, 179 sont morts, blessés, disparus ou évacués pour maladie, soit un ratio d’une perte pour trois hommes (les évacués pour maladie sont comptabilisés dans les pertes). Si on soustrait du calcul les officiers, moins touchés que les hommes de troupe, on arrive à un chiffre de 38,5% de perte. Il ne s’agit néanmoins que d’une lecture superficielle des chiffres : je ne sais pas quelle est la fiabilité des états des pertes des JMO ni la justesse de mes calculs…

Dans les prochains billets, nous évoquerons le rôle d’Augustin au sein de sa batterie et le quotidien qu’il partage avec ses camarades. J’espère profiter des derniers beaux jours de l’automne pour me rendre à Ypres, visiter le musée dédié à la bataille des Flandres et voir ce qui reste des paysages dans lesquels Augustin a combattu.





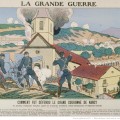

Toujours aussi captivant.
Dans un autre style mais qui peut aussi intéresser les plus jeunes « valiant hearts » d’ubisoft raconte plutôt bien la période, à mon humble avis de non-spécialiste, de la caserne au front. Bien évidemment, l’aspect ludique n’est pas au goût de tous mais c’est un support qui peut avoir ses avantages.
« Soldats inconnus – Mémoires de la grande guerre » pour le titre français. Une présentation en est faite sur le site officiel du centenaire : http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/jeu-video/reportage/autour-du-jeu-video-soldats-inconnus-le-carnet-de-1
Oui, j’avais vu ce jeu, j’aimerai bien le tester. La proposition m’avait l’air assez intéressante. Tu y as joué, tu as aimé ?
Si vous allez à Ypres, ne manquez pas de visiter le cimetière allemand de Vladslo-Praetbos avec les deux statues de Käthe Kollwitz : « la parents endeuillées » devant la tombe de leur fils Peter tué en 1915.
Jean-Marie
Boonjour,
Je connais bien la région? J’habite à 25 km des lieux que vous évoquez et il m’arrive assez souvent d’y faire du vélo.
L’été me paraît plus indiqué pour une visite car plus agréable s’agissant d’une zone rurale, parsemée de collines et de bois. Autant, les photos d’époque montrent un paysage lunaire autant le cadre d’aujourd’hui est plutôt bucolique. Sachez qu’à certains endroits, on trouve des poteaux indicateurs déposés par les services touristiques où des photos d’époque et des indications sur la position exacte des tranchées sont établies. On voit bien les lieux tels qu’ils sont aujourd’hui et tels qu’ils étaient à l’époque…Certains trous d’obus devenus des étangs y sont aussi signalés de cette façon.A l’époque des labours, à certains endroits, il ne faut pas chercher longtemps pour y trouver des ossements. Cela m’est encore arrivé cette année. Autre anecdote, l’année dernière, lors d’une randonnée à proximité de Hill 62, j’ai eu la surprise de voir sur le bord de la route, un obus plein de terre qu’un agriculteur avait déposé. Les services de déminage ont mis 15 jours pour le récupérer ! Il faut dire que 100 ans après, c’est 250 tonnes de munitions que l’on récupère chaque année.
Chère camarade du 33e RA
(nous avons échangé sur le forum 14- 18 )
mon grand père (dcd avant ma naissance )était dans ce régiment , 14e SMA (section de munitions) ,
Je constate ,comme Augustin le précise et comme ma mère me l’a raconté ,qu’il était relativement protégé par rapport aux ‘copains’
mais tout ce qu’il voyait était aussi ‘bien de la misère ‘
Merci beaucoup pour toutes ces recherches précises , c’est extrêmement intéressant .
J’ai peu d’archives : quelques cartes de mon grand père ,dont une des halles d’ Ypres (non bombardées) ,du 07/01/1915,
adressée à ma grand mère sa fiancée
Rapport à tout ce que ce régiment a subi ,je comprends mieux cette phrase très percutante qu’il lui écrit ,je cite :
» vivement que sa finisse , je nai pourtant jamais desiré de mal à perssonne mes je voudrais bien antande parlée que le père Guillaume serai crevé avec tous ces boches et je croie qu’il y an a beaucoup de mon avie »
(ma grand mère avait perdu un frère en septembre 1914)
Cordialement
Bonjour,
Merci pour ce merveilleux récit que j’ai particulièrement apprécié.
Un de mes grand-pères (classe 1906) a aussi été mobilisé au 33e RAC de 1914 à 1919.