C’est un peu bête, mais il m’a fallu lire plusieurs ouvrages sur la Première Guerre mondiale pour que je prenne conscience d’une chose pourtant essentielle : alors que je l’avais imaginé dans la boue des tranchées, Augustin Garnault n’avait sans doute jamais vécu l’expérience des première lignes. Il était artilleur et non fantassin. Son horizon quotidien n’était donc pas celui des tranchées, mais un autre environnement, avec ses spécificités.
L’enseignement de la guerre, le devoir mémoriel est tant centré sur les tranchées et les souffrances qu’elles ont provoquées que l’on en vient à réduire dans notre imaginaire la guerre aux tranchées de la première ligne du front, occupée par l’Infanterie, oubliant que bien des mobilisés n’y avaient jamais mis les pieds. Si bien que j’y plaçais tout naturellement mon ancêtre, renforcée dans cette vision par l’idée (peut-être fausse, j’en rediscuterai dans un autre billet) qu’il était mort dans l’éboulement d’une tranchée. Or, Augustin, je l’ai dit, était maître-pointeur dans l’artillerie.

C’est en lisant l’ouvrage de Cazal et Loez, 14-18. Vivre et mourir dans les tranchées et plus encore celui de François Cochet Survivre au front, 1914-1918, que j’ai véritablement pris conscience de ce que cela signifiait qu’Augustin ne soit pas dans une tranchée mais derrière un canon.
« L’expérience du bombardement est terrible pour le corps et l’esprit. (…) À la peur de la mort s’ajoute celle d’être déchiqueté. On éprouve une sensation d’impuissance : il est impossible pour l’infanterie de se défendre contre l’artillerie. » (Cazal et Loez, p. 71)
« Très tôt les fantassins ont compris les différences existant entre infanterie et artillerie (…) [et constatent] les pertes relativement faibles de l’artillerie par rapport à celles de l’infanterie. (…) Un duel d’artillerie, c’est souvent l’artillerie française qui tire sur les fantassins allemands, et l’artillerie allemande qui tire sur les fantassins français. » (Cazal et Loez, p. 179)
Comme l’écrit François Cochet, un « fossé sépare ceux qui tirent de ceux qui subissent les tirs. » Non seulement Augustin n’était pas dans la tranchée, mais il était de ceux qui, quelque part, rendaient la vie impossible aux biffins.
« Le bombardement par l’artillerie adverse devient une dimension quasi quotidienne de la guerre de tranchées. Les pertes sont rarement énormes, mais s’accumulent d’un jour sur l’autre, rendant ainsi quasi inéluctable – au sens statistique – la disparition du soldat. Les unités d’infanterie sont érodées continuellement par ces duels d’artillerie. » (p. 82, Cochet).
« Le fantassin n’a d’autre mérite qu’à se faire écraser ; il meurt sans gloire, sans un élan du cœur, au fond d’un trou, et loin de tout témoin. S’il monte à l’assaut, il n’a d’autre rôle que d’être le porte-fanion qui marque la zone de supériorité de l’artillerie ; toute sa gloire se réduit à reconnaître et à affirmer le mérite des canonniers. » (Joubert, cité par Cochet)

Dès lors, puisque mon image mentale s’effondrait, il a fallu que je comprenne ce que c’était, précisément que l’artillerie. Et qu’est-ce que, exactement, la fonction d’Augustin, maître-pointeur, recouvrait ? Fort heureusement, ma prise de conscience – et mes interrogations nouvelles – ont coïncidé avec l’ouverture d’une exposition consacrée à l’artillerie au Musée de la Grande Guerre à Meaux ! La visite de celle-ci et la lecture du catalogue m’ont permis de comprendre beaucoup de choses et de jeter un nouveau regard aux archives familiales.
L’artillerie, arme reine de la Première Guerre mondiale
Dans les tranchées, les hommes que l’on trouve sont des fantassins : ils appartiennent à l’infanterie qui va à pied et dont l’arme principale est le fusil. Augustin, lui, est dans l’artillerie, dont les régiments sont équipés de canons. Ils se trouvent déployés en arrière des tranchées, à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres de la ligne de feu.
Pendant la Première Guerre mondiale, l’artillerie va prendre une importance nouvelle, ce dont témoigne l’augmentation sans précédent du nombre de canons et de la quantité d’hommes qui servent cette arme. On estime que si en 1914, les effectifs mobilisés servant dans l’artillerie française étaient de 12%, ils atteindront 22% à la fin de la guerre, soit plus d’un million d’hommes.
Entre temps, l’arme elle-même aura beaucoup évolué, avec la mise au point de nombreuses innovations.

Le rôle stratégique de l’artillerie, également, ne sera plus le même : en 1914, l’artillerie est encore une arme auxiliaire, qui doit simplement appuyer l’assaut de l’infanterie. En 1916, son rôle est beaucoup plus important : c’est elle qui attaque par pilonnage de l’ennemi. Les canons employés, enfin, se sont diversifiés : la gamme va du crapouillot, petit mortier tirant à quelques dizaines de mètres, employé dans les tranchées, jusqu’à l’artillerie lourde, qui peut viser à des dizaines de kilomètres.

Autour du canon de 75
Augustin, lui, est servant d’un canon de 75, l’arme emblématique et chérie de l’armée française, qui équipe les régiments d’artillerie de campagne. C’est un canon léger, conçu en 1897, qui permet d’envoyer des obus d’un diamètre de 75 millimètres, d’où son nom. S’il est la fierté de l’armée française, c’est qu’il intègre des innovations : grâce à son frein de recul hydropneumatique, il garde ses réglages et il n’est plus nécessaire de le réajuster entre deux tirs. D’autre part, on le charge par l’arrière, ce qui rend les manipulations plus rapides. Par conséquent, il offre une meilleure cadence que les autres canons, à savoir 6 coups par minutes. Léger et précis, il s’adapte à différents types de situations : bref, c’est le canon idéal pour une guerre de mouvement comme celle vécue en 1870 et à laquelle on imagine encore que la campagne de 1914 ressemblera.
Les Français sont très fiers de cette arme, que l’on juge supérieure au 77 dont les Allemands sont alors équipés. Mais la réalité de la guerre de position va dépasser ces armes légères et rapidement, le besoin de canons à longue portée, plus lourds, va se faire sentir. Or, sur ce terrain, les Allemands sont mieux équipés.

Le canon de 75 équipe les régiments d’artillerie de campagne (artillerie légère que l’on distingue des régiments d’artillerie lourde). Un régiment d’artillerie de campagne regroupe environ 1550 hommes et s’organise ainsi : il est subdivisé en batteries, elles mêmes subdivisées en pièces. Trois batteries réunies forment un groupe. Augustin, lui, appartient à la 4e pièce de la 3e batterie du premier groupe.
Une batterie, c’est donc : 171 hommes, 4 canons et 215 chevaux (essentiellement utilisés pour tracter le matériel).
Le régiment d’artillerie de campagne (RAC) est associé à un régiment d’infanterie (RI) au sein d’une division et d’un corps d’armée : le 33e RAC ainsi, va être chargé de seconder les 77e et 135e régiments au sein de la 18e division.
Mais l’horizon d’un artilleur comme Augustin, c’est sa pièce, c’est-à-dire le petit groupe de 7 ou 8 hommes rassemblés autour d’un canon.
Les camarades de ma pièce
» Car nous sommes 8 par pièce. Nous avons le Maréchal des Logis, le brigadier, moi comme pointeur, ce qui me donne beaucoup plus de travail qu’avant aussi, car il y a toujours quelque chose à nettoyer dans les parties du canon mais ça me plait de faire ce poste car mon qui suis vif je ne suis pas long à envoyer des obus aux Boches, j’ai vite tourné tous mes volants et ce qui me plait c’est que mon équipe qui est avec moi on s’entend bien ils ne sont pas mous eux non plus. Pour revenir, il y a à ma pièce le tireur, le chargeur, le déboucheur et les approvisionneurs d’obus, ce qui fait donc 8 hommes à chaque pièce. » (lettre d’Augustin à ses parents, 2 février 1915)
Chacun de ces hommes à un rôle bien spécifique. Les deux pourvoyeurs (qu’Augustin appelle les approvisionneurs) sont chargés de sortir les obus du caisson de transport. Ils les transmettent au déboucheur, qui règle l’obus afin qu’il explose à une distance précise. L’un des pourvoyeurs amène ensuite l’obus au chargeur, qui l’insère dans la culasse du canon. Leur travail est très éprouvant car il leur faut manipuler des centaines d’obus, chacun pesant entre 5 et 7 kilos.
Une fois l’obus dans le canon, le tireur ferme la culasse et actionne le tire-feu pour que le coup parte.
Le pointeur, lui, intervient pour régler le canon avant le premier coup et veille ensuite à ce qu’il reste bien pointé sur l’objectif. D’après le témoignage d’Augustin, il est également chargé de nettoyer les pièces du canon. À plusieurs reprises, dans ses lettres, il évoquera le démontage et le remontage de celui-ci.

L’opération de tir est dirigée par le chef de pièce, qui donne les instructions et assure la liaison avec le reste du groupe.

Par rapport aux autres corps d’armes, l’artillerie se distingue par un brassage social important. En effet, elle mêle volontiers des hommes issus des campagnes, bourriers, maréchaux-ferrants, charrons, aptes à s’occuper des chevaux et du matériel roulant, et une population urbaine d’ouvriers et d’artisans, assez instruite et habile pour maîtriser le canon, au maniement relativement exigeant. Les officiers, eux, sont issus des grandes écoles et souvent ingénieurs, car il faut bien cela pour comprendre et utiliser l’arme.
Augustin, cultivateur mais fils de maréchal ferrant, aurait préféré s’occuper des chevaux, mais son niveau d’instruction (il a été jusqu’au collège) le conduit au poste de maître-pointeur.
Tuer sans voir
Contrairement aux poilus des tranchés de premières lignes, qui aperçoivent au loin celles de leurs ennemis, et qui, lors des attaques, ont un contact, les artilleurs, eux, sont relativement loin de leur cible (c’est encore plus vrai pour l’artillerie lourde que pour la légère). Ainsi, Augustin et ses camarades tirent sur une cible qu’ils ne voient pas, et, quand les obus pleuvent sur eux, ne savent même pas d’où ils viennent. La mort est aveugle.
L’artillerie est à l’origine de la majorité des pertes du conflit : l’obus tue beaucoup plus que la cartouche du fusil.
Tout au long du conflit, l’industrie de l’armement s’est ingéniée à perfectionner les obus, afin d’assurer toujours plus de dégâts. Ainsi, l’éclatement des obus est optimisé pour produire une multitude de fragments, qui, avec le souffle de l’exposition, se fichent dans les corps, et, quand ils ne tuent pas, provoquent de terribles blessures. Or, un soldat blessé coûte plus cher à l’ennemi qu’un mort.

Dans le même but, l’armée utilise majoritairement des obus à balles, chargés de centaines de billets de plomb. Lorsque l’obus explose en l’air, les billes sont projetées à très forte vitesse à plusieurs dizaines de mètres à la ronde.

À mesure que le conflit s’éternisera, de nouveaux types de munitions apparaîtront sur le terrain, comme les obus incendiaires ou les obus à gaz. De ces derniers, nous reparlerons dans un prochain article.
Si Augustin insiste souvent dans ses lettres sur sa rapidité à « envoyer des obus aux Boches », ces derniers tombent parfois sur les lignes françaises. Car l’artillerie tue aussi dans son propre camp, faute à un tir mal réglé par exemple. C’est ce que raconte le Louis Barthas dans son carnet de guerre :
« Pour comble, une batterie de nos 75, tirant trop court, envoyait ses obus sur notre première ligne; signaux, fusées, coup de téléphone, rien n’y faisait. C’était navrant comme du reste à plusieurs reprises depuis notre arrivée à ce secteur ; notre artillerie ne pouvait réussir à régler son tir et nous faisait presque quotidiennement des victimes. »
Remy Cazals et André Loez, dans leur ouvrage, citent ce chiffre de 75 000 fantassins français tués par l’artillerie amie.
Le canon est une menace pour ceux qui le servent
Si le canon tue et blesse ceux qui sont dans son champ de tir, il est également parfois mortel pour ceux mêmes qui le servent. Il brûle les mains, défonce les oreilles et, parfois, explose…
Pour répondre à une demande pressante d’obus et de canons, l’industrie de l’armement a augmenté les cadences mais s’est aussi montrée moins regardante sur la qualité des matériaux employés. Par conséquent, certains obus portent des vices de fabrications et il arrive qu’ils explosent dans le fût du canon, tuant les servants. Un accident redouté des artilleurs et relativement fréquent… Les Journaux de Marches et Opérations du 33e régiment en relatent d’ailleurs plusieurs…
Et puis, il y a la menace des canons ennemis, qui, quand ils parviennent à repérer la position d’une batterie, règlent leurs tirs pour la pilonner. Une situation qu’Augustin a plus d’une fois vécue.
» Je suis à l’Infirmerie depuis hier, je n’avais jamais vu ma mort de si près, heureusement que nous avions de bons gourbis. Nous avons été repérés de sorte que les obus Boches tombaient sur notre batterie en plein, chaque coup de canon tout volait en l’air, les bois, la terre, un a tombé sur mon caisson l’a mis en morceau, c’était de vraies rafales et avec des obus de gros calibres. Un tombe a l’entrée de mon gourbi, démoli l’entrée me projet un sac à terre plein que l’on sert pour faire nos gourbis en plein contre la tête, tu parles d’une secousse, j’ai la tête toute meurtrie, ce qui nous inquiétait le plus, nous étions deux dans le gourbi, l’autre n’a rien attrapé mais nous étions, surtout moi, moitié engloutit de terre, la terre bouchait presque le passage, on se disait bientôt adieu, il en serait revenu un autre nous étions enterrés tout vivant, étouffés sans rien pouvoir nous faire. une veine que nous avons pu nous en tirer, je n’avais encore jamais vu chose pareille depuis le début. » (lettre d’Augustin à Cécile, datée du 23 septembre 1915)

Si l’infanterie enregistre pendant la guerre un taux de pertes de 22%, l’artillerie perd seulement 6% de ses hommes. Mais ce chiffre englobe toute l’arme, c’est à dire également les régiments de l’artillerie lourde ; or, les servants des canons de 75 sont les plus exposés, car leurs positions sont très proches de la ligne de feu. Le taux de décès y est donc plus élevé que la moyenne.
Augustin sera de ces servants du 75 qui ne reviendront pas, comme d’autres de ses camarades de pièce.
Au terme de mes recherches et de la visite de l’exposition du Musée de la Grande Guerre, l’environnement dans lequel Augustin a évolué m’apparaît beaucoup plus clairement… Reste encore une centaine de lettres à explorer ensemble.
Pour aller plus loin…
A voir, l’exposition du Musée de la Grande Guerre « Un milliard d’obus, des millions d’hommes », jusqu’au 5 décembre 2016.

Merci à Anaïs R. pour sa relecture et ses compléments, ainsi qu’à Jean-Michel.









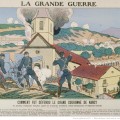
merci pour ce billet!
il faudra donc que je révise ma propre « carte mentale » par rapport à mes deux ancêtres, celui qui a son nom sur le monument au mort et celui qui est revenu vivant… parce qu’en effet, je les voyais aussi dans la boue des tranchées…
« Dis l’as-tu vu Guy au galop? » http://dormirajamais.org/saisons/
Merci pour ces articles si intéressants !
Déjà les armes à sous-munitions…
Ping : Première Guerre Mondiale ( 1914-1918) | Pearltrees
Ping : Les soldats pendant la première guerre mondiale | Pearltrees