Depuis quelque temps, je m’adonne à un loisir créatif, la linogravure. Quand je dis quelque temps, à vrai dire, cela fait maintenant presque deux ans, mais comme je pratique de manière irrégulière, cependant intense, il me semble toujours que cela fait « peu de temps ». D’ailleurs, si je compte bien, je n’ai réalisé que six ou sept planches gravées en tout.

Comme à chaque fois que je poste sur les réseaux sociaux une photographie d’une lino en cours cela déclenche une avalanche de likes et de questions en tous genres (C’est quoi ? Comment on fait ? Y’a des cours ?), j’ai décidé d’en faire un billet.

La lino, une technique de gravure accessible à tous !
La linogravure est une des techniques de l’estampe, elle est dérivée de la gravure sur bois. Au lieu de graver une planche de bois de fil, il s’agit de travailler une matière synthétique, le linoléum. Oui, le même linoléum que celui qui sert de revêtement de sol !
Par rapport au bois, ce matériau est plus facile à graver, car plus tendre et dépourvu de fibres. On y gagne une plus grande liberté de formes ! De plus, à l’impression, les zones encrées sont plus intenses car la surface, plus régulière, accroche mieux.

Par rapport à d’autres techniques de l’estampe (eau-forte, lithographie), la pratique de la linogravure n’exige pas beaucoup de matériel : un morceau de lino, quelques outils, de l’encre et du papier. Même pas besoin de presse ! Les estampes s’impriment sans peine à la main. Bref, c’est assurément la technique idéale pour qui veut s’essayer à la gravure depuis son salon.

Pour ma part, l’élément déclencheur a été de découvrir l’existence d’un kit pour débutant (40 euros, régulièrement soldé) chez Rougier et Plé. Ce kit se compose de quelques morceaux de lino, d’une gouge avec cinq lames interchangeables (dont une « sécurité », spéciale enfant ou débutant), d’un tube d’encre noire, d’un rouleau et d’un baren en plastique pour imprimer.

Cela laisse toute la liberté d’expérimenter à petit prix avant d’investir progressivement, si le besoin s’en fait ressentir, dans un matériel plus haut de gamme.
J’ai débuté avec des motifs simples, emprunté à la Belette print, un blog de référence en matière de lino : une chouette et un chat, qui m’ont servi d’étiquettes pour mes cadeaux de Noël 2014. L’hiver suivant, je m’attaquai carrément à la réalisation de mon propre papier cadeau, en m’inspirant des papiers dominotés anciens. J’avais entre temps acheté un kit d’encres colorées.
Comment ça marche, la linogravure ?
Il est temps de dire un mot sur la façon dont on grave et les étapes de réalisation d’une estampe. La linogravure appartient à la famille de la gravure en relief ou taille d’épargne, comme la gravure sur bois (xylographie) dont elle découle.
On parle de taille d’épargne parce que l’on épargne le motif que l’on veut imprimer. Comme sur un tampon, les motifs sont en relief tandis que ce qui doit rester blanc est creusé. Évidemment, cela demande aux graveurs toute une gymnastique de l’esprit pour ne pas se tromper lors de la réalisation. À cela s’ajoute une seconde gymnastique, plus complexe encore : il faut penser le motif à l’envers car l’impression est en miroir de la matrice (encore une fois, comme pour un tampon). D’ailleurs, certains graveurs s’aident d’un miroir lorsqu’ils gravent. Moi, j’imprime depuis l’ordinateur mon modèle deux fois, une fois dans le bon sens et une fois inversé, afin de me guider au mieux dans mon travail.
Traditionnellement, on utilise pour la gravure en relief une planche de bois. À la fin du XIXe siècle est apparu un nouveau matériau, plus souple, plus tendre et plus économique : le linoléum. Il présente également l’avantage d’être plus facile à imprimer et donne de beaux noirs intenses. Divers artistes du XXe siècle ont exploré ce matériau, mais c’est Picasso qui lui a donné ses lettres de noblesse, à travers une production pléthorique qui explore largement les problématiques de l’impression en couleurs.

Comment s’y prend-on ? Il faut d’abord choisir un motif. Personnellement, je grave uniquement d’après des photographies car je ne sais pas dessiner. Pour l’une de mes toutes premières gravures, j’avais travaillé d’après un tableau du Musée des Beaux-Arts de Rouen, La Baigneuse antique d’Amaury-Duval, qui était reproduit dans le programme du dit musée. Comme l’image était assez linéaire et contrastée, j’avais décalqué les traits principaux avant de les reporter sur le linoléum. Il n’y a pas de honte à avoir à décalquer, d’autant que cela ne sert qu’à placer la composition : c’est ensuite tout le travail de gravure et d’interprétation qui va conditionner le résultat, souvent très éloigné du modèle, d’ailleurs ! Ainsi, la baigneuse d’Amaury-Duval à la facture très léchée et dessinée s’est transformée en baigneuse japonisante dans mon estampe.
Pour ma gravure de la salle Labrouste, j’ai procédé un peu différemment : je travaillais d’après une photographie dont j’étais l’auteur. Sur un logiciel de retouche photo, j’ai travaillé les contrastes pour obtenir une image en noir et blanc. J’ai imprimé le résultat deux fois (dans le bon sens et inversé), puis j’ai décalqué les lignes et les masses.

On grave à l’aide de gouges à lame très coupantes. Les formes de lames les plus courantes sont le U et le V. Il en existe de toutes tailles : les plus fines (0,5 mm) gravent de fins sillons tandis que les plus larges permettent d’évider de grandes surfaces. Quand on achète un kit débutant, on ne dispose que de quelques lames et d’un seul manche. Si c’est assez satisfaisant pour se lancer, il devient rapidement fastidieux d’interchanger sans cesse les lames. Aussi ai-je finalement aspiré à posséder des gouges « pro », même si mes lames interchangeables me servent toujours. Mon choix s’est porté sur la gamme Pfiler, des outils de fabrication suisse ou allemande, de bonne qualité et agréables à prendre en main. Mais cela a un prix : compter 20 euros par gouge ! Autant dire qu’il va me falloir un bon nombre de Noëls et d’anniversaires pour posséder un set complet.

Lorsqu’on grave, il ne faut pas perdre à l’esprit que l’on doit creuser ce qui sera blanc et épargner les parties à imprimer. J’évide donc les zones vierges en prenant garde à ne pas mettre de coup de gouge dans les traits que j’ai tracés au feutre noir. J’utilise pour l’essentiel ma gouge en u : si je ne l’enfonce pas trop fort, j’obtiens des détails assez fins. Pour les angles aigus ou les fines stries, j’utilise une gouge en V très fine. Elle ne peut servir que pour les détails et les finitions, tant il est fastidieux de graver avec celle-ci. Pour évider les larges plages blanches, en revanche, j’utilise une gouge large.

L’art de synthétiser
Tout l’intérêt de la linogravure réside dans cette étape de gravure, car il faut faire des choix : comme on ne peut pas garder tous les détails, il faut faire des sacrifices, ne conserver que l’essence afin que la scène soit lisible tout en restant identifiable et cohérente. C’est ce qu’on appelle « traduire » au sens d’interpréter quelque chose dans un nouveau médium. Selon mes projets, je traduis d’après un tableau ou une photographie dans le langage spécifique de la linogravure. Ainsi, quand j’ai commencer à graver la vue de la salle Labrouste, j’ai vite admis que je ne pourrais pas représenter les élégants ornements des frises des coupoles : je les ai donc remplacés par un simple trait de gouge. De même, graver toutes les tables de la salle était trop fastidieux, aussi, pour plus de lisibilité, j’en ai sacrifié quelques-unes. Mais le travail n’est pas terminé et je bloque sur la meilleure façon de rendre le fond de la salle…

Si l’on doit synthétiser la scène (c’est là le secret d’une lino réussie), il faut aussi savoir conserver un peu de fantaisie et s’appliquer à laisser des détails plus élaborés afin de conférer une élégance à l’ensemble. Cet équilibre, c’est ce que j’admire tout particulièrement chez le xylographe Vallotton.

Quand on débute, il est difficile de faire ces choix, de savoir quoi retenir, quoi sacrifier, comment rendre telle ou telle matière. Aussi faut-il passer du temps à regarder les travaux d’autres linograveurs, afin de comprendre la façon dont ils s’y prennent. Outre Vallotton (qui travaillait en fait le bois), je regarde beaucoup les travaux de Joëlle Jolivet, qui est graveuse et illustratrice. Elle a notamment réalisé un livre sur Paris, dont je suis tombée complètement amoureuse. De surcroît, la thématique de son ouvrage correspond tout à fait aux scènes que je grave en ce moment, aussi je passe beaucoup de temps à observer comment elle rend une fenêtre, les passants, avant de me lancer dans la traduction de mes propres motifs.
La magie de l’impression
Une fois la planche gravée, on procède à l’impression. Dans le kit débutant, il est fourni un tube d’encre noire. On se procure assez facilement des pack d’encres colorées, ce qui permet de varier les plaisirs. Ensuite, à vous les mélanges !
À l’aide d’un rouleau dur, il faut encrer la plaque, puis poser dessus une feuille de papier. Avec un baren, un couvercle de confiture, une cuillère en bois, ou tout simplement la main, on frotte le dos de la feuille en s’assurant de ne pas la faire bouger. L’encre se dépose sur le papier… Et voici une estampe ! Dans les ateliers et chez certains particuliers chanceux, on trouve des presses à épreuves typographiques, qui facilitent grandement la tâche et donnent de superbes résultats (ps : j’en cherche une !).
Bien sûr, pour prendre connaissance du rendu de son travail, il est possible de faire des tirages au fur et à mesure de la gravure, on appelle ça des tirages d’état. Cela permet de retoucher ce qui ne va pas, d’ajouter des détails…
Pour être tout à fait honnête, plus que le résultat final, c’est le travail en cours que je préfère, les différentes étapes de la gravure : reporter le dessin sur la plaque, tracer au feutre les grandes lignes, creuser la matière avec la gouge, se laisser surprendre par les premiers tirages. Bref, voir une image naître.

Envie d’essayer ?
J’espère qu’à ce stade de la lecture, vous avez tous envie d’essayer ! Le kit de linogravure du fabricant Essdee se trouve assez aisément chez Rougier et Plé et au Géant des Beaux-Arts
Une fois muni de votre matériel, vous allez vous poser tout un tas de questions très pratiques, du type « et comment je tiens ma gouge ? », « et comment je fais pour les petits angles », « et quel papier je choisis? » … soit tout un tas de questions auquel je n’ai pas encore de vraies réponses puisque j’en suis encore au stade de l’expérimentation autodidacte. En revanche, la graveuse TANXXX a édité un chouette livret dans lequel elle partage tous ses secrets et savoir-faire. Cut or Die ! petit imprécis de linogravure est gratuit et se trouve ici.
Et pour finir (et vous féliciter de m’avoir lue jusqu’au bout !)… un cadeau. Le premier qui trouve la source d’inspiration de la linogravure qui suit en recevra un exemplaire par la poste ! Indice : ça vient d’un monument parisien !





















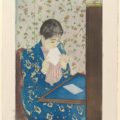
http://www.carnavalet.paris.fr/fr/collections/mascaron-du-pont-neuf Mascaron du pont-neuf ?
Super intéressant à lire 🙂 et surtout ça donne très envie de t’imiter et de se plonger dedans même si je ne suis pas sûr d’en avoir le talent et la patience !
Cela me donne envie d’essayer avec mes dessins !
Cela ressemble aux masques sculptés sur le pont neuf 🙂
J’ai répondu sur Twitter mais : le Pont-Neuf!
La gravure de la salle Labrouste est superbe ! Il faut être patient mais le résultat est très réussi !
De très belles réalisations !
Bonjour, Il s’agit d’un des mascarons du Pont Neuf !
Il s’agit bien sûr d’un mascaron du Pont Neuf :
http://www.pbase.com/image/84077831
Et surtout bon courage dans l’apprentissage et la pratique du très noble art de l’estampe !
Super chouette cet article ! Merci pour ces conseils qui donnent envie de se lancer (notamment pour du papier avec Noël qui approche). J’avais vu passer sur twitter la salle Labrouste et j’avais été époustouflée. Idem pour ce que je pense être un des mascarons du pont Neuf avec une belle grimace.
Très envie, j’ai une copine qui m’a prêté son kit, merci pour le tuto! (mon fils s’est déjà fait mal…)
j »ai trouvé le « Mascaron » : il ressemble beaucoup à un des 381 du Pont neuf ! > https://www.flickr.com/photos/fotofacade/411609190/in/set-72157600025600220 (http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/un-mascaron-du-pont-neuf-repeche-dans-la-seine-597292.html)
voir aussi celui du Tampographe Sardon http://le-tampographe-sardon.blogspot.fr/2015/10/ville-musee.html
Souvenirs de maternelle ……………………….
Bravo, c’est superbe !
Ce n’est pas un matériau facile à travailler, il ne faut pas déraper ou enlever le mauvais morceau !
J’ai fait ça avec mes élèves autrefois…
Bonne continuation
Je ne connaissais pas la linogravure (y)
belles réalisations, vous êtes douée ! Je m’y suis mis aussi il y’a quelques temps : https://bibliomab.wordpress.com/2015/02/20/la-linogravure-gravure-du-pauvre/
Léo
vous pouvez trouver pour moins de 50 euros une petite presse Freinet sur le Bon Coin ou autre site de ventes d’occasions , c’est très facile à utliser sur de petits formats , sinon une presse à épreuves c’est rare et cher!
Le Pont-Neuf ! Très chouette ! Merci pour les références des bouquins.
Moi je sais ! C’est un des modillons du Pont Neuf
Bonjour,
Déjà une belle maîtrise pour un début. Dîtes-moi faites-vous des travaux à la commande ? Donnez moi la réponse par mail. D’avance merci.
Oh merci pour cet article ça me donnait envie depuis un moment mais là je sais que je vais franchir le pas! Pour la dernière question, votre linogravure me fait penser à un mascaron du Pont Neuf, elle ressemble à une divinité comme Pan!
Merci pour cet article : je crois que j’ai trouvé le cadeau de Noël pour ma mère. Il n’y a pas de cours dans sa cambrousse, mais si elle peut faire ça dans la salle à manger, elle va s’amuser comme une folle !
Ping : L'art qui apaise - Pour une image
Article très sympa, j »ai longtemps gravé sur du bois, et j’ai acheté ma premiere plaque de lino aujourd’hui. J’ai passé toute la soirée à travailler dessus, pour ensuite me rendre compte que je devais en effet inverser le dessin.
Dans la mesure ou c’est de l’écriture, cest assez dommage
Bon article en tout cas !
Ping : Jeanne Picq, graveuse espiègle - Craftsdigger
Moi qui arrive ici par hasard, me voici avec l’envie folle d’essayer!!!… En vérité au départ, je cherchais une solution pratique et peu chère de me fabriquer des tampons, afin de marquer les vêtements que je couds ( souvent les enfants- et même les grands- supportent mal les petites étiquettes où qu’elles soient cousues).
Je me retrouve sur votre blog et j’ai littéralement été « prise » par le sujet… Merci de ce partage!….
Ping : Linogravure | Pearltrees
Merci pour ce superbe article, je me suis essayée à la linogravure aujourd’hui, je suis un peu déçue du résultat, cet article va surement mieux m’éclairer 🙂
Ping : Beaux Arts (penses bêtes) | Pearltrees
Bonjour ! Merci beaucoup pour toutes ces explications très intéressantes et surtout très complètes :)… J’ai une toute petite question cependant avant de me lancer à mon tour : Comment transférer le dessin du calque sur la plaque de lino en conservant tous les détails des traits ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonne soirée,
Excellente question ! Depuis que j’ai écrit ce billet, j’ai trouvé l’astuce : j’utilise du papier carbone ! C’est magique !
Bonjour. J’utilise du papier carbone SARAL. Papier de transfert sans cire (donc non gras et ne laissant pas de trace). Ce papier existe en différentes couleurs (cinq) et est fourni en rouleau de 3,66 mètres sur 305 mm.
Petite information complémentaire, j’imprime mes dessins à graver sur du papier calque ce qui me permet de facilement le transférer à l’envers sur mon lino.
Bonne journée et bon travail.
excellente initiation…. j’ai commencé par graver du bois à l’âge de 12 ans et le lino est une bonne approche de la xylographie..A bientôt 80 ans, je m’amuse encore à tailler cette matière et souvent après un report du dessin par technique photographique.
jacques collet
Excellent article qui m’a donné envie de me lancer aux dernières vacances. J’ai fini par me procurer tout ce qu’il faut et je deviens accro 🙂 Merci !
Une question cependant, une hérésie peut-être : il me reste un tas de gouache de mes cours d’art P… est-il possible de les utiliser pour mes impressions ? Je n’ose pas essayer !
Bonjour, merci de toutes vos explications c’est superbe je m’y suis essayé il n’y a pas longtemps mais je crois ne pas avoir trouvé le papier adapté. Lequel utilisez-vous svp ? Merci