En février dernier, je publiais un billet sur une matrice conservée au musée d’Abbeville, qu’en vue d’une conférence, il avait fallu documenter et identifier. Avec la conservatrice de l’établissement, Agathe Jagerschmidt, nous l’avions sans trop de difficultés identifiée comme une estampe du XIXe siècle réalisée par le graveur Émile Rousseau d’après un modèle du XVIIe siècle, probablement dans le cadre de sa préparation au Prix de Rome, vers 1850-1852. Vous pensiez l’enquête terminée ? Moi aussi… mais il y a eu quelques rebondissements ! Et pas des moindres.

Entre le jour où Agathe Jagerschmidt m’a montré la matrice et le moment où nous avons pu, conjointement, trouver le nom du graveur, Émile Rousseau, il s’est écoulé quelques jours.
Nous avions prévu que je revienne, début octobre, afin de consulter la documentation sur Rousseau et de feuilleter ses autres oeuvres, gravées ou dessinées, que le musée conserve. Mais faute de train entre Paris et Amiens le jour prévu, mon voyage était tombé à l’eau. J’avais donc concentré mes recherches sur d’autres problématiques : l’identification du sujet gravé, la pratique du burin au XIXe siècle…
Le jour de ma conférence, je suis arrivée six heures en avance afin de boucler in extremis mon texte et rechercher dans les réserves d’autres oeuvres de Rousseau… Et j’en ai fait, des découvertes !
Une gravure peut en cacher une autre…
Le premier rebondissement a eu lieu avant même que j’arrive en gare d’Abbeville. Je profitais du voyage en train pour mettre en forme mon PowerPoint, et, en intégrant mes photographies dans le fichier, un détail m’intrigue…
N’y aurait-il pas toute une partie du sujet gravé sur la matrice qui m’a échappé ?
À partir du moment où j’ai obtenu une photographie du tirage, je n’ai plus beaucoup regardé ma matrice, et mon regard s’est uniquement concentré sur l’homme nu de dos, le lion, les trois mulots… Si bien que je n’ai pas remarqué qu’elle était gravée en haut à droite d’un autre motif… autre motif qui n’apparaissait pas sur mon tirage.

Erreur grossière, erreur de personne trop pressée : je me suis lancée tête baissée sur ce que je voyais, oubliant une règle d’or de l’histoire de l’art : observer, scruter, minutieusement, rigoureusement, et, surtout, chercher ce qu’on ne voit pas.
À ma décharge, même si cela ne m’excuse pas totalement, la partie gravée qui m’avait échappé était masquée par un reflet sur ma photographie de la matrice. Même en zoomant, impossible de lire le sujet : une chose est sûre, cependant, cela ne correspond aucunement au modèle d’Edelinck.
Comment se fait-il que le tirage dont je dispose ne porte pas la trace de cette partie gravée ? De prime abord, je pense à un tirage d’état, ces épreuves que les graveurs tirent en cours de travail pour juger de l’avancée de la pièce avant de poursuivre la gravure. S’il s’agit bien d’un tirage d’état, peut-être vais-je trouver dans les réserves du musée d’autres épreuves, témoignant des états postérieurs de la planche.
À peine arrivée à Abbeville, je réexamine ma matrice et son tirage. Sur la planche de cuivre, le motif m’apparaît plus clairement : les jambes d’une femme, coupée à mi-corps et des angelots. Vraiment, cela n’a rien à voir avec la thèse de Colbert de Croissy qui a servi de modèle à Rousseau : la source de ce nouveau motif doit venir d’ailleurs. Tout cela renforce mon hypothèse suivant laquelle je suis devant une planche d’étude.
Je réexamine également le tirage, et c’est une autre surprise qui m’attend : à l’emplacement de la mystérieuse figure non identifiée, il n’y a pas « rien ». Certes, le papier ne porte pas de motif encré, mais en approchant mon oeil, je perçois de délicats reliefs, une gaufrure à peine perceptible : cela veut dire que mon tirage n’est pas un tirage d’état, comme je l’avançais, mais simplement que Rousseau n’a pas jugé bon de tout encrer lors du passage sous presse.
Je m’explique : on reconnaît les gravures relevant des techniques de la taille-douce à la présence d’un « coup de plaque » c’est-à-dire d’un relief sur le papier, qui correspond à la bordure de la matrice. Lorsqu’on passe sous presse, la pression est telle que la matrice laisse son empreinte dans le papier, en le gaufrant. On appelle ça un « coup de plaque » ou une « cuvette ». La plaque n’est pas la seule à donner au papier du relief : la pression exercée fait que le papier pénètre légèrement dans les tailles gravées, laissant un léger relief. C’est ainsi qu’en passant ma main sur le papier, je sens mon motif « mystère » sous mes doigts…
Peut-être la pochette contenant l’oeuvre graphique de Rousseau va-t-elle me livrer un tirage encré de ce fameux motif ? Lors de mon précédent passage, je n’avais pas pu consulter l’oeuvre de Rousseau dans les collections du musée, puisque j’ignorais encore le nom de l’artiste… ça ç’aurait été chercher une épingle dans une botte de foin.
Le musée possède un fonds d’art graphique évalué à 6000 pièces dont beaucoup d’estampes du XVIIe siècle. Les dessins et estampes sont rangés dans trois grands meubles à tiroirs, classés par ordre alphabétique d’auteurs. La pochette consacrée à Emile Rousseau est conséquente : une cinquantaine de dessins et de tirages, que je feuillette avec plaisir… Académies dessinées, tirages d’état d’estampes, dont ses plus célèbres pièces… et, au milieu de tout cela, une impression de la composition mystère de ma planche !

Comme pour l’autre motif, il s’agit donc bien d’un morceau choisi d’une oeuvre du XVIIe siècle, probablement gravée dans le cadre d’un exercice. Quelle est la source ? Cela reste un mystère… (qu’un lecteur d’Orion résoudra ? )
Dessins et estampes de Rousseau
Feuilleter les dessins d’Émile Rousseau le rend plus familier. Il semble qu’il ne s’agisse ici que d’études, peut-être celles qui lui ont valu des encouragements alors qu’il était encore élève à l’École municipale de dessin d’Abbeville.
Dans la pochette, je découvre également des dizaines de tirages, notamment ses estampes les plus célèbres. Plusieurs ont été données par Émile Rousseau lui-même, qui les dédicace à sa ville ou à Monsieur Boucher de Perthes.
Pour deux ou trois sujets, le musée possède plusieurs tirages d’état. On sent là une volonté documentaire dans la constitution du fonds : ces estampes illustrent parfaitement le travail du graveur d’interprétation au burin.
Ainsi, il est particulièrement intéressant de se pencher sur les trois états du portrait d’homme, gravé par Rousseau à la demande de la chalcographie du Louvre, qui souhaitait commercialiser une copie de ce tableau du XVIe siècle, autrefois attribué à Raphaël ou à Giorgione.
Pour parvenir à rendre le plus justement les couleurs et les modelés, Rousseau place d’abord les grandes lignes et les zones d’ombre. Il va ensuite travailler le modelé par ajout successif de tailles.

Ultime rebondissement … la découverte d’une autre matrice !
Le lendemain de la conférence, l’archiviste d’Abbeville nous reçoit pour une visite des réserves de la bibliothèque patrimoniale et des archives de la ville… Il tient à me montrer un petit fonds de matrices qu’il conserve d’un graveur de la première moitié du XXe siècle, Marius Martin… Et au milieu de tout ça, nous avons la surprise de découvrir … une autre matrice d’Émile Rousseau !
Je vous le dis, il n’a pas fini de me faire courir !














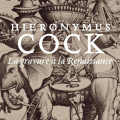



un article passionnant, merci!
Passionnant à suivre et très instructif : coup de coeur pour les états successifs du visage que tu nous présentes.
C’est toujours un bonheur de lire ces histoires qui nous font vivre les aventures qui font tout le sel de ce domaine ! Le rendu du portrait du Louvre est saisissant ! Vivement le prochain épisode 😉
aha! je suis précisément à Abbeville aujourd’hui et demain, en visite ‘touristique’, je ferai un saut au musée et penserai à vous 🙂
merci pour ce palpitant billet!