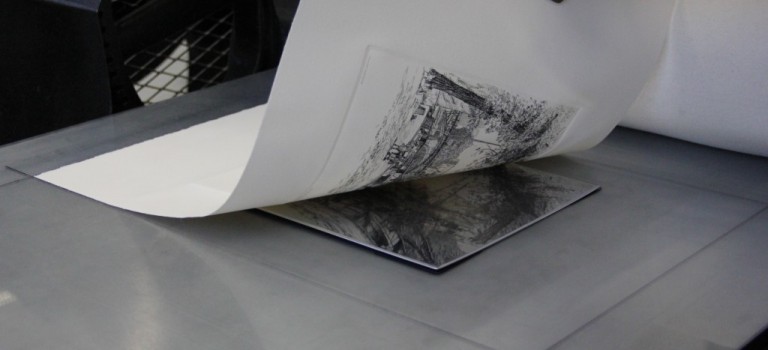Tous les musées de France ont leur « Ziem » : une vue de Constantinople ou de Venise, baignée d’un soleil doré et peuplée de cavaliers arabes ou d’esclaves lascives. Aujourd’hui presque inconnu, Félix Ziem a été un des peintres les plus en vue à la fin du XIXe siècle. On s’arrachait alors ses toiles figurant un Orient fantasmagorique que l’artiste, bien conscient du marché, produisait en quasi-série. Sa postérité en a souffert et Ziem a trop longtemps été réduit à un petit maître commercial. À Martigues, où il a longtemps résidé, le musée qui porte son nom invite à une redécouverte de son œuvre, plus surprenante qu’il n’y parait.

On estime qu’il a réalisé 6000 tableaux et près de 10 000 dessins en soixante-dix ans de carrière. Pourtant, rien ne destinait Félix Ziem (1821-1911) à devenir peintre. Fils d’un tailleur d’habits d’origine polonaise, il intègre à seize ans l’école d’architecture de Dijon. Brillant élève, il aurait dû poursuivre sa formation à Paris, mais un différend avec l’administration provoque son renvoi de l’École. Il s’installe alors à Marseille où il trouve à s’employer sur le chantier du canal. Mais c’est surtout le dessin qui va lui permettre de gagner sa vie : ses aquarelles sont remarquées par le duc d’Orléans alors que l’artiste amateur n’a que dix-neuf ans. Il reçoit ainsi une première commande, que bien d’autres devront suivre. Rapidement, Ziem tisse un solide réseau de connaissances parmi l’aristocratie qui fréquente la Côte d’Azur. Elles formeront une clientèle fidèle. Dès 1840, Félix Ziem ouvre un atelier où il enseigne les rudiments du dessin alors qu’il est lui-même encore en train de se former à la peinture. Lire la suite