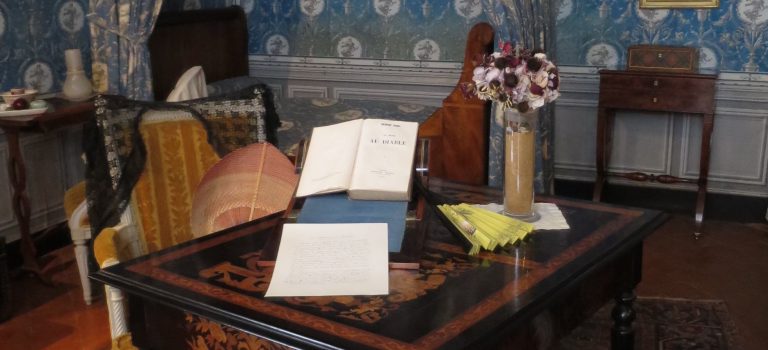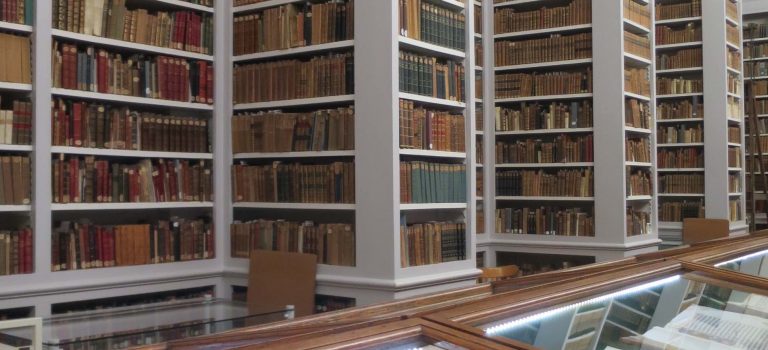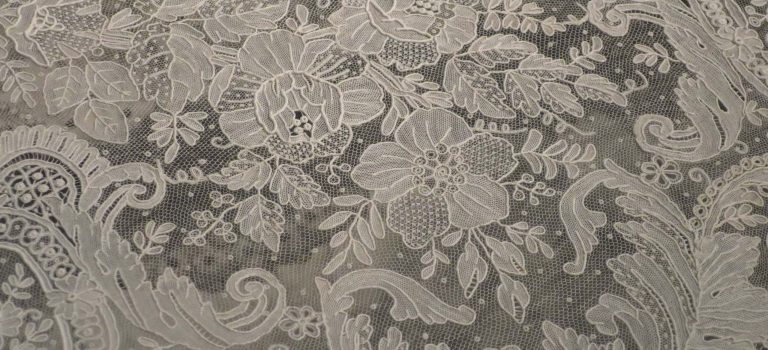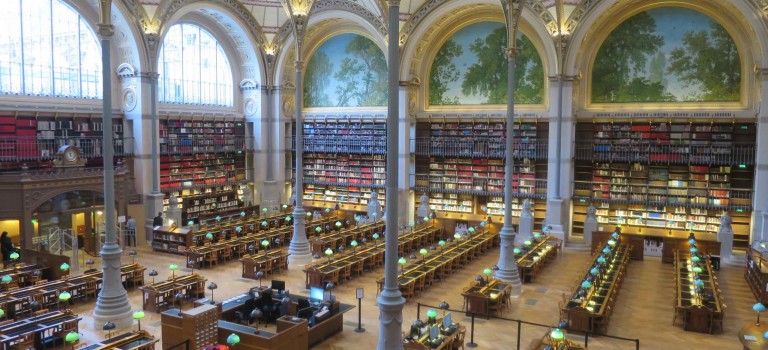Dans l’avant-dernier numéro de Grande Galerie, la revue du Louvre, j’ai appris l’acquisition toute récente par le musée d’un buste dû aux mains de Jean-Antoine Houdon, un des plus fameux sculpteurs du XVIIIe siècle. Ce buste vient compléter une série de portraits des proches de l’artiste que j’appréciais déjà tout particulièrement. N’est-ce pas une belle occasion de vous en parler ?

C’est une des plus touchantes vitrines du département des sculptures. Sur une étagère, des poupons joufflus et le visage d’une belle jeune femme. Houdon a modelé dans la terre puis sculpté dans le marbre les portraits de sa femme et de ses filles. Le Louvre possède, des trois sœurs, deux portraits de Sabine, l’aînée. Le premier a été réalisé alors que le bébé n’avait que quelques mois. Le second, alors que Sabine avait 4 ans. Les bustes de Anne-Ange et Claudine, les cadettes, sont conservés dans différentes collections publiques et privées, de par le monde. D’Anne-Ange, le Musée du Louvre n’avait que le plâtre original. L’institution a acquis en mai 2017, lors d’une vente publique, la version sculptée dans le marbre de ce même portrait.