Les campagnes de publicité des musées sont décidément très réussies ces temps-ci. Dernièrement, les parisiens ont vu fleurir dans le métro et sous les abribus les nouvelles affiches du musée de l’histoire de l’Immigration.

Quatre slogans chocs imprimés en grosses lettres blanches sur des photographies sépia des années 60. « 1 français sur 4 est issu de l’immigration » ; « L’immigration ça fait toujours des histoires »; « Ton grand père dans un musée ! » ; « Nos ancêtres n’étaient pas tous des gaulois ».
Visuellement, ça m’évoquait un peu la charte graphique des Archives Nationales, et j’ai d’abord penché pour la pub d’une O.N.G avant d’identifier l’institution concernée : la Cité de l’Immigration (dont le titre exact est aujourd’hui Musée de l’histoire de l’immigration).
Des slogans chocs pour susciter le dialogue et encourager la visite
Avec des phrases aussi directes, clairement ancrées dans les débats de société, dans un contexte de tension sociale chaque jour un peu plus perceptible, le pari était osé. C’est sans surprise que j’ai vu, dès les premiers jours de la campagne, les premiers vandalismes fleurir sur ces affiches. « Dehors ! Dehors ! » avait inscrit une main sur le slogan « 1 français sur quatre est issu de l’immigration ». « Malheureusement » précédait maintenant « Nos ancêtres n’étaient pas tous des gaulois » dans une autre station.

Un vandalisme à déplorer, mais qui – paradoxalement – témoigne de la pertinence de cette campagne publicitaire et marque son efficacité. Les affiches suscitent des réactions, qu’elles soient positives ou négatives. Certains débattent du sens des slogans dans les rames, avec un proche, un collègue ou un inconnu, d’autres taguent, mais rares sont ceux qui n’y jettent pas au moins un regard intrigué.
Percutantes, les affiches invitent au dialogue et inscrivent le musée dans l’espace public. Or, n’est-ce pas là l’un des buts des institutions muséales que de susciter l’échange, le dialogue ?

Changer l’image d’un jeune musée [mé/mal]connu
La cité de l’immigration est une institution jeune. Ouverte en 2007, la nouvelle institution a été marquée par le contexte tendu dans laquelle elle est née : en pleine ère Sarkozy, la Cité a eu a souffrir d’une mauvaise appréhension du message qu’elle entendait délivrer. Associée par la force des choses à l’action du pouvoir en place vis-à-vis des problématiques migratoires, la Cité a été perçue par une partie de l’opinion comme un musée instrumentalisé. Depuis, des élections sont passées par là, mais le musée est toujours taxé de « propagandisme » par ses détracteurs. Il est pourtant révélateur de souligner que l’institution n’a jamais été officiellement inaugurée et qu’elle attend toujours qu’un Président de la République s’y déplace!


Autre difficulté pour la jeune cité : le lieu qui l’accueille n’est pas neutre. Le Palais de la Porte Doré, chef-d’œuvre de l’architecture art déco, construit pour l’Exposition coloniale de 1931, a longtemps abrité le Musée national des arts d’Afrique, d’Asie et d’Océanie dont les collections ont été versées au Musée du Quai Branly. Certains visiteurs y cherchent encore trop souvent ces collections, ou s’attendent à y découvrir l’histoire des colonies ou des Dom-Tom.
La campagne publicitaire a donc pour ambition de renouveler l’image du musée. En délivrant un aperçu plus clair du contenu du musée, il s’agit de conquérir de nouveaux publics et d’inciter à la visite. A tous, les affiches adressent le constat qu’ «un français sur quatre est issu de l’immigration » et que « Nos ancêtres n’étaient pas tous des gaulois ». Un quart des français dont ni l’histoire personnelle ni la généalogie n’est anecdotique puisque largement partagée au sein de la population. Sur la photographie, quatre écoliers regardent ensemble un territoire commun, patrimoine de la Nation.

« L’immigration ça fait toujours des histoires » proclame une autre affiche, illustrée d’un jeune couple de danseurs à un bal populaire. C’est peut-être le slogan le plus osé de la campagne puisqu’il assume clairement le caractère polémique de son sujet dans le contexte social actuel. Un internaute a récemment suggéré sur twitter que l’on fasse précéder « histoires » de « belles », mais la photo dit ce que les mots taisent…


« Ton grand-père dans un musée » interpelle directement le français dont un ancêtre a fait, il y a quelques décennies, le choix de la France. Ce slogan, qui vise ce quart de la France « issu de l’immigration » est symboliquement fort. Le musée est la vitrine du patrimoine, l’endroit où l’Histoire de la Nation s’expose. Entré au musée, l’immigrant d’hier est reconnu comme appartenant à cette Histoire au même titre que le serment du jeu de Paume, une relique royale ou la carte d’un électeur du XIXe siècle. D’ailleurs, le changement récent de l’intitulé de l’institution est révélateur de cette volonté : le titre de Musée, qui a remplacé celui du Cité lui donne une force symbolique nettement supérieure. Durant la dernière décennie, on a renommé à tour de bras des institutions en « cité » voulant véhiculer une image plus dynamique, jeune, vivante que le traditionnel « musée », jugé « poussiéreux ». Retour de balancier, on se rend aujourd’hui compte que le titre « cité » a surtout brouillé les cartes pour le visiteur qui découvre l’institution : on a des cités administratives, des cités des sciences, des cités sensibles, et… une cité de la céramique, une cité de l’architecture…

Faut-il un musée pour l’histoire de l’immigration ? Réflexion d’une néophyte sur les musées « d’identité »
Un musée des Arts et traditions populaires (mort), un musée de l’histoire de France (à Versailles, fermé depuis longtemps et pour encore longtemps), un projet d’une maison d’histoire de France (enterré), un Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (nouveau-né), un musée de l’histoire de l’immigration… cinq institutions, l’une disparue, la seconde soustraite aux yeux du public, la troisième jamais concrétisée, les deux dernières très récentes, pour parler d’un même sujet : l’identité et de son histoire au sein d’une culture mondialisée. Nationales, régionales, locales ou communautaires, fallait-il donc tant de musées pour parler de l’identité, des identités ?
Je fais partie de ceux qui regrettent le défunt M.N.A.T.P. imaginé par Rivière dans les années 30 et ouvert au lendemain de la seconde guerre mondiale. Le MuCEM a hérité des collections d’arts et traditions populaires françaises mais son projet scientifique et culturel, axé, comme son titre l’indique, sur les Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, ne les exploitera pas à leur juste mesure. Le projet du MuCEM est pourtant louable et même nécessaire, mais avec de si riches collections, n’y avait-il pas de quoi faire vivre les deux musées, possiblement sous une direction commune ?

Quant au Musée de l’histoire de l’Immigration, il est légitime en ce qu’il affirme comme appartenant à l’histoire nationale une partie de la population dont jusqu’alors on ne reconnaissait pas assez la place. Cependant, on pourrait reprocher à la Cité de l’immigration, en étant consacrée à la seule histoire des immigrants de l’isoler volontairement du reste de l’Histoire nationale. De ce fait, on pourrait réclamer un musée d’histoire de la Nation, qui traite tout autant des arts et traditions populaires régionaux que de l’immigration ou que de la Révolution. Bref, un véritable musée de l’histoire commune.
Note: cette réflexion n’est pas issue d’une expérience de visite personnelle des trois musées cités mais des échos de leurs programmes respectifs qu’en ont fait la presse et les réseaux sociaux. Il est donc totalement subjectif et potentiellement erroné.
Pour conclure en revenant à nos moutons, c’est-à-dire la campagne publicitaire de la Cité de l’Immigration, sachez qu’elle m’incite très fortement à la visite ! Ce sera l’occasion de revoir ma réflexion au regard du message délivré dans l’espace muséologique.
Pour aller plus loin: si le sujet vous intéresse, ne manquez pas l’interview de Mercedes Erra sur le blog Culture et communication (signalé par Louvre pour tous). Il y est rappelé que cette très belle campagne publicitaire a fait l’objet d’un mécénat de compétence : la RATP, JC Deceaux, Le Monde, TV Magazine et Psychologie ont gratuitement mis à disposition les panneaux d’affichage tandis que l’agence BetC s’est chargée de la conception graphique. Pour suivre les réactions des internautes à la campagne, il existe aussi un storify consacré à cette question.
J’aime ça :
J’aime chargement…
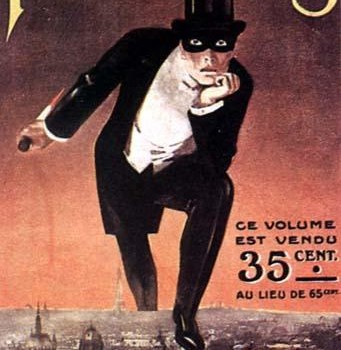


























 -Je trouve cette plaisanterie assez déplacée! répond le provincial, mécontent de voir son image si peu flattée.
-Je trouve cette plaisanterie assez déplacée! répond le provincial, mécontent de voir son image si peu flattée.














