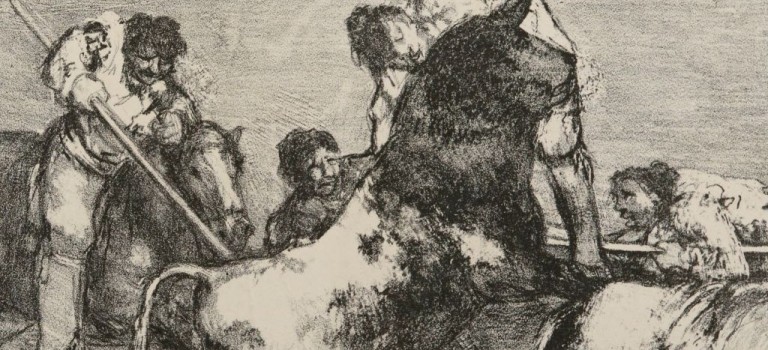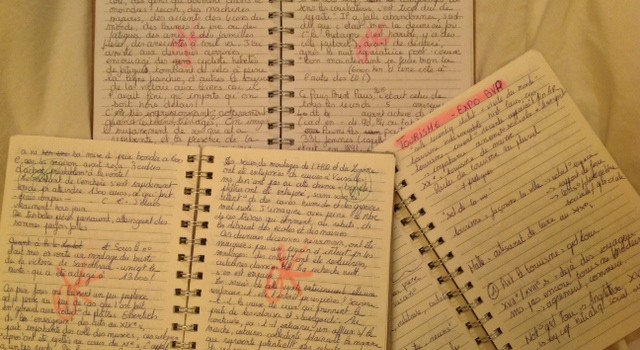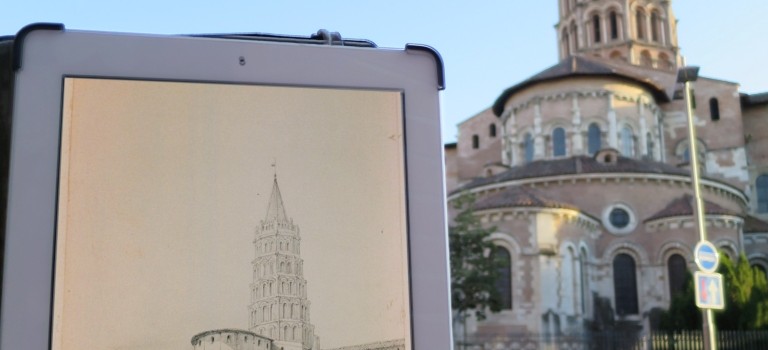En septembre dernier, de passage à Abbeville, la directrice du musée Boucher-de-Perthes m’a présenté quatre matrices d’estampe récemment découvertes dans leurs réserves afin que j’en choisisse une pour « l’œuvre du mois ». Des trois cuivres gravés et de la xylographie populaire qu’elle m’a proposés, j’ai sélectionné la planche la mieux conservée et la plus mystérieuse : un grand cuivre apparemment inachevé, où figurent un homme nu allongé, un lion, trois mulots et un melon. L’identifier a été une aventure pleine de rebondissements, que je raconterai lors d’une conférence à la bibliothèque d’Emonville le vendredi 12 février. Mais pour ceux qui n’auront pas l’occasion d’assister à cette rencontre, je vous propose une transcription libre et condensée de ma conférence !



![Agence Rol, Geneviève Félix [allongée dans un lit, lisant un livre], photographie, 1922, Gallica/BnF](http://peccadille.net/wp-content/uploads/2016/01/export-5-710x317.jpg)