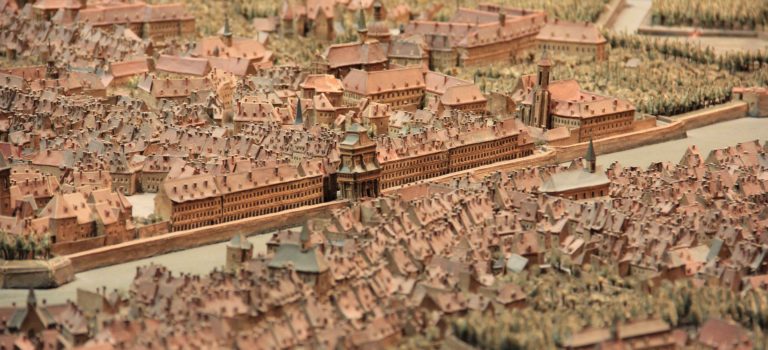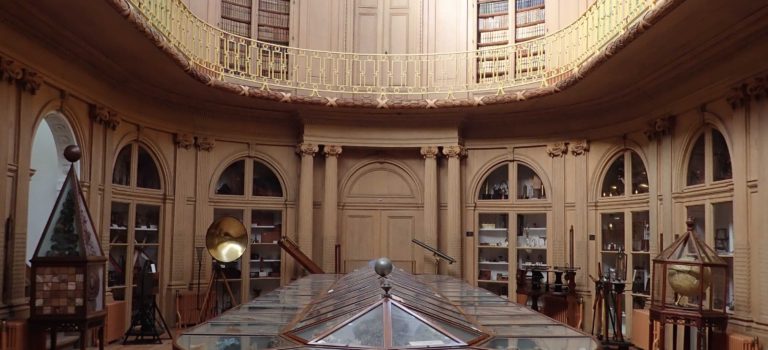Rencontrer la meilleure société du XVIIIe siècle, presque en chair et en os, cela vous dit ? C’est ce que le Musée du Louvre nous propose jusqu’au 10 septembre avec l’exposition « En société ». L’occasion d’admirer la plus belle collection de pastels anciens au monde et de s’offrir un troublant face à face avec les grands personnages de l’Ancien Régime, car tous les pastels exposés sont des portraits !

Le Musée du Louvre peut s’enorgueillir de nombreuses choses : le fait de posséder la plus extraordinaire collection de pastels des XVIIe et XVIIIe siècles n’en est pas la moindre, quand on sait la rareté, la fragilité et la préciosité de ces oeuvres. Cent soixante numéros, de quelques cinquante artistes différents, essentiellement français – et parmi lesquels les plus grandes signatures : Maurice-Quentin de La Tour, Chardin, Perronneau… Presque tout l’âge d’or du pastel réuni ! Cette collection s’est pour l’essentiel constituée sous la Révolution et au cours des premières décennies du XIXe siècle, à partir des fonds de l’Académie royale de peinture et de sculpture, des saisies des biens des émigrés et des collections royales qui ornaient Versailles. Lire la suite